Ainsi commence Sonnenschein, le roman documentaire de Daša Drndic. La femme assise se nomme Haya Tedeschi. Elle a été professeur de mathématiques ; elle vit depuis presque toujours à Gorizia, non loin de Trieste. Malgré ses origines juives, elle n’a pas subi le sort des neuf mille Juifs italiens déportés. Le père de Haya a même été fasciste et a survécu. La vie de Haya, qu’elle aurait aimé vivre absente de l’Histoire, a pourtant connu un tournant tragique quand l’enfant qu’elle avait eu avec Kurt Franz a été enlevé. Et depuis, elle l’attend. C’est même cette attente qui fait le cœur du roman, et qui devient notre attente de lecteur.
Dans « roman documentaire », le second terme est essentiel. À l’instar de Sebald ou de Danilo Kiš, l’auteur procède par allusions, par détours. Les photos et autres documents authentiques attestent d’une réalité que l’on n’aura aucun mal à reconnaître. Comme l’écrivain allemand dans Austerlitz, Daša Drndic entre dans le récit par la géographie et l’Histoire. En l’occurrence celles de la zone de Trieste, aux confins de l’Empire austro-hongrois en 1914. On parle là l’italien, le slovène et l’allemand. Les populations sont mêlées, les conflits n’en sont que plus âpres. La frontière, cette « source de relent putride », est une « cicatrice entièrement constituée de boursouflures morbides entre les vivants et les morts ». Sur la Soca, rivière qui traverse Gorizia, « archive liquide de l’Histoire », plus de deux millions d’Italiens et d’Austro-Hongrois mourront pendant les six batailles qui se succéderont en 1916. Des références à Giono ponctuent ce récit des guerres, mettant en relief l’absurdité de la boucherie de 1914 et les vertiges de l’identité. Mais le pire reste à venir.
Dans un mouvement en spirale, la romancière nous plonge dans les années de la Seconde Guerre mondiale. Trieste est la dernière étape pour une bande de SS qui administrent cette zone confisquée par le IIIe Reich. Tous ont commencé leur carrière en Allemagne par la mise en œuvre du plan T4. Il s’agissait alors de se débarrasser des handicapés mentaux. Erwin Lambert est de ceux-là. Il a conçu à Hadamar ou Sonnenstein les premiers crématoires. Il sera le maître d’œuvre de celui de San Sabba, une rizerie qui devient le centre de détention et de tuerie des nazis, à Trieste. Ses comparses et lui ont poursuivi leur carrière à Treblinka. Parmi eux se trouvait Kurt Franz, l’un des pires assassins du camp. Et son chien Barry, dressé pour tuer, était la terreur des détenus. Mais à Trieste, le Franz que Haya a rencontré était un aimable amateur de photographie, constituant son album intitulé « Les plus belles années de ma vie ». La dimension documentaire du roman est étayée par des fiches, des procès-verbaux rendant compte des témoignages des vivants ou des morts appelés pour suppléer l’absence des assassins. Au tribunal de Trieste, quand s’ouvrent les procès en avril 1976, le banc des accusés est vide.
Le puissant texte littéraire que propose la romancière est ainsi la mémoire ravivée d’un crime. Haya vit dans une chambre qui rétrécit, son arbre généalogique est « élagué » comme l’était celui du héros de Goetz et Meyer (1) de David Albahari, autre grand roman sur l’époque. Les thèmes du vide et de l’absence traversent ce roman jusqu’à son terme. Mais ce vide est comblé de diverses manières, ne serait-ce que le jour où Haya décide d’en savoir plus sur son fils Antonio, et qu’elle enquête. Elle a longtemps refusé toute appartenance, la lettre d’un ancien élève la réveille. Piazza lui envoie un livre de Claudio Magris ; il lui rappelle le nom des siens morts en déportation. Il met en lumière tout ce que cette époque a pu enchevêtrer d’existences et donne au roman que nous lisons sa dimension exceptionnelle, montrant « l’éternel entrecroisement de vies qui n’ont aucun point de contact entre elles et se rencontrent en un anéantissement mutuel, à des distances inconcevables, dans la simultanéité ».
Une liste de 9 000 noms s’égrène sur cinquante pages, autant de vies brisées que l’on pourrait imaginer, puisque « tout nom cache une histoire ». Nous ne les saurons pas toutes mais l’énigme de la disparition qui était au cœur du roman commence à trouver sa réponse. La folie nazie est meurtrière et purificatrice. On y rêve d’êtres parfaits, conçus selon des modèles. Les poupées Borghilda, nées de l’imagination délirante de Himmler, étaient censées éviter aux soldats allemands des contacts avec des femmes impures ou malades, de même que le salon Kitty, bordel exceptionnel, n’avait pour personnel que des prostituées triées sur le volet. Rien n’échappait à la « science nazie ». Les Lebensborn, « source de vie » inventés pour les mêmes raisons, naissaient dans des cliniques surveillées de près, et ils grandissaient à l’écart. Ils constituaient la future élite du Reich. C’est le sort qu’a connu Antonio Tedeschi, le fils d’Haya et de Kurt Franz.
Son enquête conduit Haya au Schloss Oberweis, à Gmunden, la ville de Thomas Bernhard, qui hante ces pages comme celles de Kiš, Saba ou Magris. Elle la conduit au service international de recherche d’Arolsen, centre d’archives de la Croix-Rouge qui contient des informations sur toutes les victimes de cette guerre. Elle l’amène à s’interroger sur ces convois venus d’Italie, qui traversaient de nuit la frontière suisse et faisaient étape à Zurich. Toute l’hypocrisie helvète apparaît alors. Enfin Haya prend conscience du rôle ambigu de l’Église catholique, qui prétend sauver les âmes pour mieux les annexer. Nous ne dirons rien ou presque des dernières pages de ce roman, sinon qu’il y est question, de façon détaillée, de cette « note en bas de page de l’Histoire » qu’est le Lebensborn. Beaucoup parmi les enfants conçus par des nazis, enlevés à des mères au physique « aryen », ont connu une destinée atroce. Le roman en donne des exemples, par la voix du fils de Haya, qui se vit comme « un nain rabougri […] qui attend en moi depuis 62 ans de devenir adulte, d’avoir une biographie, ne serait-ce qu’insignifiante et brève ».
La corbeille rouge de Haya est le centre d’une constellation. On lit ce roman avec fascination et émotion, frappé par son intelligence, sa façon si subtile d’entrelacer réel et imaginaire, de mêler les noms des écrivains, de nous entraîner sur les pas de Saba dans les ruelles de Trieste et de rappeler Eduard Sam, père devenu légendaire de Danilo Kiš, et de nous guider sur les traces des assassins, sortis impunis du tribunal des humains.
- Gallimard, 2002 (QL n° 835).

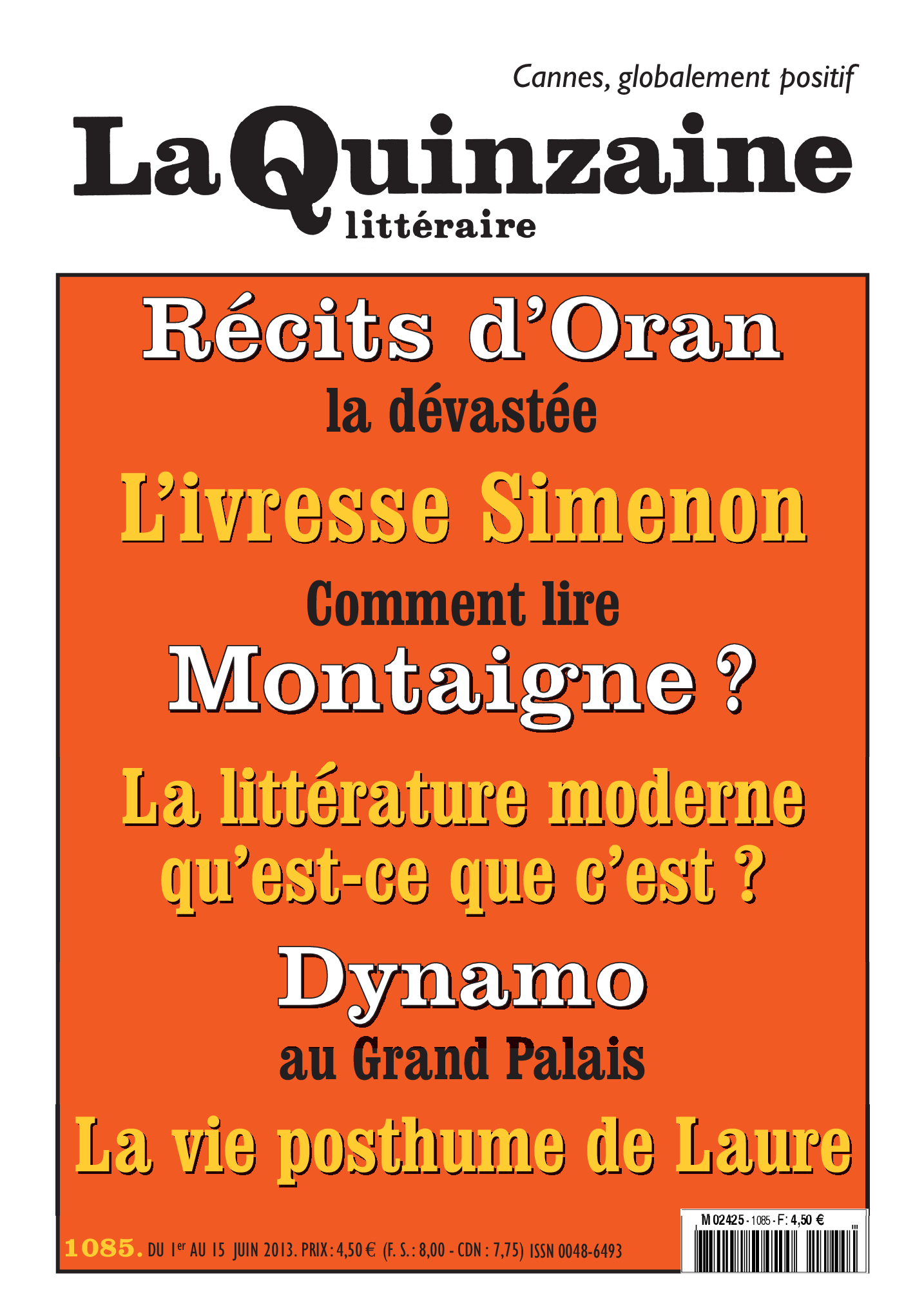

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)