Le bal de septembre est heureusement ouvert par Benoît Jacquot. C’est avec plaisir que l’on utilise cet adverbe, car nous n’avons pas toujours été en phase avec le réalisateur de Trois cœurs, capable du meilleur (Les Adieux à la reine) et du reste (L’Intouchable). Tout en gardant une même approche, dans le goût classique un peu compassé qui marquait ses premiers essais (Les Ailes de la colombe, par exemple).
S’il demeure ici encore dans la tradition d’un scénario psychologique à la française (remarquablement composé), il parvient à nous surprendre, avec son histoire d’inspecteur des impôts ratissant les villes de province, qui tombe amoureux d’une femme dont il ne sait rien, rate le rendez-vous promis qui aurait changé leur vie, puis rencontre une autre femme qu’il épouse et qui se révèle être la sœur de la première. Une fois accepté l’impossible, on peut s’abandonner et goûter cette belle idée de l’amour jailli d’une étincelle, capable de résister à la disparition et au cours du temps, d’autant que Charlotte Gainsbourg, sortie des pattes de Lars von Trier, est excellente et le duo mère-fille Catherine Deneuve-Chiara Mastroianni crédible, forcément. Quant à Benoît Poelvoorde, il est, comme chaque fois qu’il est bien dirigé, étonnant de fragilité ambiguë.
Bien plus étonnant, en tout cas, que dans La Rançon de la gloire, de Xavier Beauvois, dans lequel il revient à un personnage plus habituel, celui d’un pied nickelé embarqué dans un projet qui le dépasse (ici, le kidnapping du cercueil de Chaplin) ; on a fini par s’habituer à ses rôles en décalage et la surprise joue moins devant une performance, certes maîtrisée, mais sans renouvellement véritable. L’auteur de Des hommes et des dieux a choisi la veine de la comédie, on ne peut que s’en réjouir. Le film, présenté au Festival de Venise, ne sortira sans doute pas dans l’immédiat, une seconde apparition du couple Poelvoorde-Mastroianni risquant de lasser le public.
On entend chanter un peu partout les louanges d’Hippocrate, de Thomas Lilti, tragicomédie hospitalière qui montrerait des choses jamais vues. Ce qui est exact quant au rôle des médecins étrangers, pourvus de diplômes non reconnus en France, utilisés comme suppléants sous le sigle FFI, « faisant fonction d’interne » – ici Reda Kateb, toujours juste. En revanche, pour les amateurs de séries médicales, le plat n’est pas très relevé, et la sensation de cahier des charges à remplir, chaque cas illustrant une catégorie de malades, est parfois gênante (comme elle gênait dans Polisse de Maïwenn). Mais le handicap principal, sur un fond de réalité bien décrit – le réalisateur étant de la partie –, tient à l’interprète, Vincent Lacoste, qui, malgré le mal qu’il se donne, peine à faire oublier qu’il était encore en classe de troisième il y a quatre ans (Les Beaux Gosses, de Riad Sattouf) et qu’il est aujourd’hui à bac + 6, sans phase intermédiaire. On ne lui demande pas d’être Dr. House, mais de ne pas endosser une blouse trop large pour ses épaules actuelles.
Christophe Honoré semblait, enfin, avoir choisi le théâtre pour s’exprimer. Métamorphoses signale son retour au cinéma. On trouve Ovide en format de poche, ou en trois beaux volumes aux Belles Lettres, ou même, si l’on veut regoûter, dictionnaire Gaffiot aidant, au charme des hexamètres dactyliques, sur le site The latin library, qui offre le texte en v.o. Le recours aux origines sera toujours plus utile et moins pénible que cette version moderniste des mythes fondateurs, sauf pour les spécialistes en tératologie.
Une autre expérience relativement éprouvante : la vision du dernier film du tandem Benoît Delépine-Gustave Kervern. La déception est d’autant plus forte si l’on considère leurs cinq titres précédents, d’Aaltra (2004) au Grand Soir (2012). Panne d’inspiration, sentiment d’être parvenu au bout d’un système, envie de pousser plus loin l’expérimentation ? On hésite à trancher pour eux. Mais devant NDE (Near Death Experience), la jubilation qui allait de concert avec chaque nouvelle production s’évapore. Il faut reconnaître que le spectacle de Michel Houellebecq (en plus triste état encore que dans le téléfilm de Guillaume Nicloux, L’Enlèvement de M.H.) seul ou presque dans la montagne, s’occupant à des activités minuscules, dormir, regarder des fourmis, empiler des cailloux, filmé en d’interminables plans séquence par une caméra numérique mal réglée finit par rebuter, une fois admis le dispositif.
Il est courageux de la part d’auteurs reconnus de brandir ainsi la carte de l’expérimental, du retour à la virginité de l’image, de l’épuisement du sens. Depuis l’apparition de l’école underground new-yorkaise des années soixante, on a vu des dizaines d’œuvres de ce type. Mais, dans ce cas, prendre comme acteur un écrivain célèbre est une façon douteuse de jouer sur deux tableaux, la radicalité et le spectaculaire – qui irait voir NDE si le héros était un individu lambda ? Gardons confiance – ceux qui ont signé un chef-d’œuvre comme Louise-Michel (voir QL n° 985) ne peuvent être totalement perdus.
Yves Jeuland a réalisé, il y a deux ans, un excellent documentaire, nourri et fasciné, Il est minuit, Paris s’éveille, sur l’âge d’or révolu des cabarets de la rive gauche. Son approche du vivant, Les Gens du Monde, à savoir les journalistes du quotidien de référence saisis le temps d’une campagne présidentielle, nous semble un peu en retrait, non par manque de regard, mais par sa brièveté. Faire en quatre-vingt-deux minutes un portrait de journal avec groupe est un exercice ardu – il y faudrait le temps d’un film de Frederick Wiseman, quatre heures chrono, et encore. Tout ce qu’il nous montre est passionnant, d’autant qu’il a choisi des «interprètes» de haut niveau, Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin. Mais on en voudrait plus : découvrir, derrière le vedettariat, les petites mains du métier, la fabrication physique du produit, en gros le quotidien du quotidien. Il n’empêche qu’en l’état c’est le meilleur témoignage sur le sujet depuis Numéros zéros et Reporters de Raymond Depardon, qui ne datent pas d’hier.
Accumuler ainsi des recensions mitigées pourrait laisser croire que le paysage cinématographique français de la rentrée est proche de la courbe de l’inflation. Question de dates de sortie. Quelques titres présentés à Venise, en compétition ou ailleurs, vaudront le déplacement lorsqu’ils surgiront dans nos salles. Ainsi Réalité, de Quentin Dupieux, mauvais esprit qui nous réjouit régulièrement par son culot et ses inventions visuelles (Rubber ou Wrong Cops). Ainsi Loin des hommes, de David Oelhoffen, adapté d’une nouvelle de Camus, qui parvient à nous faire accepter l’improbable – Viggo Mortensen en instituteur dans un djebel algérien perdu, à la veille de l’insurrection de 1954 – grâce à un rare sens de l’espace et une grande intelligence dans la peinture de protagonistes opposés. Ainsi Le Dernier Coup de marteau, d’Alix Delaporte, reprenant les mêmes acteurs, Grégory Gadebois et Clotilde Hesme (déchirante sans pathos), que dans son précédent Alix et Tony, Prix Louis-Delluc mérité, et atteignant un degré d’émotion identique. Ainsi, présenté non à Venise mais à Locarno en août, Fidelio, l’odyssée d’Alice, de Lucie Borleteau, qui constitue, à notre sens, une des révélations de l’année, tant par l’audace de son argument – une jeune femme embarquée comme mécanicienne sur un cargo – que par la beauté et la photogénie de son interprète, l’inconnue Ariane Labed, dont on reparlera assurément.
De toute façon, il n’y a pas que le cinéma français dans la vie. Il suffira, le 24 septembre, d’aller voir le superbe Leviathan d’Andreï Zviaguintsev pour s’en convaincre.
Lucien Logette
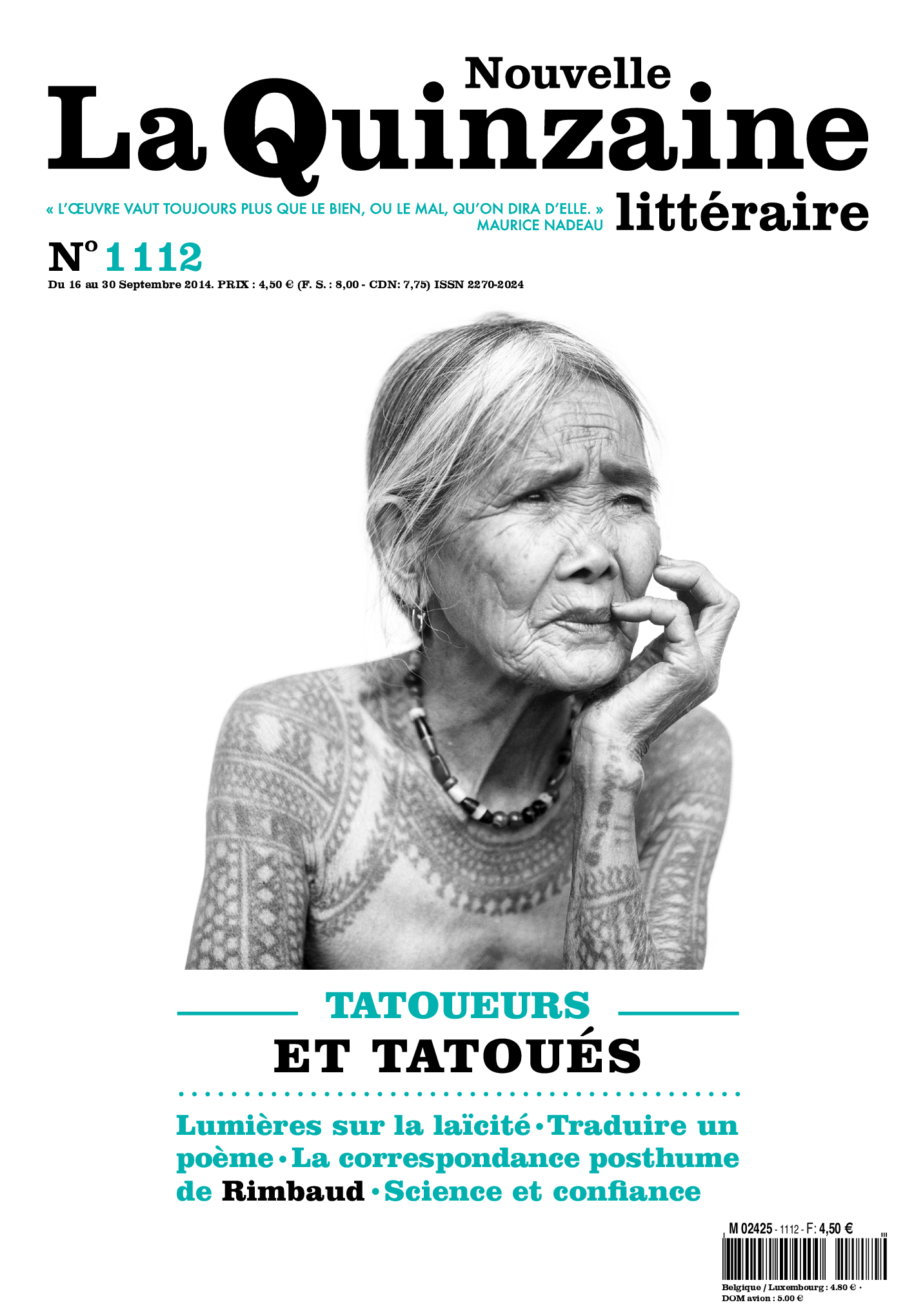

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)