Marie Étienne : Personne ne vous voit seulement comme la petite-fille de Jean Paulhan : vous vous êtes fait un prénom. Est-ce que cela a été difficile ?
Claire Paulhan : Quand, il y a plus de dix-huit ans, j’ai réfléchi au nom que j’allais donner à ma maison d’édition, et que j’ai choisi le mien plutôt qu’une expression (« memento mori », « pro domo ») ou une métaphore, il s’agissait d’annoncer implicitement que je désirais être au moins un peu à la hauteur de ce nom, et de la vie de ce grand-père que j’ai à la fois bien et mal connu : on habitait la même maison, rue des Arènes, dans le cinquième arrondissement de Paris, mais j’étais encore petite quand il est mort. La maison d’édition qui allait porter ce « titre » ne devrait pas être ridicule ou éphémère… Aujourd’hui, je me dis que ce nom, s’il m’a aidée à me faire repérer des amateurs de livres, m’a tout d’abord incitée à travailler au mieux de mes possibilités. Mais ce n’est pas lui qui, une fois passées les premières années de curiosité en ma faveur, m’a aidée à durer. C’est vraiment ce que j’ai mis en propre dans ma maison d’édition – mon goût pour les manuscrits et pour le lourd travail éditorial – qui me tient encore là.
A contrario, je me rends bien compte que j’ai construit, en matière d’édition, l’exact opposé de ce que mon grand-père a connu, à savoir un rôle central et exposé dans une grande maison d’édition parisienne, la lecture de nombreux écrivains contemporains, les conflits et les stratégies ; en ce qui me concerne : une micro-production pour un micro-public, le travail solitaire, non rémunérateur (je gagne ma vie parallèlement à l’IMEC), une position hors réseaux, presque secrète, le travail patient de mise au jour de la mémoire littéraire, que je pourrais réaliser n’importe où, pourvu qu’il y ait une grande bibliothèque à proximité.
M. E. : Vous m’avez déclaré récemment avec force : « Je ne m’intéresse qu’au passé ».
C. P. : Il n’y a pour moi de savoir que dans les strates et les expériences du passé. Et ce qui m’intéresse, c’est de reconstituer l’histoire personnelle, littéraire, de certains écrivains et témoins, de les relier à ce que l’on sait de l’Histoire « avec sa grande hache » : la trame de ce tissu mémoriel est, par endroits, lâche, informe, mitée ; ailleurs, elle est solide, cohérente et significative. De quoi ? De ces fameux tournants épistémologiques ou sensibles que les écrivains pressentent et expriment avant les sociologues et les politiques, et bien avant les historiens. En effet, si l’on regarde attentivement quels sujets sont traités par les romanciers, les auteurs de théâtre et même les poètes – ou la manière dont ils les évoquent dans leurs lettres et leurs journaux –, on comprend mieux ce qui nous constitue.
L’exemple qui me semble le plus frappant est celui de la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle des poèmes de circonstance, des sonnets rimés, presque des ritournelles, composés dans l’urgence par Aragon, Éluard, Desnos et les autres, ont répandu, grâce à leur simplicité même, l’esprit de résistance et l’espoir. (Péret a eu beau jeu, depuis le Mexique, de tourner ces bouts-rimés en réclames publicitaires d’apothicaires avisés : il n’empêche que des hommes ont risqué leur vie en les écrivant, d’autres en les imprimant, d’autres encore en les apprenant par cœur et en les diffusant.) Lorsque je publie des journaux intimes, des mémoires, des correspondances littéraires du XXe siècle, c’est à la reconstitution de cette mémoire intellectuelle que je souhaite contribuer, modestement, hors universités et radars sociaux, mais avec passion. C’est aussi à la gloire de la vaste littérature autobiographique que je m’emploie, la seule que j’aime vraiment lire.
M.E. : Si je comprends bien, votre travail à l’IMEC trouve un prolongement naturel dans votre activité éditoriale.
C. P. : Plus exactement, je vaque à plusieurs « chantiers » parallèlement, mais qui sont formés du même matériau de base : les archives. À l’IMEC, à Caen, je gagne ma vie, et d’une manière qui me plaît : je réalise des expositions et je cherche à valoriser les nombreux fonds très intéressants qui y sont déposés. D’un autre côté, je cherche, édite des textes autobiographiques inédits à partir des manuscrits, je les lis et relis avec les personnes qui me les proposent, j’organise la mise en page d’une œuvre, dont l’auteur est mort – ce qui est particulier. Et le reste du temps (autant dire pas assez), je m’occupe également des archives de Jean Paulhan, qui sont à l’IMEC. C’est aussi pour cela que je m’intéresse essentiellement au passé, aux traces écrites du passé. J’y baigne et je m’y complais.
M. E. : Vous m’avez dit avoir une préférence pour les journaux féminins.
C. P : En 1985, après des années de librairie, j’ai proposé à Paul Fournel, qui dirigeait les éditions Ramsay, de fonder une collection de textes autobiographiques littéraires, « Pour mémoire », et j’ai commencé en m’attaquant au manuscrit du Journal 1913-1934 de Catherine Pozzi : j’ai été un peu décontenancée devant la difficulté de cette tâche, dont j’ignorais tout. Un peu plus de dix ans plus tard, je créais ma propre maison d’édition et reprenais tous les titres publiés chez Ramsay, puis Laffont, puis Verdier : Catherine Pozzi, Jean Grenier, Jean Follain, Jacques Copeau. En 2001, j’ai eu en lecture, grâce à Dominique Tiry et Pierre Plateau, le manuscrit du journal monstre d’une jeune droguée homosexuelle des années 1920, Mireille Havet. Ayant compris d’emblée que je tenais là mon « auteur-phare », ma chance d’éditrice, j’ai commencé à le publier en 2003 : sans en ôter une ligne, j’ai édité cinq tomes de son journal, qui va de 1918 à 1929, et il me reste à publier son journal de jeunesse, de 1913 à 1918. Après, il y aura encore sa correspondance à traiter, par exemple celle avec sa meilleure amie, Ludmila Savitzky, qui, elle aussi, a laissé un beau journal, que j’aimerais également éditer, pour rendre hommage à son existence particulièrement indépendante. Mais les découvertes sont souvent moins le fait du hasard : en 2010, Marie-France Mousli m’a apporté le Journal d’Hélène Hoppenot, femme d’un ambassadeur, dont je me suis empressée de publier un fort volume donnant les années 1918 à 1933 ; je vais bientôt proposer un nouveau tome, qui ira de 1934 à l’Exode.
Ce que j’aime dans les journaux intimes, c’est le compas très ouvert des formes littéraires et psychologiques : de l’existence mise en scène avec grandiloquence, comme chez Jacques Copeau, aux notes sans commentaires comme chez Jean Grenier, de la précision diplomatique d’Hélène Hoppenot aux tendres métaphores de Jean Follain, de la crudité anti-sentimentale de Jacques Lemarchand à la courtoisie féroce de Ferdinand Bac… C’est aussi l’effort de tous ces êtres pour freiner la course du temps qui passe, pour décrire et dater les choses vues, entendues, ressenties, imaginées, vécues. Et peut-être dans ce registre les femmes ont-elles manifesté plus de finesse, brassé plus profondément l’intime et le superficiel, exprimé plus d’idées neuves, découvert plus de secrets. Autrement dit, je ne suis pas sûre que les journaux intimes des femmes d’aujourd’hui m’intéressent autant que ceux des femmes d’autrefois, pour lesquelles j’ai à la fois de la curiosité, du respect et de l’admiration. Cependant, le problème ne se pose pas, puisque je ne publie que des mortes et des morts. Qu’ils aient été de grands stylistes ou des diaristes à vif, l’essentiel est que leurs journaux s’inscrivent définitivement comme une part importante de leur œuvre. J’aime d’ailleurs bien cette expression, très vilipendée aujourd’hui, de « journal intime ». Elle met le lecteur à une bonne place : celle de voyeur érudit, d’amateur éclairé.
Par ailleurs, je vis une sorte de compagnonnage avec ces écrivains dont la vie m’influence, change même ma vie et mes pensées. Et la fin de l’impression d’un texte – qui aurait pu continuer à dormir, oublié de tous et tapi dans l’ombre – coïncide souvent avec la fin de l’écrivain : peu de registres littéraires portent en eux une telle imminence de la mort.
M. E. : Quels sont les titres de votre catalogue qui vous sont le plus chers ?
C. P. : Les derniers parus de mes livres me rendent généralement soucieuse : je les surveille du coin de l’œil, maintenant qu’ils m’ont « échappé » et vivent leur vie ; j’aimerais qu’ils trouvent leurs lecteurs, car ils en ont, forcément. Et celui que je suis en train de réaliser – en l’occurrence, les cahiers 1898-1899 du Journal quotidien de l’anarchiste Jehan-Rictus – me passionne. C’est plutôt l’ensemble de mon catalogue qui m’est cher. Quand je vois ces livres rassemblés, sur les rayonnages d’une bibliothèque ou d’une librairie, je suis fière : du nombre de titres, de leurs belles couleurs, de leurs registres mêlés, de leur unité éditoriale qui sert d’armature à cette très petite maison indépendante, la mienne – celle que je suis seule à mettre en œuvre ainsi –, spécialisée dans les littératures autobiographiques du XXe siècle. Mon grand-père écrivait à Marcel Arland, le 31 octobre 1952, au moment où il préparait la reparution de la Nouvelle Revue française : « Après tout, qu’est-ce qu’une entreprise (ou une aventure) ? C’est un serment qu’on s’est fait. ». Cette « aventure » des éditions qui portent mon nom, je ne la vis pas autrement.
M. E. : Comme éditrice, appliquez-vous la formule que vous avait offerte Jean Paulhan quand vous étiez petite fille : « Si j’étais une huître, je ne cultiverais pas ma perle » ?
C. P. : Il avait effectivement, après longue réflexion, calligraphié cette étrange phrase dans un petit carnet d’autographes que je lui avais présenté, au milieu des années 1960. Deux lectures de cette énigme s’offrent à moi maintenant : soit mon grand-père m’incitait à renoncer à faire avec soin le travail pour lequel j’étais peut-être « programmée » (et j’aurai alors résisté à cette injonction moqueuse) ; soit il désirait m’entraîner à cultiver la perle des autres, et c’est ce que je fais, me semble-t-il. L’intérêt de ce genre de phrase, c’est qu’elle peut dire une chose et son contraire, tout en donnant le goût des mots et de la langue, du jeu et du secret. Ce que je retrouve depuis toujours dans les écrits autobiographiques.
- Institut mémoires de l’édition contemporaine.

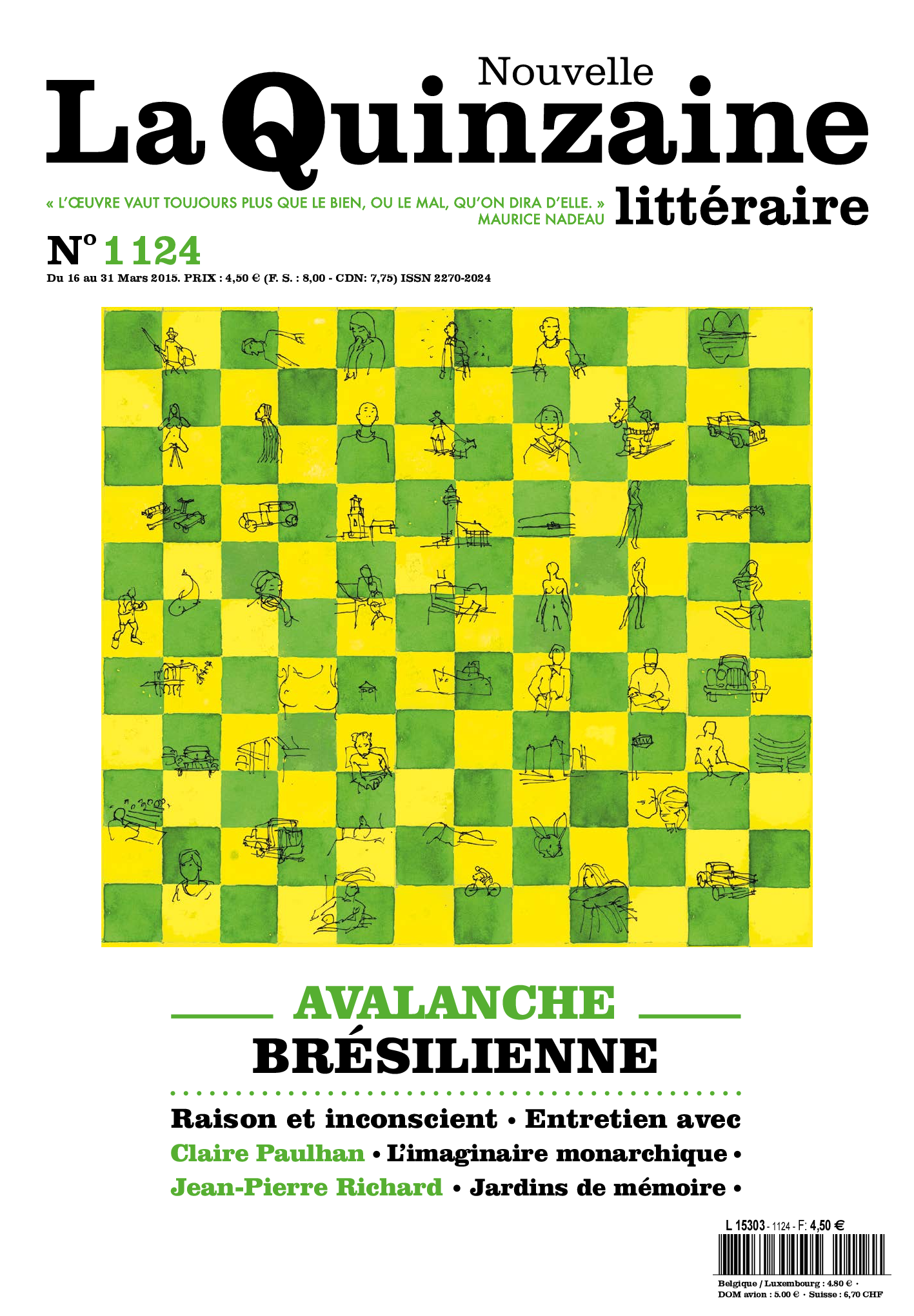

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)