Le grand intérêt de l’exposition que consacre à Paul Gauguin le Grand Palais tient à ce que, pour une fois, ce sont l’unité et la cohérence de cet itinéraire qui sont mis en valeur. On y va, comme dans toutes les expositions, pour y voir des œuvres singulières. Et l’on se trouve immergé, dès le début, dans un univers à la fois homogène et foisonnant grâce à la diversité des éclairages réunis : des tableaux certes, mais aussi des sculptures – dont certaines, très belles, sur bois –, des dessins, des carnets d’esquisses à l’aquarelle, le tout rythmé par des commentaires de présentation qui tissent la perspective de l’histoire de l’art dans l’itinéraire d’une vie.
C’est pourquoi le parcours est chronologique. Il mène des natures mortes – splendides et certainement sans équivalent dans toute la peinture de l’époque – à l’installation aux îles Marquises. Entre-temps, on aura vu l’art de Gauguin modelé par son expérience à Pont-Aven dans le voisinage d’Émile Bernard, auprès de qui il élabore un art « synthétique », presque abstrait, consommant sa rupture esthétique avec l’illusionnisme pictural. Puis l’art de Gauguin verse dans le symbole, devient plus décoratif et « idéiste », résultant d’une recomposition mentale du sujet dont il s’inspire. Et c’est précisément le caractère globalement abstrait et décoratif de l’art primitif qui aimante son voyage à Tahiti, où il se rend une première fois en 1891. Il devient alors, selon la juste formule de cette exposition, un « imagier des tropiques », combinant dans ses œuvres des motifs d’origine diverse – empruntés aux Marquises, à Tahiti, à l’île de Pâques… Il commence même à leur donner des titres en tahitien, signant par là son appartenance symbolique à cet art qu’il perçoit comme originaire. Admirateur de la grâce et de la douceur naturelle de ces contrées d’outre-mer, il se laisse séduire autant par la sensualité sans transgression des Polynésiennes – ce qui ne tardera pas à faire scandale – que par la mythologie du lieu. C’est une véritable expérience existentielle qu’il vit alors. Il la consigne dans un carnet où se mêlent récits et inventions, aquarelles et bois gravés. Le texte, passionnant, sera publié ensuite sous le titre Noa Noa (littéralement : « odorant », en tahitien). Gauguin réinvente largement les légendes et mythologies tahitiennes dans un panthéisme syncrétique depuis longtemps en latence dans ses créations. Avec des œuvres de plus en plus décoratives, souvent déployées en larges frises horizontales, le parcours s’achève dans la « Maison du jouir » sise aux Marquises, où il s’installe en 1901 et où il mourra.
Au terme de cet itinéraire, on en perçoit l’étonnante évolution : d’abord agent de change s’adonnant au dessin en amateur, Gauguin a forgé sa passion artistique dans le voisinage de Degas et des impressionnistes, qu’il a découverts grâce à Pissarro. Tous ses amis et initiateurs sont restés des peintres ; ils ont apporté des innovations proprement picturales : la lumière, les scènes de plein air, la fragmentation de la touche, l’introduction de la vitesse dans l’espace du tableau… La luminosité et le morcellement de la touche se retrouvent certes dans les premières œuvres de Gauguin, et surtout les natures mortes, mais sous forme d’une juxtaposition de traits verticaux finement parallèles et colorés, procédé que le peintre a systématisé avec grande intelligence, donnant à ses œuvres une vibration particulière et une intense vie intérieure : ces stries verticales presque imperceptibles opèrent de subtils mélanges de couleurs qui se déploient en arc-en-ciel ; et le geste pictural entre constamment en tension avec les courbes des objets représentés. En revanche, Gauguin va s’orienter de plus en plus vers une pratique de l’aplat, en accord avec le « synthétisme » qu’il ambitionne et le caractère décoratif et symbolique de sa peinture. La vibration viendra alors des accords de tons, subtils et détonnants, que Gauguin a toujours pratiqués, mais à moindre échelle au début : entre des roses tendres parfois totalement irréalistes et des jaunes envahissants, entre des bleus assourdis et des verts qui tirent l’œil. Il y a chez Gauguin une perception à la fois harmonisée et audacieuse de la couleur, qui est presque de nature musicale : elle fait penser aux accords dissonants mais toujours fluides et aériens de la musique française du xixe siècle, chez Berlioz et Debussy. Le séjour en Polynésie sera la rencontre avec un univers coloré à la mesure de cette perception native.
On peut dès lors se demander si, comme le suggère le sous-titre de l’exposition, Gauguin est bien un « alchimiste ». S’agit-il ici de transmuter la réalité, de la réévaluer, de l’idéaliser ou de la spiritualiser ? Bien plutôt d’en saisir l’unité et la cohérence par le prisme de l’art. Le symbolisme qu’a pratiqué Gauguin n’a rien des sophistications élaborées d’un Gustave Moreau. Il propose, par les moyens d’une très grande simplicité, une immersion dans la « forêt de symboles » – selon la formule de Baudelaire – qui préexistent dans la réalité « sauvage ». L’art primitif donne à lire le réel, à en percevoir les rythmes profonds. C’est cette ambition qui porte nombre d’œuvres au tracé sinueux, à la mise en page rustique et délicate, au chromatisme réduit mais devenu principe d’unité harmonique. La « sauvagerie » de Gauguin n’a rien de l’emportement de Van Gogh, nerveux et musculaire. Elle est une plongée dans un monde primitivement réconcilié.
C’est pourquoi Gauguin s’entoure de lui-même, élabore un monde à sa mesure : bien avant la construction de la « Maison du jouir », il réalise sur bois des meubles étonnants de vigueur et de rusticité symbolique (l’un porte, sculptées, les têtes de ses deux enfants). De même que la fréquentation d’un céramiste et d’un créateur de grès lui permit très tôt de réaliser des vases et objets familiers en terre cuite, dans des formes et avec des décors qui rappellent étonnamment l’artisanat primitif, où le souci décoratif le dispute à l’utilité. Une telle ambition ne peut être comprise d’une époque qui accepte les artistes en rupture (comme le fut pendant longtemps Claude Monet, avant que les Américains ne fassent sa fortune) à condition qu’ils respectent toujours les limites de leur art. Mais, chez Gauguin, la passion de peindre s’inscrit dans une ambition plus vaste, qui dépasse l’esthétique et refuse son autonomie. Le scandale Gauguin trouve peut-être ici ses racines les plus profondes : dans cette contestation frontale du mythe de l’autonomie de l’art, qui est précisément en train de s’installer avec les prémices de la « modernité » apportées par les impressionnistes.
« La nature est matière, l’esprit est matrice », a affirmé le peintre, selon le témoignage de Charles Maurice. Entre matière et matrice, le geste de Gauguin ne vise pas à opérer une sublimation, mais à réaliser une synthèse. D’où un symbolisme qui se nourrit de productions très rustiques, refusant la perfection maniériste et privilégiant les matériaux bruts comme le chanvre : il l’utilise de plus en plus pour ses toiles, laissant apparaître en dessous de la peinture les nœuds du tissage. De même, Gauguin se refusait à vernir ses œuvres, préférant les protéger sommairement et conserver leur matité par une couche de cire. Les gravures sont peut-être les plus démonstratives de ces choix : Les Laveuses, une zincographie, présente une déformation expressive du sujet inspirée sans doute des estampes japonaises, avec des superpositions audacieuses de plans différents et des changements d’échelle qui font penser à un art populaire. Même rusticité dans la technique de transposition d’un dessin sur plaques de verre, que Gauguin a inventée et qui ménage des transitions indécises entre espaces contigus. Par ces refus obstinés de la sophistication et le choix de la rusticité, l’œuvre de Gauguin prend à rebours toute une esthétique du « beau » qui convient idéalement à la morale bourgeoise. Il en arrive ainsi à une posture de victime sacrificielle, dont porte témoignage le poignant Portrait de l’artiste au Christ jaune, mille fois reproduit mais qui bouleverse toujours ; Gauguin y fixe sa mythologie personnelle. Il devient le grand damné et le sacrifié exemplaire. Dans ses autoportraits d’ailleurs, il ne se représente jamais parfaitement de face, mais presque toujours la tête tournée de trois quarts, l’œil inquiet, comme pris entre le regard du spectateur et l’invisible dont émerge, par-derrière, la figure de l’artiste. Gauguin se veut frère des exclus de la société, qu’il représente plusieurs fois, telle La Pauvresse (dit aussi Misères humaines) à qui il refuse toute caractérisation psychologique. Se détachant sur un fond rouge déployé comme une « gloire » religieuse, le personnage est à la fois allégorie et présence intense, nouées dans une dramaturgie du malheur.
L’étonnant est que, même si elles s’inscrivent dans des enjeux plus vastes, les œuvres de Gauguin brillent d’un éclat proprement esthétique qui se passe de toute connaissance des ambitions du peintre. Ainsi de l’exceptionnel Femmes de Tahiti (dit aussi Sur la plage) ; avec sa vision frontale, sa posture sculpturale, le refus du modelé sophistiqué, des accords assourdis de tons largement brossés, et un visage curieusement inexpressif, le tableau dégage le puissant sentiment d’une présence énigmatique, presque gênée, qui ne s’offre pas mais questionne indirectement le spectateur. De même pour Eh quoi ! Tu es jalouse ?, où l’audace d’un rose irréalistelargement étalé s’allie à des lignes ondoyantes qui se détachent sur un fond inidentifiable, tandis que les seins des deux femmes fixent la charge érotique du rêve exotique. Vers la fin, au moment où l’art de Gauguin s’oriente vers une esthétique de la fresque, de merveilleux tableaux fascinent le regard du spectateur, comme le tendre Vairumati, l’énigmatique Te Rerioa (qui signifie « le rêve ») et l’étonnant Cheval blanc, l’un des rares tableaux verticaux du peintre, où l’espace se confond avec la ramure déployéed’un arbre.
La puissance de séduction de toutes ces œuvres est parfaitement servie par le très beau catalogue édité en collaboration par le musée d’Orsay et la Réunion des musées nationaux. Avec une couverture cartonnée donnant à sentir sous les doigts le grain de la toile, un papier blanc cassé et mat, une typographie parfaitement lisible et en harmonie avec les gravures sur bois, il place les reproductions d’œuvres dans leur contexte esthétique, sans le brillant artificiel qu’on y ajoute souvent. Le rapport charnel de Gauguin aux différents matériaux de la création est ici parfaitement respecté, d’autant que sont représentées toutes les formes de productions : gravures de toute nature, sculptures sur bois, céramiques et grès, dessins et tableaux, alternent en permanence, permettant une véritable immersion dans l’univers de Gauguin, qui se révèle d’une envoûtante cohérence. Ajoutons que les présentations et commentaires sont d’une clarté aussi manifeste qu’efficace, croisant l’histoire, les techniques et l’esthétique dans un équilibre heureux. La dernière partie du catalogue, réunissant des « Essais », séparés du parcours de l’exposition mais toujours très illustrés, apporte d’ailleurs des éclairages passionnants sur les conceptions esthétiques de l’artiste, ses techniques et les conditions de réalisation. De quoi s’immerger avec autant d’intelligence que de bonheur dans cette création unique.
Daniel Bergez
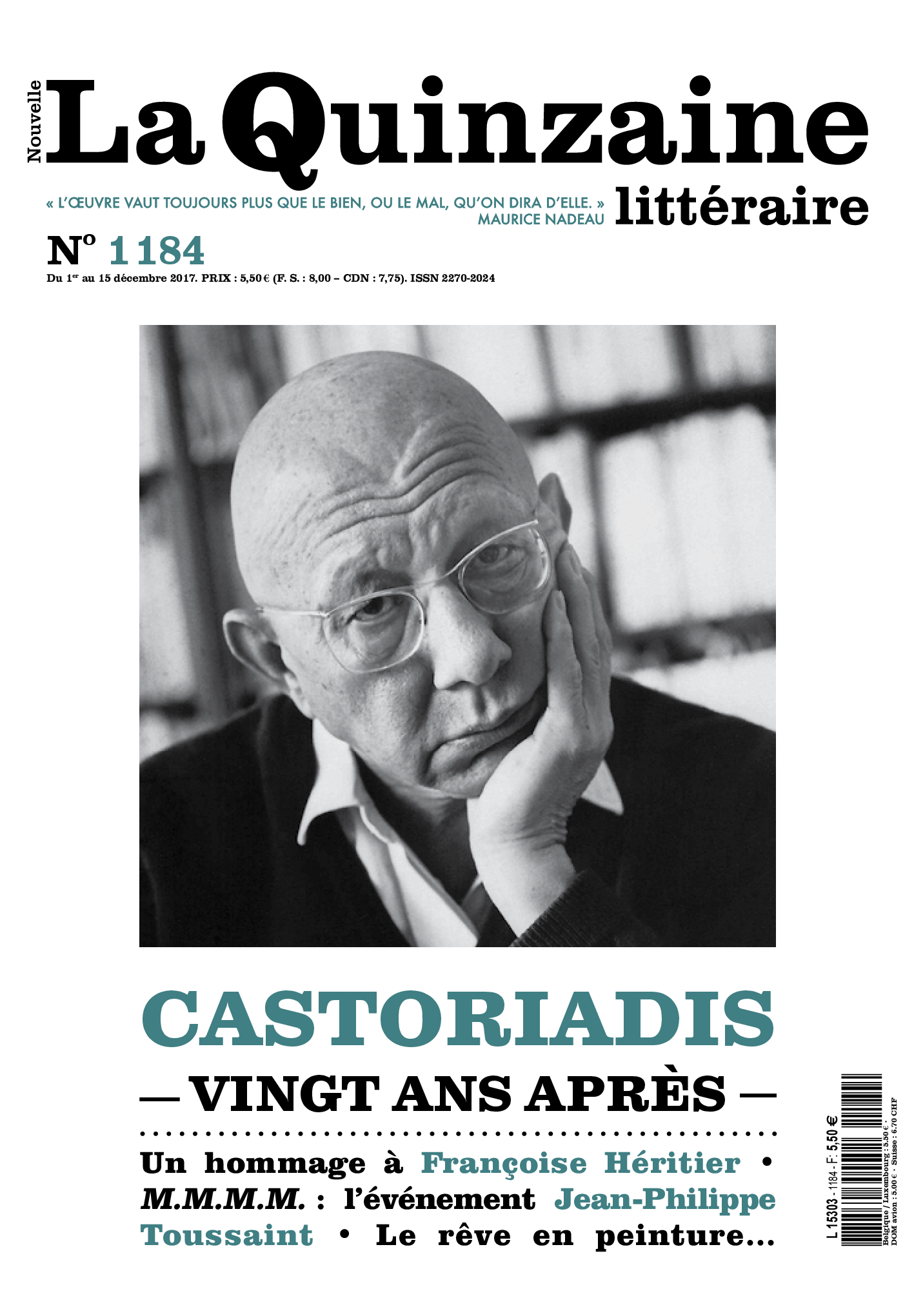

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)