La sélection des textes retenus a été assurée par Pierre-Emmanuel Dauzat, à qui l’on doit la plupart des traductions, et qui a préfacé avec beaucoup de précision toutes les œuvres ici retenues. Elles dessinent le spectre impressionnant des connaissances et centres d’intérêt de Steiner : le tragique, les Antigone, la question de la culture, celle de la destruction des Juifs, les problèmes de la traduction… On peut regretter que des livres comme Réelles présences ou Passions impunies ne figurent pas ici. Mais il est judicieux d’avoir terminé l’ouvrage par des textes d’intérêt autobiographique, où l’on voit Steiner faire le récit de son histoire intellectuelle, et tel Montaigne, mais sur le mode d’une fiction énigmatique, se préparer à la « mort amie ».
L’un des principaux axes d’étude de Steiner a été la tragédie. Dans un de ses ouvrages fondateurs, La Mort de la tragédie (dont le titre est un renversement de celui de Nietzsche), il montre que « la tragédie en tant que forme dramatique n’est pas une notion universelle ». Étrangère à la conception judaïque du monde (dans laquelle « Jéhovah est juste, même dans Sa colère »), elle repose sur une « vision de la vie humaine conçue comme un châtiment arbitraire ». Au long d’un parcours historique mené avec souplesse et servi par une grande connaissance des textes, Steiner éclaire les tragédies anglaises, françaises et allemandes. Au passage, il réargumente même brillamment le fameux parallèle entre Corneille et Racine : chez celui-ci, « tout ce qui arrive, arrive à l’intérieur des mots ».
L’une des explications de la « mort de la tragédie » est liée à la nouvelle idéologie véhiculée par le romantisme : l’homme romantique, « c’est Narcisse dans la poursuite acharnée et l’affirmation de son identité unique entre toutes ». Comment une telle valorisation du moi individuel aurait-elle pu s’accorder à un théâtre fondé sur l’altérité – puisque nous n’avons pas besoin de connaître Racine pour être saisis par les personnages d’Iphigénie et de Phèdre ? De plus, comme « la tragédie est cette forme d’art qui exige l’intolérable fardeau de la présence de Dieu » (Steiner affirme qu’il n’y a pas d’art sans rapport à la transcendance), le genre était naturellement condamné en une époque qui a proclamé la « mort de Dieu ».
La tragédie, disparue ou presque de l’écriture littéraire, s’est rejouée dans l’histoire réelle au XXe siècle : « Durant l’Holocauste, le Gitan, ou le Juif, avait très précisément commis le crime d’exister. » C’est ce que Steiner nomme une « tragédie absolue », comme on peut le dire aussi d’Œdipe roi et d’Antigone. Né en France de parents juifs, il n’a cessé de s’interroger sur la condition juive à partir de l’innommable de la Shoah. Posant que la vérité du judaïsme se trouve dans l’errance, en rappelant « l’éternelle nécessité pour Abraham d’abandonner sa tente pour rejoindre la route », il n’hésite pas à développer une pensée largement hétérodoxe et polémique. Il met en cause l’État d’Israël comme contraire à cette loi de l’errance. Et il affirme que la raison essentielle de l’antisémitisme réside non pas dans l’accusation d’avoir tué le Christ, mais dans l’invention, contraire à la familiarité des dieux païens, d’un Dieu à la fois incompréhensible et terrible : « S’il est une théologie juive, elle est négative. » Dans une fiction qui a déchaîné les passions, Le Transport de A. H. (c’est-à-dire Adolf Hitler), Steiner avait même suggéré un portrait de Hitler en Messie inversé, légitimant le judaïsme par la souffrance infligée. De ce roman, les Œuvres ne retiennent que le monologue d’un survivant, Lieber, énumération pathétique et hallucinée, à la limite de l’insoutenable, de toutes les souffrances et abominations subies par les Juifs durant la Shoah : « jusqu’à ce que chaque nom revienne à la mémoire et soit prononcé jusqu’à la dernière syllabe, il n’y aura pas de paix pour l’homme sur la terre […] les syllabes écriront le nom caché de Dieu ».
La réflexion de Steiner sur l’insupportable silence de Dieu durant la Shoah a croisé son attention à la question de la poésie. Il l’avait longtemps appréhendée via la versification tragique, justifiant au passage le choix de l’alexandrin dans la tradition française : dans le prolongement de Valéry, il affirme que la prose est asservie aux relations de cause à effet, alors que « la syntaxe du vers est en partie libérée de la causalité et de la temporalité ». Dès lors, s’il est vrai que le vers opère une simplification de la peinture de la réalité, il produit en retour des significations multiples qui donnent « de la vie une image beaucoup plus dense et complexe ». C’est en commentant le poète allemand Paul Celan (émigré en France, où il s’est suicidé en 1970) que Steiner explora la poésie comme problématique, et question posée sur la possibilité même de la parole. « Comment un Juif peut-il parler de la Shoah dans la langue des assassins ? […] Il se peut que persiste la compulsion à la parole articulée propre au judaïsme, son exigence de dialogue même avec, même contre, un Dieu muet. »
La réflexion de Steiner sur la poésie est aussi liée à son expérience précoce de la diversité des langues. La mère de Steiner, en effet, « viennoise jusqu’au bout des ongles, commençait habituellement une phrase dans une langue pour la finir dans une autre ». L’épreuve de la traduction articule ainsi en profondeur toutes les interrogations du critique. Il évoque la « catastrophe de Babel », qui a remplacé l’homogénéité de la vérité divine par « un patchwork d’approximations, de méprises ». Mais ce désastre s’inverse aussi par ce qu’il nomme une « joie agissante » dans le questionnement du sens, qui touche au fondement de notre humanité. En cela Steiner est certainement l’un des plus profonds continuateurs des humanistes de la Renaissance, pour qui l’interrogation sur le langage était la tâche humaine essentielle. Pour lui « la grammaire […] est le nerf de la pensée ». Comparant la civilisation occidentale, héritière de la Grèce antique, et les métaphysiques orientales marquées par le bouddhisme et le taoïsme – qui assimilent l’acte contemplatif suprême au silence qui délaisse les mots –, Steiner rappelle la conception hellénistique du logos, à laquelle « la civilisation occidentale doit son caractère essentiellement verbal » : « C’est la racine et l’écorce de notre expérience. »
Ainsi, Steiner est d’autant mieux armé pour analyser les symptômes et les causes de l’affaiblissement actuel du logos, qu’il nomme la « retraite du mot » : elle remonte selon lui au XVIIe siècle, à une époque où des pans entiers de la réalité et de la vérité échappent au domaine verbal, notamment grâce à la sophistication des mathématiques qui deviennent un langage à part entière, totalement intraduisible dans une autre langue : « des zones étendues de la connaissance et de la praxis appartiennent maintenant à des langages non verbaux ». D’une façon que l’on pourra juger sommaire, ou partiale, Steiner voit les conséquences de cette réduction du verbal par rapport à l’étendue du réel dans l’évolution du discours philosophique, le développement de l’art moderne, et ce qu’il perçoit comme l’exténuation actuelle de la production littéraire, faisant porter sur notre civilisation la menace de « périr par le silence ».
Chez Steiner s’associent assez curieusement la verve polémique et l’humilité intellectuelle : « Nous sommes tous les hôtes de la vie. Aucun être humain ne sait le sens de sa création. » Cela le pousse – et l’on pense ici aussi à Montaigne – à avouer ses faiblesses, comme lorsqu’il affirme avoir formé nombre d’étudiants plus doués que lui, ou qu’il se dit « très probablement, un couard ». Il peut aussi se rétracter et confesser ses erreurs, comme dans son volume d’Errata. Récit d’une pensée. Il ne recule même pas devant la contradiction exhibée, notamment pour tout ce qui concerne la civilisation moderne : ainsi, après avoir vitupéré contre l’invasion sonore des villes (« Le bruit […] est la peste bubonique du populisme capitaliste »), il n’hésite pas à composer une sorte de poème en prose à la manière de Baudelaire pour dire le chatoiement sonore des langues de toutes sortes, cette « pulsation de la parole » qu’il perçoit dans un quartier juif de New York. Chez Steiner cohabitent ainsi un moraliste indigné et un poète qui peut s’enchanter esthétiquement de tout ce qu’il perçoit.
Cette humilité et cette lucidité sont les corollaires d’une grande liberté critique. Steiner peut par exemple affirmer que « Claudel est un écrivain exaspérant. Il est pompeux, intolérant, emphatique, dilettante, prolixe » ; cela ne l’empêche pas d’apprécier son théâtre à sa juste valeur, dans des pièces qui « sont à l’échelle du monde », où le dramaturge « recourbe l’arc du temps », et dans lesquelles « le flux dramatique circule […] pour se ramasser en des instants culminants d’incantation lyrique ».
Ces images le montrent : la pensée chez Steiner n’est jamais une abstraction qui menace de détruire son objet – il a d’ailleurs des mots très sévères à l’encontre du post-structuralisme et du déconstructionnisme, auxquels il oppose l’évidence que « le sens est aussi étroitement lié aux circonstances, aux réalités perçues […] que l’est notre corps ». Sa réflexion sur la littérature emprunte donc à celle-ci un art de la formule et des images. Cette critique se construit par métaphores inventives et riches synesthésies. Ainsi lorsqu’il affirme que revivent dans Montherlant « la résonance métallique et la cruauté cérémonieuse de Sénèque », ou lorsqu’il parle avec une égale justesse imagée de la « ferme mais délicate ossature » que l’alexandrin classique a donnée au discours français. Steiner pratique une critique « poétique », au sens où elle sollicite un imaginaire et une invention de la langue. Loin de toute tentation abusivement théorique, il reste ainsi fidèle à cette « intuition saisie d’impatience » qu’il revendique pour sa démarche.
L’impatience n’exclut pas la culture. Elle est chez lui très grande et il sait, avec une élégance rare, en condenser la matière jusqu’à la faire oublier, et en articuler les différents plans. Dans sa réflexion, la philologie nourrit l’herméneutique, l’analyse est au service d’une perception esthétique, l’histoire des idées et l’histoire des œuvres s’entrecroisent constamment, à la manière d’une riche polyphonie. Sa proximité avec l’école de Francfort rejoint sur ce plan sa sensibilité et sa culture musicales qui lui apprennent à associer la résonance à la rationalité. Rares sont en France, et au xxe siècle notamment – en dehors de Claudel, Barthes, Genette et quelques autres –, les écrivains ou critiques capables de parler avec compétence, et une précision analytique, de la musique. On apprécie d’autant mieux les commentaires par Steiner du Moïse et Aaron de Schönberg, considéré sous l’angle de l’« interaction de la musique et du langage ». Il affirme d’ailleurs qu’« en Occident, une part considérable de la littérature et de la littérature mise en musique vient de la matière d’Orphée ». Ce mythe a déterminé « la sténographie, l’encodage fondamental et la cartographie intérieure de notre psyché ».
C’est d’ailleurs significativement à propos de la musique qu’il formule le plus clairement son rapport esthétique et sensible aux œuvres. Partant du principe que « toute expérience modifie notre conscience », et parce que « l’être personnel est processus », il évoque « la collision entre la conscience et la forme signifiante, entre la perception et l’esthétique […]. Nous sommes “accordés” par la musique qui nous possède ».
Daniel Bergez
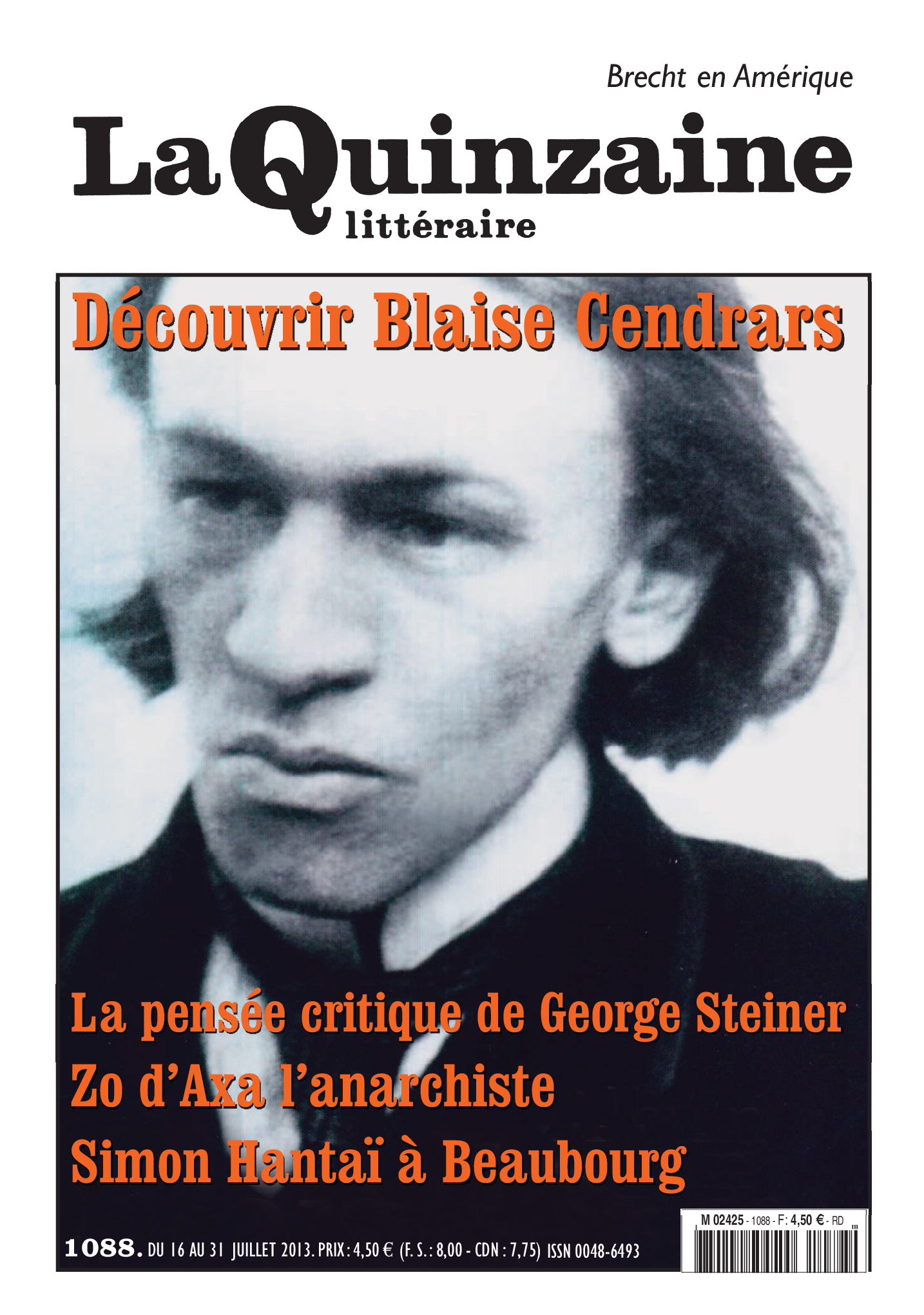

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)