Ravagés de splendeur résonne avec Fantaisies guérillères, le premier roman de l’auteur. Les deux titres, formés sur un oxymore, soulignent le goût de l’auteur pour la rencontre de la comédie et de la tragédie dans des récits qui revisitent des figures historiques controversées, en l’occurrence les figures sacrificielles de deux jeunes héroïnes au destin tragique, Jeanne d'Arc et Héliogabale, inscrites dans deux époques charnières, le Moyen-Âge tardif et le Haut Empire romain. Outre l’extrême jeunesse des héroïnes mortes l’une à 18 l’autre à 19 ans, ce qui les rapproche est leur rapport au pouvoir, l’une est faiseuse de rois, l’autre impératrice, leur lien très étroit avec le mysticisme et la religion, l’une porte la voix du dieu chrétien, l’autre fait entendre celle de Baal, leur rapport à la violence et à la mort, une sexualité atypique (Lebrun fait de Jeanne une lesbienne et met en scène une Héliogabale transgenre affamée de sexualité sadomasochiste) et une mort violente, l'une par le feu l’autre par le fer.
Le lecteur qui a été emporté dans un Moyen-Âge déjanté par l’alacre création de médiévismes dans Fantaisies guérillères retrouve le goût de Guillaume Lebrun pour le plaisir subversif et irrévérencieux du mélange de l'inscription du récit dans une époque et les anachronismes assumés des références à la culture populaire, que ce soit aux tubes des années 1970 ou au cinéma des années 1980 comme aux Rolling Stones, à Cher puis à Madonna dont il feint de traduire en latin l’un des tubes. Il faut souligner que les latinismes sont présents chez Lebrun dès son premier roman : la tournure syntaxique typiquement latine qui donne le titre si particulier de Ravagés de splendeur émaille Fantaisies guérillères : ainsi la victoire contre les Anglais la laisse « esbardaillée de joie ». Il y a, comme nous le voyons, une profonde continuité entre les deux romans dont la trame est la mise en valeur des femmes et de la sororité ; la virginité des compagnes de Jeanne d'Arc et des Vestales les préserve de la maternité et des violences masculines, en fait des femmes libres et puissantes, ce qui est un thème fort pour Lebrun : « vous ne vêlerez point en cette vie... ». Fantaisies guérillères s'achève sur le début d’un pseudo livre au titre détourné du grec Plutarque : Nouvelles vies parallèles des femmes illustres. Ce pseudo livre inachevé semble tisser ensemble Fantaisies guérillères et Ravagés de splendeur, qui pourraient s'y insérer.
Avec Ravagés de splendeur, dans un roman en six chapitres entrecoupés de recettes romaines inspirées d’Apicius, roman choral qui fait entendre Héliogabale, son épouse Aquilia et son amant Hiéroclès, Lebrun trouve une correspondance entre sa manière et son sujet : pétri de culture classique, de références et de questionnements de notre époque, il invite le lecteur à les revisiter en se plongeant dans la Rome du IIIe siècle, où une aristocratie terrifiée d'être « grand remplacée » voit arriver au pouvoir un Syrien, qui apporte avec lui le bétyle du culte de Baal, qui s'avère être une femme transgenre en plus d’être « racisée », qui impose le féminin dans les actes impériaux, qui se marie deux fois avec la grande Vestale, et qui légitime par son exemple une vie orgiaque et hybristique culminant par une naumachie dionysiaque dans un Colisée rempli de vin.
Le pouvoir des femmes au travers des Julia de la dynastie des Sévère reprend un thème majeur de l’auteur, mais la figure d’Héliogabale lui permet de faire entrer son lecteur dans la peau de personnages hors normes. C’est ainsi que se définit son héroïne : « hors des normes avec joie, anormale non ». Et elle va vers des amours qui lui ressemblent : sa femme, la grande prêtresse Aquilia est « formidablement laide » et son amant : « c’est un monstre [...] Même sans artifice, il est parfait en tous points [...] ». Et le récit nous montre l’épanouissement de ce trouple soudé malgré la sexualité boulimique d’Héliogabale et par la relation sadomasochiste entre l’impératrice et Hiéroclès.
Lebrun décrit avec précision, dans une prose poétique où les mots se font chair, toutes les pratiques sexuelles anomiques de l’impératrice autant que ses pratiques religieuses macabres : le sacrifice d’enfants à Baal, en écho avec la description qu’en fait Flaubert dans Salammbô, atteint un degré baudelairien d’esthétique macabre. De manière tout aussi provocatrice Lebrun dénonce, en écho au titre du roman, derrière la splendeur romaine, une invisibilisation de ce qui l’a produite : « Rome est d’une beauté éprouvante [...] j’aspire à une difformité qui me ferait détourner les yeux [...] la trace immarcescible des viols subis dans le silence des villas, la fracture, les pillages et les cris [...] Ici, en plein soleil, on se doit d'être ébloui par les pierreries et anesthésié par la quiétude ». C’est cette violence systémique qu’Héliogabale exprime après avoir écouté le récit de la prostituée Hista : « Moi aussi je descends de Marc-Aurèle. Nous sommes censées faire partie de l’Empire, nous sommes appelées citoyennes de Rome. Mais ce n'est pas le cas aux yeux de tout le monde. Même impératrice je ne suis qu’une Syrienne ».
Ce roman fait de cris et de fureurs est aussi un roman élégiaque dont la puissance d’effacement du temps est le personnage principal : c’est ce que dit Hiéroclès : « tout comme à Aquilia, vos livres d’histoire m'accordent quatre lignes ». Au chapitre 4, il revendique la parole, au nom de « la marge décadente de notre espèce » pour la faire exister avant que « les monstres grouillants du Tartare se frayent un chemin jusqu’à nous » : « bientôt ils seront là, nous ne serons plus ». On entend Horace et Virgile dans les mots de Lebrun. Et l’excipit vibre de ce cri silencieux : « À la fin il ne restera rien. Plus personne ne sera capable d'entendre le hurlement des fantômes ». Face à l’angoisse de l’effacement inéluctable, deux réponses sont proposées : le plaisir du corps (« c’est une sensation extraordinaire de baiser et d’être baisé jusqu'à l’inconscience ») et la tranquillité de l’esprit (« tu veux, toi, jouir [...] Ce que je souhaite moi c’est la tranquillité d'esprit. Savoir le soir qu’il y aura pour de vrai un matin jusqu’à ce que la vieillesse m’emporte »). Passions et sagesse, les personnages de Lebrun sont des incarnations de la philosophie antique.
Pour conclure, Ravagés de splendeur est une œuvre métisse, baroque, qui assume de choquer par son refus des tabous mais se veut aussi la porte-parole des sans-voix de l’Histoire. C'est une œuvre qui revendique une liberté absolue de vision, de forme et de ton comme son héroïne et qui espère, comme elle, agrandir chez les autres leur compréhension du monde et de la société, quitte à prendre, comme elle, le risque de ne pas être comprise mais rejetée. C’est peut-être ce qui amène Lebrun à prêter ces mots à Hiéroclès : « si le terme christ n’avait pas été détourné par deux millénaires aux limons sédimentés dans vos crânes, c’est à elle qu’il aurait été offert ». Face à la fermeture de l’aristocratie romaine qui s’arcboute dans sa peur d’être « grand remplacée » elle donne à voir « Ouranopolis, Rome, la ville monde » et affirme que « soit nous acceptons ensemble d’être Rome, soit nous mourrons ensemble ». Elle crie la légitimité d’avoir un corps correspondant à son genre : « je ne veux pas ressembler à une femme, je suis une femme, je veux ce que les femmes ont entre les cuisses, pas pour satisfaire un homme, pour être moi, pour me sentir moi ». Ravagés de splendeur est donc une œuvre qui engage ses lecteurs, « esprits avinés de lumière mais coincés à l’intérieur de ces prisons d’os et de peau », à lutter contre tous les déterminismes.
Franck Colotte

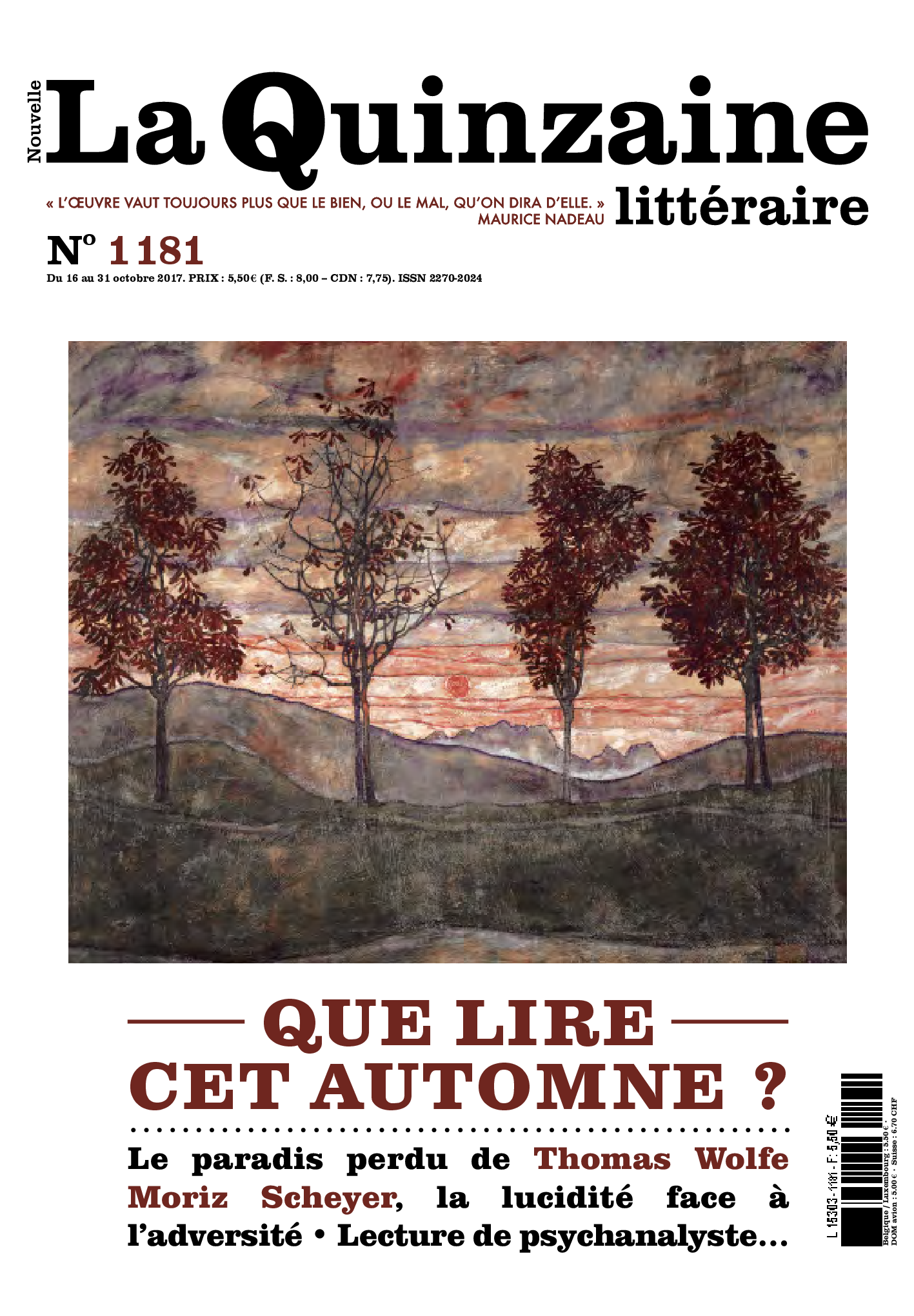
Commentaires (identifiez-vous pour commenter)