Dans un essai célèbre de 1939, le critique d’art américain Clement Greenberg soutient que le kitsch est rendu possible par une tradition culturelle pleinement adulte, dont il détourne à son avantage les inventions, en opérant par formules. Greenberg classait en vrac les comics, les claquettes, la pulp fiction et les films d’Hollywood comme des produits typiques du kitsch. Mais Hollywood a fini par produire de l’art adulte, et il ne nous viendrait pas à l’esprit de caractériser comme kitsch les films de Ford, Hawks, Hitchcock ou Mankiewicz, bien que la question se pose pour ceux de Lubitsch et de Cukor. En revanche, c’est dans cette catégorie qu’on range immédiatement les films de Quentin Tarantino, Tim Burton ou Wes Anderson.
Ces cinéastes pratiquent même le « métakitsch ». Ils partent d’un matériau kitsch de premier degré, celui de la pop culture, de la bande dessinée et des films de série B. Anderson ne semble pas, de prime abord, procéder autrement. D’un film à l’autre, il ne cesse de pratiquer l’art de la citation et de l’autocitation, répète les mêmes gimmicks, joue sur la nostalgie musicale (le rock des sixties), sur le fétichisme des objets et des costumes, recycle des acteurs célèbres de film en film (Bill Murray), et se trouve, comme Burton, très à l’aise dans le cinéma d’animation (Fantastic Mr. Fox). Comme le dit Roger Scruton, « le monde du kitsch est un monde de faire-semblant, d’enfance permanente, dans lequel c’est Noël tous les jours ».
Mais, malgré les apparences, l’univers pour enfants attardés d’Anderson est très différent de celui de Burton. Il a une dimension morale, un esprit qu’on ne trouve pas chez les autres cinéastes kitsch contemporains. Les héros d’Anderson sont tous des enfants qui ont du mal à grandir ou des adultes qui ne savent pas comment éduquer leurs enfants. Tous croient qu’une promesse est une promesse, et qu’il y a un ordre éthique dans les choses. Quand, dans Moonrise Kingdom, le chien meurt d’une flèche perdue, Lucy demande : « Était-ce un bon chien ? » Et la fuite des enfants ressemble à celle de Huckleberry Finn ou de Holden Caufield, mais aussi à celle de Black Jack de Ken Loach.
Anderson construit des décors de maison de poupée, des mondes en miniature qu’on a souvent comparés aux boîtes surréalistes de Joseph Cornell, mais qui contiennent des bons et des méchants. Son univers est celui de la moralité subjective. C’est, comme celui des dessins de Norman Rockwell et de Charles Schultz, un univers puritain, qu’on contemple et qu’on juge de haut (par les fameux plans pris de dessus à la verticale, qui sont devenus sa marque de fabrique). La vie morale des personnages d’Anderson est cependant aux antipodes de celle que Stanley Cavell prête aux personnages hollywoodiens des comédies de remariage : à la différence de ceux-ci, ceux-là ne cherchent pas à se perfectionner ou à devenir meilleurs : ils cherchent simplement à être justes dans leurs sentiments, qui sont souvent ceux qu’ils avaient étant enfants.
La cohorte des hipsters qui vouent un culte à Anderson (dont l’auteur de ces lignes avoue faire partie) retrouvera dans The Grand Budapest Hotel les obsessions familières du cinéaste texan (moins la musique rock, la bande-son étant ici confiée au seul Alexandre Desplat). Comme avec la New York imaginaire de The Royal Tenenbaums, avec la Calypso de Cousteau réinventée dans Aquatic Life, avec l’Inde de Darjeeling Limited, avec l’île de la Nouvelle-Angleterre de Moonrise Kingdom, il s’agit de recréer un monde perdu imaginaire avec force détails loufoques.
Ici, c’est celui de la Mitteleuropa des années trente située dans une Ruritanie à nom de vodka (Zubrowka) et composée de souvenirs des Alpes autrichiennes, de Prague, de Karlsbad et de Zakopane, avec des allusions explicites au Monde d’hier de Stefan Zweig et à ses romans à l’eau de rose (eux-mêmes assez kitsch). Le film est un emboîtement de récits : il commence avec une petite fille qui se recueille sur la tombe d’un écrivain auteur d’un livre dont le titre est celui du film, puis nous transporte chez l’écrivain en question au soir de sa vie, lequel narre l’histoire de sa visite au jeune homme du Grand Budapest Hotel et de sa rencontre avec le propriétaire, Zéro Moustafa (F. Murray Abraham), qui lui raconte sa propre histoire. C’est celle de son amitié avec M. Gustave (Ralph Fiennes), concierge français de l’hôtel au temps de sa splendeur, et qui en régit toute la vie, des domestiques aux clients et surtout aux vieilles habituées qu’il séduit en gigolo averti. L’une d’elles, Madame D. (Tilda Swinton), meurt et lui lègue un tableau inestimable, au grand dam des héritiers. Aidé de Zéro, Gustave parvient à subtiliser le tableau. Poursuivi à la fois par les soldats zubrovkiens aux allures nazies et par Jopling, l’homme de main des héritiers (William Dafoe), il est enfermé dans une forteresse dont il s’évade, rejoint le Grand Budapest Hotel et découvre que le tableau contenait une lettre lui léguant l’hôtel entier. Avant d’être arrêté et déporté, il cède l’hôtel à Zéro, inconsolable.
Comme d’habitude chez Wes Anderson, l’intrigue est simple : enfant à la recherche d’un père, amours adolescentes, poursuites. La complexité du film apparaît dans les détails, la galerie des personnages et les sous-intrigues : l’organisation minutieuse du palace par Gustave, son raffinement (il se parfume à « l’air de panache »), l’amour de Zéro pour la jeune pâtissière Agatha (Saoirse Ronan), qui « a sur la joue une tache de vin de la forme du Mexique », l’assassinat du notaire intègre Kovacs (Jeff Goldblum) par l’infâme Jopling, l’évasion de Gustave d’une prison ressemblant au château de Kafka, l’aide de la confrérie des concierges, représentée par Ivan (Bill Murray). Le film est truffé de réminiscences, outre à Zweig, au Prisonnier de Zenda, au Sceptre d’Ottokar, à Lubitsch (To be not not to be), à Frank Borzage (The Mortal Storm), ou à l’hôtel déserté du Shining de Kubrick.
Le petit univers en carton-pâte du Grand Budapest Hotel, avec la pâtisserie Mendl et ses gâteaux sophistiqués, les costumes violets de ses domestiques, est le sommet du kitsch. Hermann Broch, dans un essai célèbre (1951), disait : « Le système du kitsch est un pseudo-système. Il exige de ses partisans “Fais du beau travail” alors que le système de l’art a pris pour maxime le commandement éthique : “Fais du bon travail”. » Il fait de l’esthétisme, alors que l’art vrai respecte les valeurs intellectuelles et morales au même titre que les valeurs esthétiques.
Ce qui sauve Anderson du kitsch vulgaire est qu’il fait aussi du bon travail. Le film menace sérieusement de basculer dans du Spielberg (surtout dans la course poursuite finale, mais aussi dans les références à La Liste de Schindler, où Fiennes incarnait un mémorable nazi), mais Anderson se rattrape dans sa description du monde d’hier à travers l’évocation du palace délabré et de son faste passé, l’amitié du lobby boy et du concierge, le contraste entre ceux qui ont une parole et des principes (Kovacs, Ivan, Agatha, M. Serge) et les cupides héritiers de Madame D. assistés par les nazillons, et surtout à travers son humour désenchanté, la suggestion que, au-delà de la perte de l’univers européen d’avant-guerre déplorée par le fantôme de Stefan Zweig, le Grand Budapest Hotel n’est autre que l’Europe d’aujourd’hui, vouée au même sort.
- On aura une idée du degré qu’atteint ce culte en lisant le volume de Matt Zoller Seitz, The Wes Anderson Collection, Brams, New York, 2013.

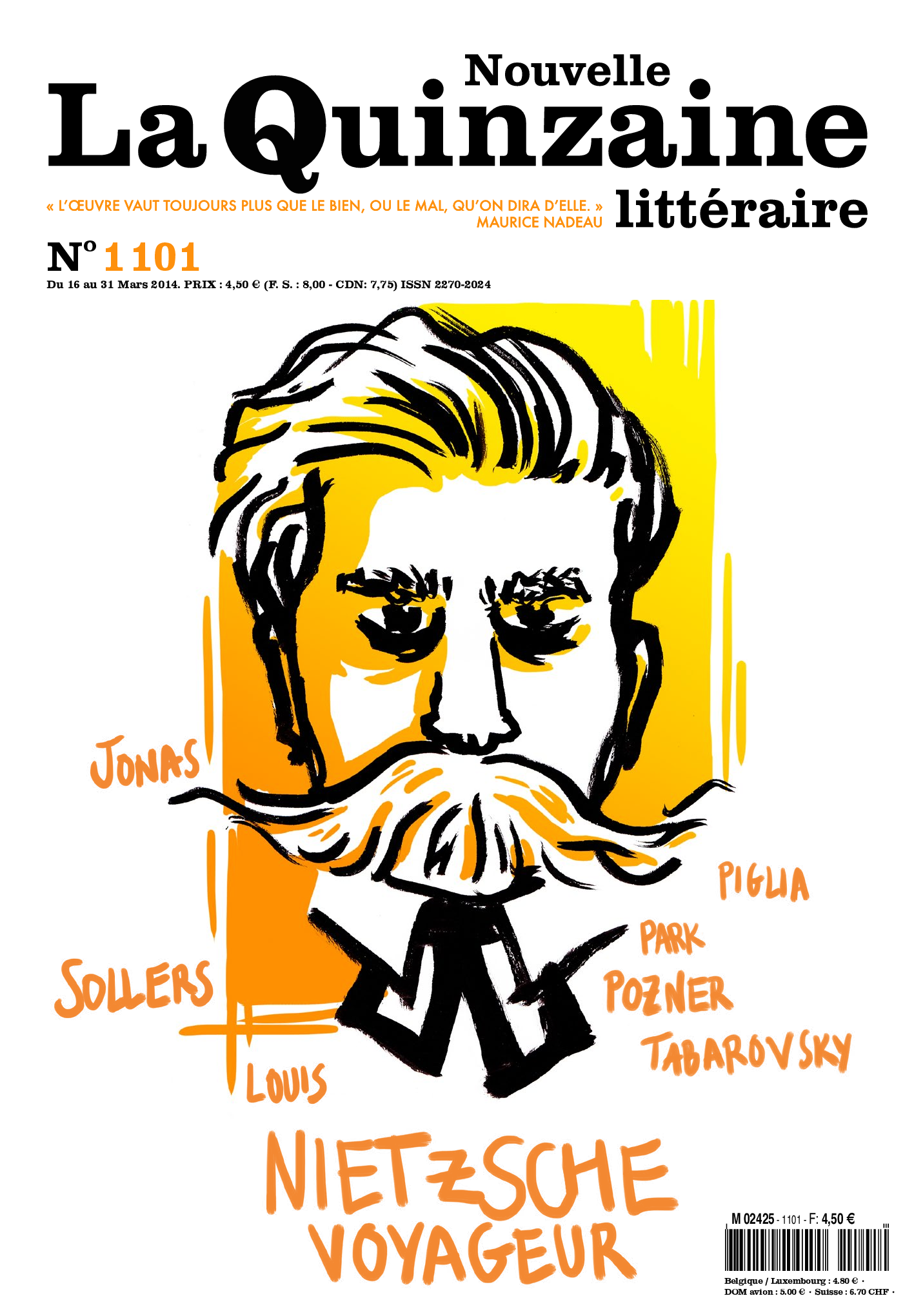

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)