À quoi ressemble l’Algérie à l’orée des années 1960, un pays que s’apprêtent à quitter, dans le désespoir et l’amertume, 700 000 pieds-noirs ? Des Français qui pourvoyaient, par leur travail et leurs compétences, aux besoins du pays et s’attelaient à la gestion de ses infrastructures. Il s’agit principalement de cadres et de techniciens. « En face, côté algérien, personne n’est prêt à prendre la relève. » En effet, « La clochardisation de l’Algérie, décrite par Germaine Tillion au milieu des années 1950 n’est pas un vain mot. Les SLE (sait lire et écrire) » sont rarissimes. « Selon les estimations officielles françaises, en 1954, seulement 14,6 % des enfants algériens étaient scolarisés dans les écoles françaises. » À la veille de l’indépendance, l’Algérie disposait de « 3 110 ingénieurs et assimilés européens contre 33 ingénieurs et assimilés musulmans. » Si, pour les techniciens, l’écart est moindre, il n’en reste pas moins éloquent : « 3 310 européens contre 315 musulmans. Hôpitaux, écoles, usines, magasins, ateliers… tout est à l’avenant ». En l’espace de quelques semaines « 70 % des commerçants et des chefs de petites et moyennes entreprises ont mis la clef sous la porte (…). Sur un peu plus de 9 millions d’Algériens de l’époque, – dont la moitié a moins de 20 ans – on compte plus de 2 millions de chômeurs ».
Les problèmes de la jeune nation algérienne s’expliquent par les séquelles d’une colonisation qui a privé un peuple de ses terres et visé la dépersonnalisation de l’indigène sans lui donner la possibilité d’accéder pleinement à la citoyenneté française avec les droits qu’elle implique, droit à l’éducation, au savoir, à la formation entre autres. « Chassés de leurs terres par la conquête coloniale, décimés par la misère et la guerre, entassés dans des camps de regroupement en 1960, illettrés, sous-payés, les Algériens sont donc incapables de pallier le départ des pieds-noirs. » Un pays de surcroît gangrené par la misère, le retour massif des réfugiés des frontières, le chômage endémique, la malnutrition et les luttes pour le pouvoir. Sans oublier les maquisards de la dernière heure et les légions de « profiteurs » qui espèrent tirer parti de la situation. Un pays en pleine tourmente, telle apparaît l’Algérie en cet été 1962.
Dans ces circonstances dramatiques, les Algériens ne sont pas seuls. Ceux qui ont appuyé l’insurrection algérienne, anciens porteurs de valises du FLN, communistes en rupture de ban, trotskistes, tiers-mondistes, anticolonialistes de toutes obédiences ne restent pas l’arme au pied. Journalistes, médecins, enseignants, techniciens, ingénieurs, ils sont nombreux à se persuader que l’Algérie est le laboratoire de la révolution et du socialisme. « Alger, c’était La Havane » s’écrie l’un d’eux. Si certains se montrent soucieux de réparer les dégâts du colonialisme, d’autres ont transféré le rôle prétendument messianique d’un prolétariat européen embourgeoisé à la paysannerie algérienne.
Ces jeunes pieds-rouges qui ne manquent ni de conviction ni de motivation, prennent des initiatives hardies. Si certains constituent un foco en Kabylie, dans la pure tradition du Che, – un foco construit avec un amateurisme frisant l’inconscience qui sera vite démantelé par la sécurité militaire algérienne –, d’autres se lancent dans le cinéma ou le journalisme. Sous la houlette de Jacques Vergès, l’avocat des militants du FLN, Juliette Minces, Georges Arnaud, Gérard Chaliand, Siné, Kateb Yacine contribuent à faire de Révolution africaine un magazine stimulant qui bouscule bon nombre d’idées reçues et agite des questions hétérodoxes. « Révolution africaine, note l’auteur, représentait “une presqu’île de modernité” ». Au début de l’année 1963, Claude Sixou analyse dans les colonnes du magazine « la manière dont la France et les compagnies pétrolières profitent, au détriment de l’Algérie des ressources en gaz et en pétrole ». L’article fera grand bruit et le numéro sera saisi. Quant aux communistes d’Alger Républicain, après avoir fait preuve pendant la guerre d’une méfiance excessive à l’encontre des nationalistes, ils se montrent à l’égard du FLN triomphant d’une servilité qui ne suffira pas à les sauver.
En 1963, le Parti communiste algérien est interdit. Ben Bella se comporte de plus en plus comme un dictateur d’opérette. Il cumule bon nombre de postes ministériels et s’aliène ce faisant ses propres partisans. En sifflant la fin de la partie, le 19 juin 1965, le colonel Boumediene aura beau jeu de stigmatiser l’amateurisme et le manque de sérieux du régime qu’il a renversé. Pour les pieds-rouges, l’irruption de l’armée sur la scène politique signe la fin des utopies qui s’éteignent, en 1969, avec les derniers feux du festival panafricain.
Omar Merzoug
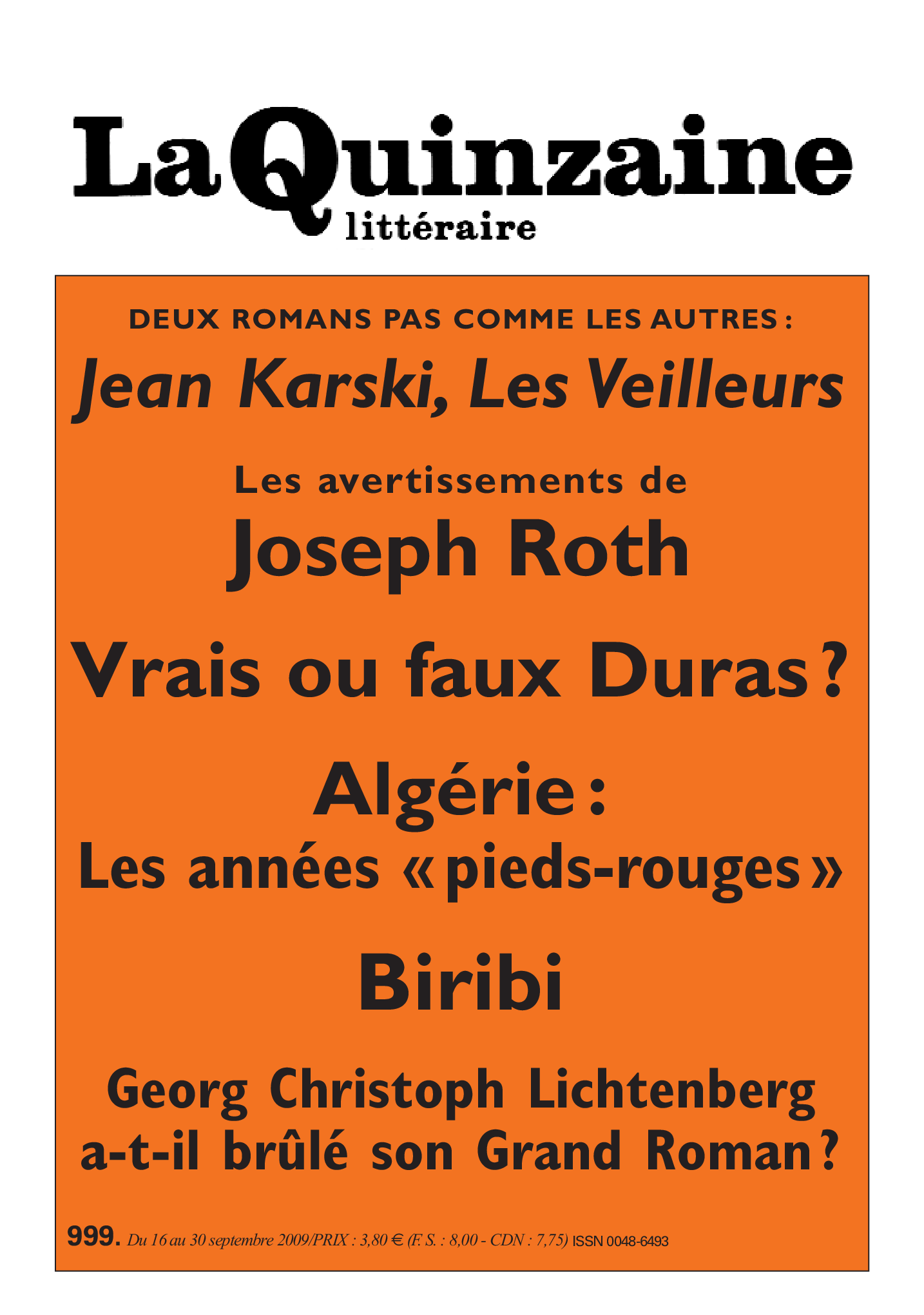
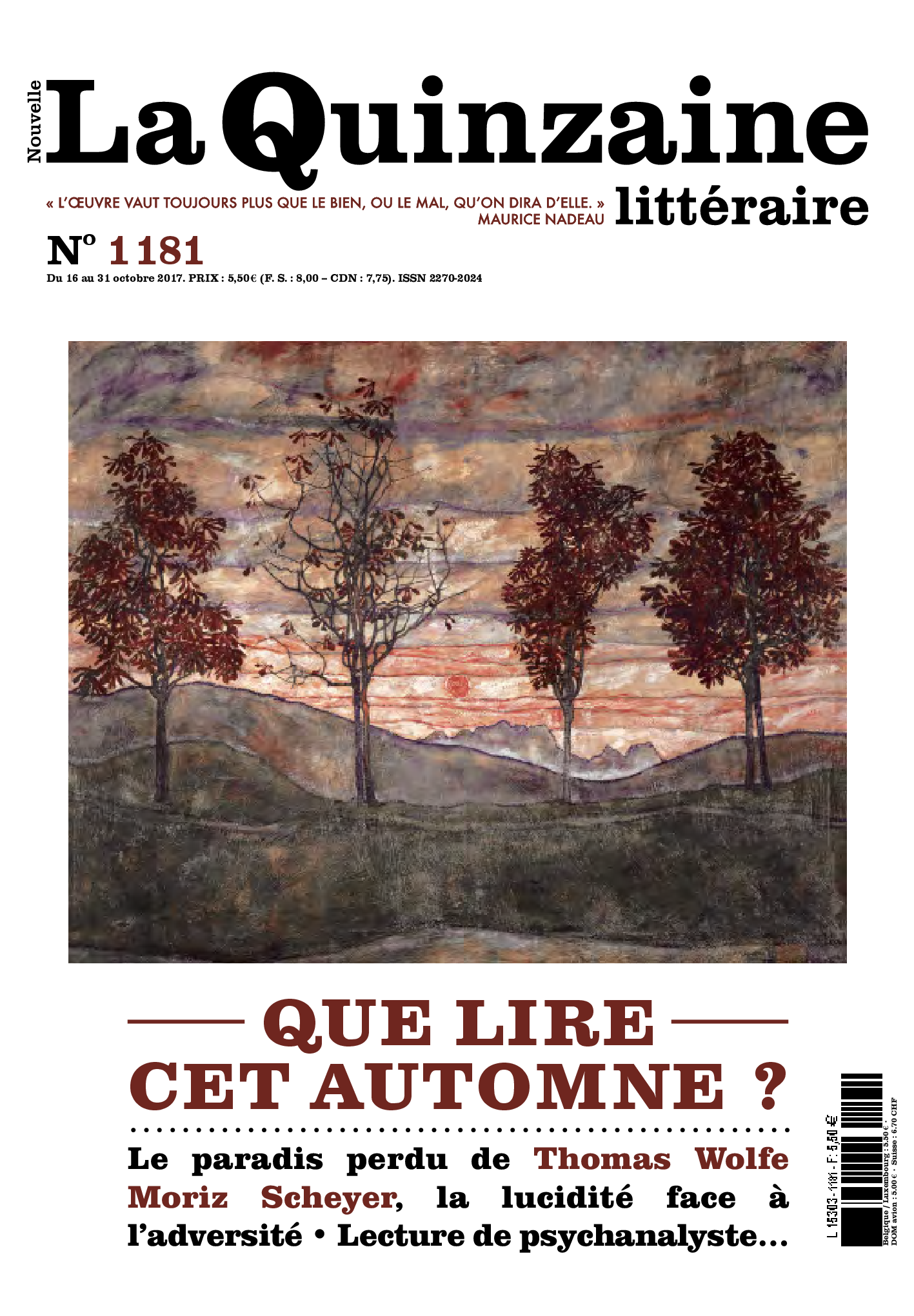
Commentaires (identifiez-vous pour commenter)