De quelle manière la théorie critique aujourd’hui a-t-elle prise sur les débats et les combats en faveur de l’émancipation ? Les enjeux mis en évidence par l’École de Francfort doivent-ils être revus à la lumière de la « Gauche américaine » ? Comment ce qui aurait pu rester cantonné aux cénacles philosophiques en vient-il à irriguer tout un questionnement allant au-delà du penser radicalement pour agir librement ? En quoi des universitaires aux États-Unis peuvent-ils contribuer à frayer des pistes universelles ? En posant la subversive question du cadrage. On ne se contente pas de montrer que la vision est bornée. On apprend à voir. La subtilité de l’argumentation égale la massivité de l’ambition : jeter les bases d’un projet de transformation éthique du monde en s’affranchissant des cadres impensés de la pensée (et du pensable), sans imposer pour autant un autre cadre tributaire du même… cadrage inavoué.
Critique et subversion dans la pensée contemporaine américaine
Le passage de la critique de la domination à une logique d’émancipation ne va pas de soi, tant la notion d’émancipation elle-même doit être soumise à la critique. Une telle mise en question – mise à la question – réclame de repenser à nouveaux frais ce que l’on croyait bien connu : utopie, possibilité, nécessité. Ainsi, l’utopie temporelle, voulant que la fin de l’histoire coïncide avec l’émancipation généralisée, se mue en utopie circonstancielle à travers un processus concret dans et pour le monde contemporain. À l’inverse de l’idéologie, qui confond le descriptif et le prescriptif, ce...

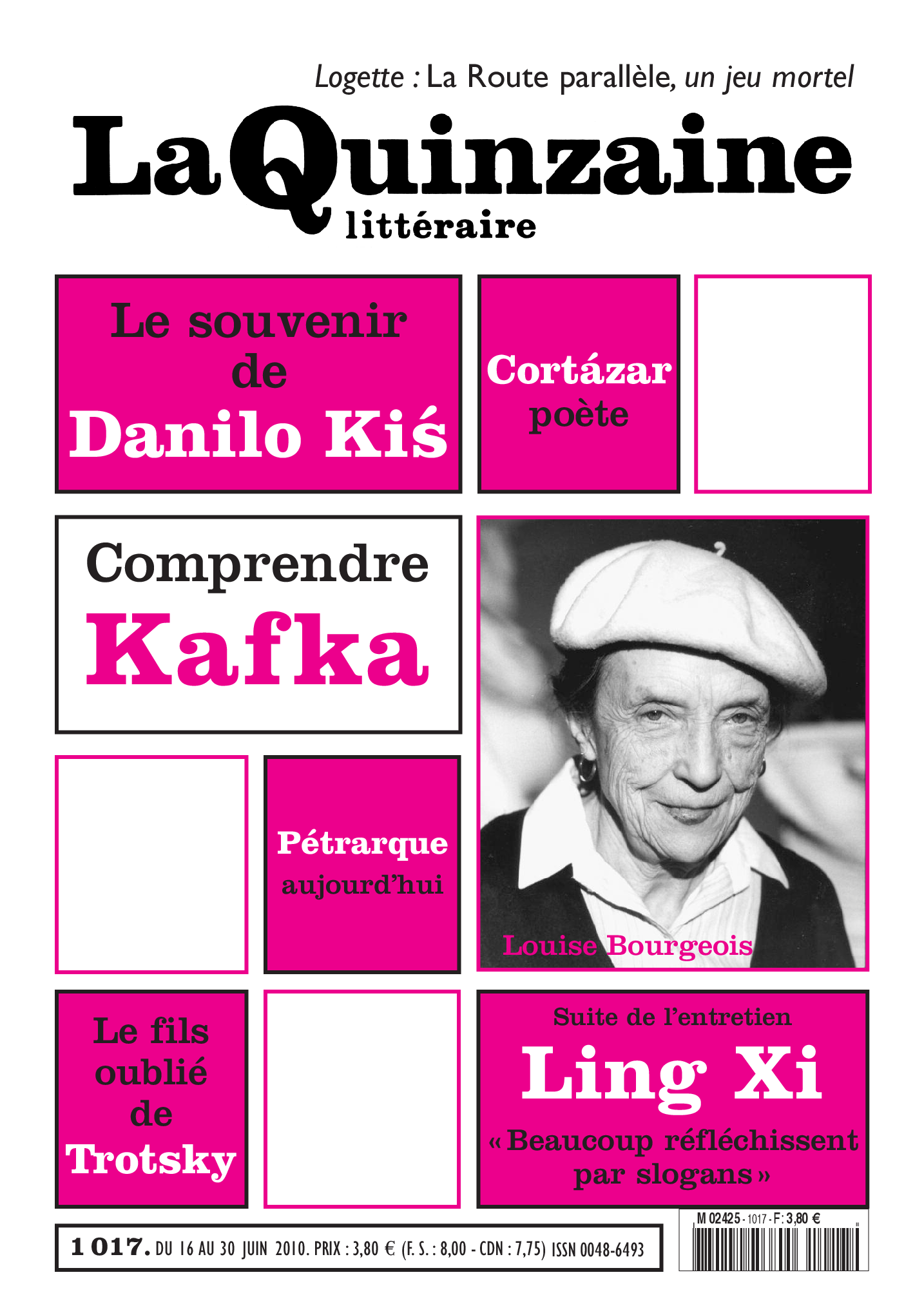
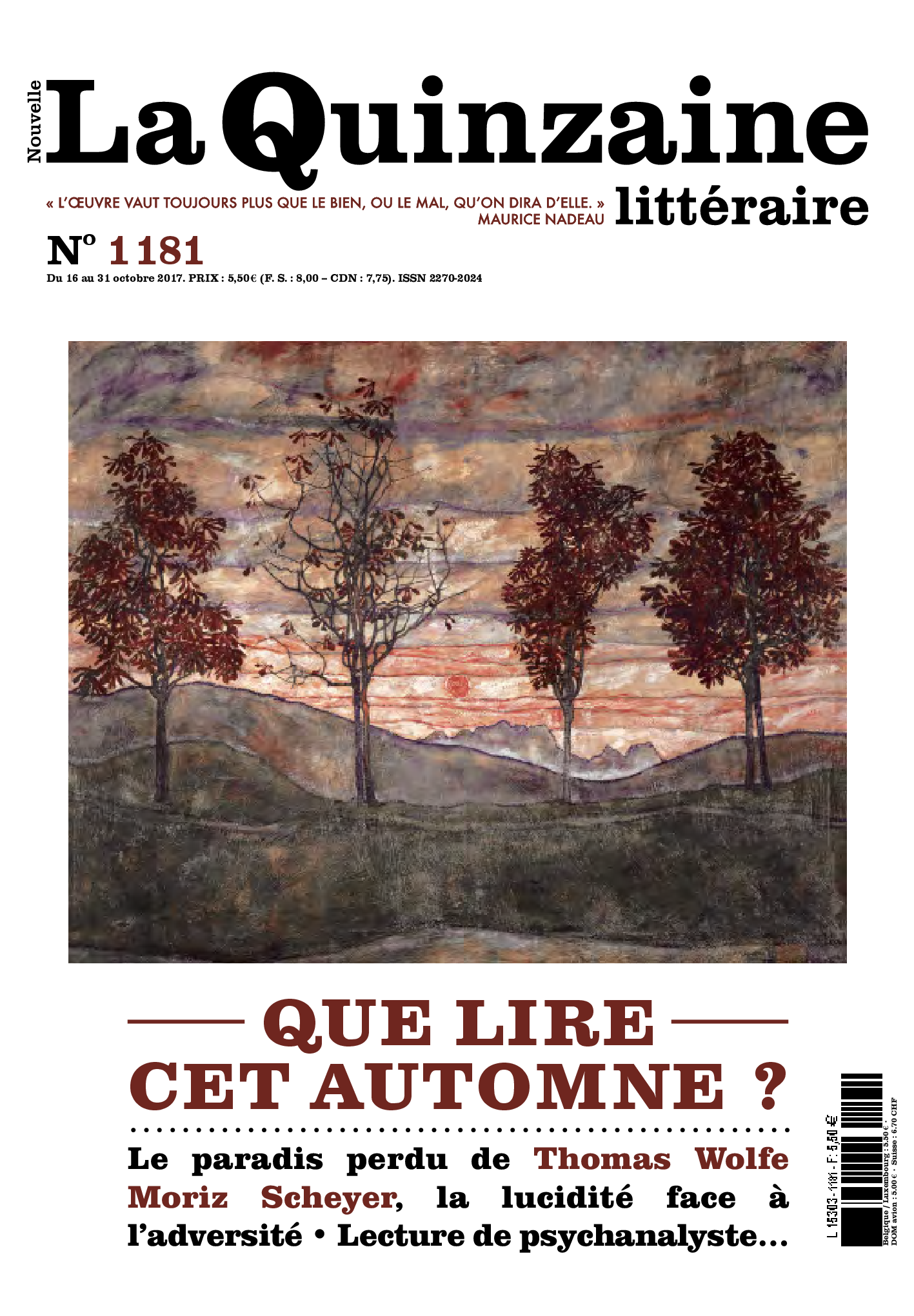
Commentaires (identifiez-vous pour commenter)