Pour entrer dans le livre
Quinzaine littéraire – Le recueil s’ouvre et se clôt sur deux figures solitaires : Provizor et Vandenberg. Le premier est de ces Cassandre qui racontent ou annoncent les catastrophes, le second un utopiste qui rêve d’une paix universelle. Cet encadrement est-il voulu ?
Amos Oz – Ce livre parle de solitude. Beaucoup de personnages du livre sont solitaires. Mais ces deux personnages-là ont d’autres points communs. Ils se sentent tous deux responsables du poids du monde. Ainsi, Provizor dit en substance qu’on ne peut rien faire contre la dureté de l’existence, mais que ce n’est pas une raison pour ne pas en parler.
Question de forme
QL – Ces nouvelles forment une sorte de roman : les personnages reviennent, certains ont pris des décisions (ainsi de Nina qui se sépare de l’homme qu’elle n’aime plus). Pourriez-vous nous parler de cette forme, de ce qu’elle vous permet de faire ?
A. O. – Je parlerai de ce livre comme d’un roman fait d’histoires. Chaque nouvelle est indépendante, a sa propre fin, se suffit à elle-même. Mais toutes les nouvelles peuvent être assemblées sur la toile d’un roman. Bien des lecteurs ont eu le sentiment de lire un roman, en fait.
Macrocosme et microcosme
QL – En ces années cinquante, Israël est à un moment de transition. Tout le monde l’a oublié. Pouvez-vous y revenir, en partant par exemple du passage de Ben Gourion à Eshkol, du débat sur les réparations payées par le gouvernement allemand, de l’atmosphère qui règne dans le pays ?
A. O. – Ces années sont les premières de l’Indépendance et une transition s’opère. On passe de l’État pionnier au pays de classes moyennes. On s’interroge. Ainsi des réparations : faut-il accepter l’argent des Allemands, et si oui pour en faire quoi ? Le kibboutz connaît aussi ces tensions qui traversent la société. Beaucoup sont dogmatiques, d’autres sont plus flexibles. Ainsi, David Dagan, le « rabbin marxiste », s’oppose à Yoav Carni, le secrétaire général du kibboutz, né là, formant avec Nina la nouvelle génération.
QL – Le kibboutz est lui aussi à un moment crucial. On y débat souvent : faut-il séparer les enfants des parents la nuit, accepter des salariés, payer des études, etc. ? Et puis on sent encore l’influence marxiste sur l’enseignement.
A. O. – Le débat oppose donc des dogmatiques à des pragmatiques, des vieux à des jeunes. Les jeunes croient dans le compromis ; les plus âgés croient en l’utopie telle qu’ils l’ont rêvée dans leur jeunesse.
Le narrateur est du côté du compromis, mais il éprouve aussi du respect pour les rêveurs.
Dagan et sa génération rêvaient de montrer le kibboutz à Staline, de le conduire dans les différents lieux et de lui montrer l’étable, les jardins d’enfants, les maisons… Puis de passer la nuit à débattre avec lui dans le réfectoire pour lui montrer qu’ils étaient les véritables marxistes-léninistes, lui enseigner ce qu’il ne savait pas. Au terme de cette nuit, dans un russe assez grossier, Staline les aurait maudits mais aurait concédé qu’ils étaient meilleurs que lui. Tout le monde serait mort de joie dans l’assistance… Précisons que ceci se déroule avant les révélations de 1956.
QL – Le monde extérieur apparaît sous des coups de projecteur : Moshé Yashar, le jeune garçon séfarade dans un monde ashkénaze, les ruines de Deir Ajloun dans la nouvelle de ce titre. En 2013, il y a un parti politique qui défend les séfarades (Shass) et la question palestinienne est plus que présente…
A. O. – Ce livre n’a rien d’allégorique et je ne songeais ni au Shass ni aux Palestiniens en écrivant. C’est un recueil consacré à des personnages et il traite de thèmes comme l’amour, la perte, la solitude, la nostalgie, la mort, la désolation. Ces histoires ne sont pas une déclaration, un geste politique. Quand je veux faire une déclaration, j’écris un article, une lettre, et, en général, j’envoie le gouvernement au diable.
L’Histoire est donc là en toile de fond mais elle n’intervient pas. Deir Ajloun n’est que ruines et ces ruines regardent les habitants du kibboutz jour et nuit.
Quant à Yashar, dont le nom signifie « honnête », « droit », il est différent des autres et le restera à jamais.
QL – Le kibboutz que vous évoquez est un microcosme, avec ses défauts tels qu’Osnat les décrit. Vous y avez vécu, c’était même le cadre d’Ailleurs peut-être, l’un de vos premiers romans. Quel regard portez-vous sur ce lieu ?
A. O. – Je vois le kibboutz comme une tentative héroïque de changer le monde en changeant la nature humaine. La tentative a échoué parce qu’on ne change pas la nature humaine.
Et pourtant le kibboutz a ceci de particulier que ça a été une révolution humaine, sans effusion de sang, sans peloton d’exécution, sans goulag, prison, ni même commissariat.
QL – Quand on lit ce recueil, et plus encore que pour d’autres de vos romans, on se sent en Russie, entre Tchekhov pour l’atmosphère, et Tolstoï pour certains personnages (Vandenberg en particulier). Qui lisez-vous ?
A. O. – Je prends ces références comme un compliment… Plus sérieusement, je lis en effet les romanciers russes du XIXe siècle, mais aussi Faulkner, García Márquez, Lampedusa. Tous ces auteurs écrivent sur un microcosme : le village, le coin de rue, le quartier… La grande littérature est provinciale, mais l’inverse n’est pas vrai.
En fait, vous trouverez l’océan entier dans une goutte d’eau.
Propos recueillis par Norbert Czarny.
Norbert Czarny
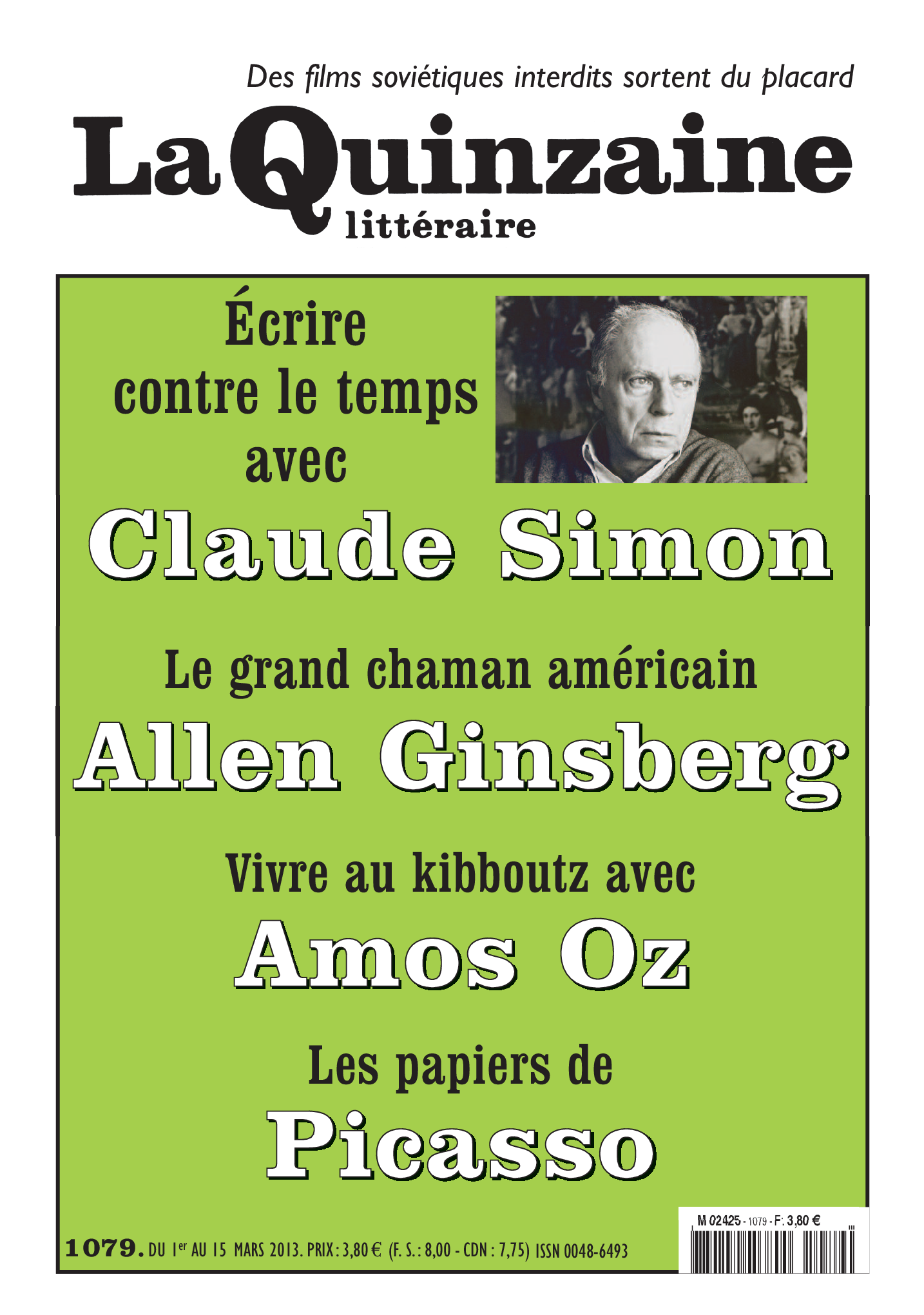

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)