Quelque chose s’est passé : a sidéré. Suffisamment pour que la ligne change de direction. On pourrait entendre la course changée d’une météorite (mais par quelle force « géante » ?), le langage astral et lointain d’une voix perdue dans l’espace.
Or tout est proche. Là. Tout est perdu également :
J’ai soif
de la tombe blanche
ovale dans mon corps.
Cette pierre dans son ventre, c’est l’enfant qu’elle a portée. Un autre poème constatera : « J’ai enfanté une pierre / elle est devenue poussière. » Ce je ...

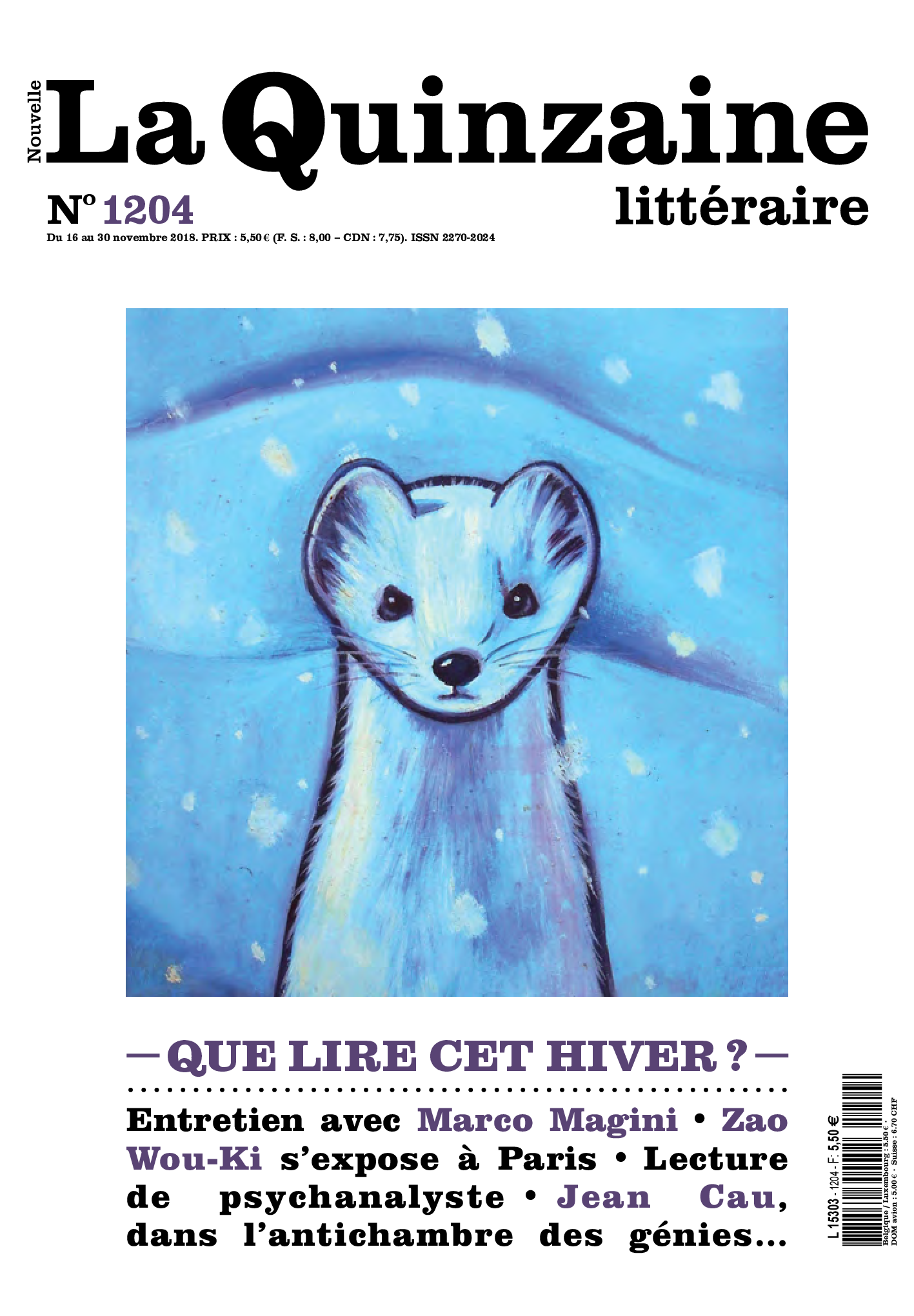

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)