Mais ils meurent avant, de faim, ou de la terrible maladie « de la gorge obstruée », à laquelle chaque chef de village essaie de les faire échapper, en entreprenant de creuser un canal qui fera venir jusqu’à eux une eau moins polluée, car c’est elle qui cause cette terrible maladie ; en faisant retourner la terre ; ou en les incitant à changer de culture : du colza au lieu du maïs ou du blé, par exemple. Échapper à la malédiction du temps mesuré, et à la faim. Lorsque les sauterelles viennent en nuages dévaster leurs cultures, ils surmontent leur répugnance et apprennent à les manger, à les mêler à des herbes pour en faire de misérables soupes. Ils continuent à mourir en nombre ; et quand les corbeaux viennent dévorer les cadavres abandonnés, ils se résolvent à tuer et manger ces oiseaux qui se sont nourris de leurs proches. L’étape suivante ne manque pas : des parents donnent à manger à leurs enfants survivants la chair des enfants morts.
Ce n’est pas tout : les paysans ne font pas que soumettre leur corps aux travaux épuisants. Il leur faut de l’argent, pour acheter des sacs de semences, ou les fournitures nécessaires à la construction du canal. Les hommes vont à la ville voisine vendre des morceaux de la peau de leurs cuisses dans un service de grands brûlés ; les femmes se livrer au « commerce de la chair », se prostituer contre de pauvres sommes, se déshonorer.
Le temps leur est compté ; sans doute est-ce la raison de la construction étrange du roman, dont les cinq parties remontent les années, de la mort de Sima Lan jusqu’à sa naissance finale.
Ces faits du passé et de l’actualité des campagnes chinoises sont avérés, connus, discutés, en tout cas hors de la Chine populaire (voir ici même le compte-rendu du livre de Yang Jisheng, Stèles, sur la grande famine rurale de 1958-1961, paru à Taiwan en 2008, QL n° 1 071, et nombre de témoignages sur les ravages du sang contaminé ou de la pollution industrielle aujourd’hui).
Le roman, lui, n’est pas un document mais est guidé ou hanté par ces réalités. Ce que vivent les paysans au cours du temps y atteint des proportions proprement épiques, ou homériques – même si les références qu’indique Yan Lianke viennent plutôt du livre biblique de l’Exode, ou des enseignements du Bouddha. Me semble « homérique » la relation constamment établie dans les descriptions entre des domaines d’activité distincts, comme dans l’Iliade les combats sont décrits à travers des images tirées de la vie paisible : l’agriculture, et la vie humaine ; les semailles, et les enterrements ; le spectacle du ciel et de la nature, et ce qui se passe sur terre.
Transfiguré par l’écriture (telle que la transcrit l’excellente traductrice), ce monde se voit ainsi constamment relié à lui-même, unifié à travers ses souffrances et sa sensualité : « Partout circule une odeur verte et humide. Les villageois sont aux champs, occupés à répandre l’engrais, ou au cimetière, à creuser des tombes. » Une jeune fille de dix-sept ans s’apprête à se prostituer : « Elle est aussi maigre qu’une branchette cueillie sur un versant des Balou, qu’un orme ou un sophora desséchés. » Sishi, la jeune femme que Sima Lan, son promis, n’épousera pas, et qui se prostitue pour l’aider quand même à survivre, pratique une fellation : « Alors, comme pour biner le champ ou faucher le blé, elle abaisse et relève régulièrement la tête. » Et quand elle rentre au village, à la fin de l’été : « Les rares feuilles d’un saule desséché se recroquevillent. À croire que sur ce mont, sur ces versants, sur toute la chaîne montagneuse, ne reste plus de fraîcheur que le halo bleuté du vêtement de Sishi. » Puis la femme légitime de Sima Lan fait l’amour avec lui, pour connaître enfin cette jouissance qu’elle croyait réservée à sa rivale : « Au-dessus de leurs têtes danse l’ombre du feuillage. Elle est sous lui, le corps tordu, le visage enflé, de sa gorge sortent de légers cris aigus, couinements d’insecte ou plaintes de malade ; elle geint comme sous la torture, les yeux écarquillés. »
Même mise en relation des domaines dans l’évocation de ce que ressent Sima Lan quand un médecin découpe sa peau à l’hôpital : « Il ne lui fait pas mal, n’a aucun geste maladroit. Il se souvient d’avoir voulu dépecer un lapin, désireux d’un cache-oreilles pour l’hiver. La bête morte était suspendue à une branche de jujubier, deux hommes lui tendaient les pattes, mais lui avaient quand même troué la peau et emporté un morceau de chair avec. »
On le sent, l’interpénétration du monde humain et de la nature suggère à Yan Lianke des passages d’une sensualité troublante, dans lesquels la distinction des règnes et des registres flotte et tremble. C’est là qu’est la réussite de l’écrivain. « À l’aube, depuis l’entrée du village, après une nuit de fraîcheur, la terre semble une pièce de tissu humide que l’on entend goutter. » Ou Sima Lan désespéré que les villageois, convaincus par l’autorisation nouvellement décrétée de distribuer les terres et de faire du commerce, renoncent à la tâche collective de creusement du canal : « Sima Lan crie à perdre haleine et sanglote interminablement, le ciel au-dessus du village vibre de ses cris, de ses pleurs dont les éclats verts et pourpres ternissent le jour. »
Les années, les saisons se succèdent, dans l’ordre chronologique inverse. C’est que le temps, dont le déroulement ou la fuite n’est nullement régulier, est lui aussi acteur ou adversaire dans cette suite de souffrances : « Le temps ressemble à une meule si lourde qu’on ne peut la pousser » ; au contraire, lorsque les villageois rêvent de retourner la terre en moins de treize ans, « si l’on étire chaque journée telle la souple lanière d’un fouet, si l’on se met à l’œuvre dès l’aube sans cesser avant la nuit, alors on peut contracter le temps et tabler sur sept ou huit ans ». Et même, lorsque Sishi revient au village souillée par la prostitution : « Le temps est mort lui aussi, fleuve tari dont le cours a disparu. »
Nombreux sont les écrivains chinois d’aujourd’hui (et les cinéastes) qui comme Yan Lianke entreprennent de trouver des formes et un langage pour dire le vrai, entre censure et prudence. La Fuite du temps a été publié en 2009 à Hong Kong (comme Les Quatre Livres, Philippe Picquier, 2012), d’autres de ses romans en Chine communiste. Son œuvre gagne en ampleur, en audace. Déjà l’auteur présente ce livre comme « un simple testament ». Faisant ainsi, d’avance, face à la mort, il affirme sa liberté.
Pierre Pachet

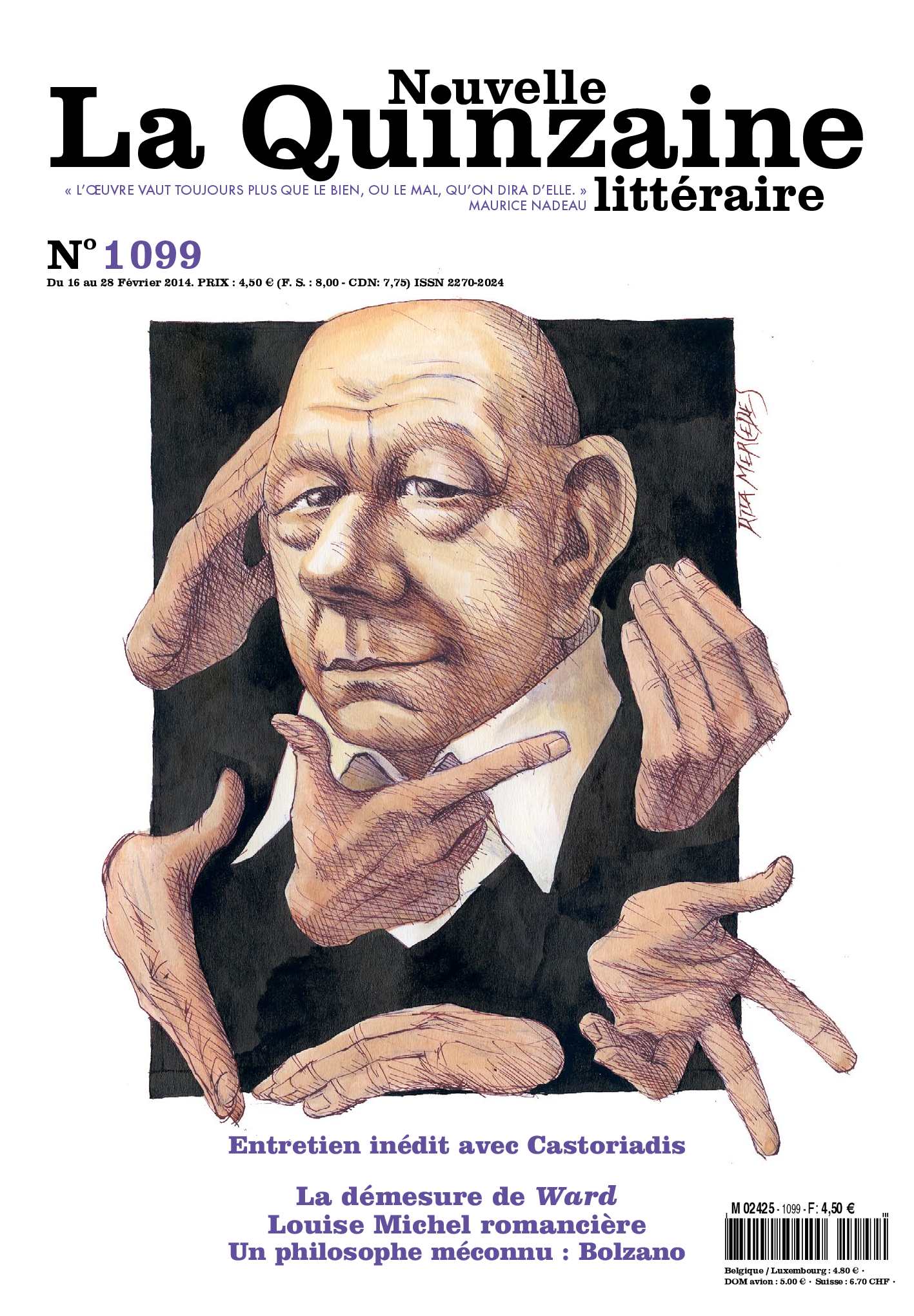

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)