Velimir Mladenović : Vous vivez-vous comme un écrivain français, ou algérien et francophone ?
Salim Bachi : Comme un écrivain dont la quête personnelle est avant tout littéraire et humaine. Je me méfie beaucoup des assignations à résidence identitaires, en général. Je suis Salim Bachi et j’écris des livres.
VM : Dieu, Allah, moi et les autres contient de nombreuses références à la littérature européenne qui a marqué votre enfance et votre pensée. Que représente la littérature, pour vous ?
SB : C’est ma passion et mon métier, donc beaucoup de choses. Mais, avant tout, c’est une aventure personnelle et artistique. En ce sens, je suis proche d’une certaine littérature française et occidentale qui s’attache à décrire les différents mouvements « internes » d’un homme ou d’une femme en prise avec le monde et qui essaie de comprendre. Un écrivain, un artiste, est quelqu’un qui s’ausculte tout en auscultant le monde qui l’entoure, médecin de lui-même et des autres. James Joyce a été pendant peu de temps un carabin, comme il le dit lui-même dans Ulysse. Je me sens proche de ces écrivains, en toute modestie, et en toute impudeur aussi.
Dans votre livre, vous décrivez la séparation d’avec la foi. Se libérer d’une religion suppose-t-il a priori d’avoir perdu la foi ?
SB : Je ne sais pas pour les autres, mais, pour ma part, je ne crois en rien. Alors tout est permis, comment dirait Ivan Karamazov ? Je ne le crois pas non plus, et d’ailleurs certains de mes livres mettent en garde contre ce genre de pensée folle, qui est paradoxalement le fait de croyants intégristes aujourd’hui, capables d’assassiner leurs semblables pour rien. Je me tiens donc à distance de toute forme d’extrémisme pour essayer de rendre compte du monde actuel.
VM : Toujours dans Dieu, Allah, moi et les autres, vous écrivez : « Le plus drôle dans cette Algérie des années soixante-dix : tout le monde avait réponse à tout, surtout en matière religieuse […]. » Pourquoi la religion était-elle si importante dans cette période ?
SB : Période de l’Algérie qui ressemble à notre France d’aujourd’hui. Dans les banlieues, le discours sur la religion semble être la seule référence de la jeunesse qui se radicalise. C’est pour moi étrange, incompréhensible. Comme si l’histoire me rattrapait avec plus d’un quart de siècle de retard.
VM : Comment votre roman a-t-il été accueilli dans votre pays natal ?
SB : Il n’a pas été accueilli du tout. Un silence assourdissant, pour tout vous dire. On ne trouve pas le livre en Algérie. J’ai eu droit à deux critiques dans le journal El Watan, l’une négative et l’autre un peu plus positive. Sinon rien. D’ailleurs, aucun journal algérien n’a mentionné le prix Renaudot poche que le livre a reçu. Je suis quelqu’un qui dérange beaucoup dans mon pays, aujourd’hui encore. Je n’en suis pas particulièrement fier, mais je pense que cela indique quelque chose de l’état de l’Algérie aujourd’hui.
VM : Vous avez dit qu’en France les gens vous considéraient comme un « intellectuel musulman ». Quelle est la différence entre un intellectuel musulman et un intellectuel chrétien ?
SB : Je ne me considère pas comme « musulman », et encore moins comme « chrétien ». Je ne suis pas croyant. C’est pourquoi je refuse cette étiquette. Et je ne suis pas un « intellectuel ». Je suis avant tout un écrivain qui s’interroge sur sa vie et sur son métier. Bien entendu, je donne mon avis quand on me pose une question sur un fait politique, mais ce n’est que mon avis après tout. Je n’engage personne à être comme moi, à penser comme moi. Je risque de me tromper, comme tout le monde.
VM : Vous avez confié : « L’école algérienne que j’ai connue a été une école de violence. » Comment cette expérience a marqué votre écriture et votre pensée ?
SB : Je ne sais pas si cette expérience douloureuse a vraiment marqué mon écriture. Je sais en revanche qu’elle m’a éloigné de toute forme d’endoctrinement, qu’il soit religieux ou politique. Et c’est tant mieux.
VM : Dans le roman Le Consul, vous avez décrit le courage d’un consul du Portugal à Bordeaux qui, en désobéissant à son gouvernement, a sauvé la vie de dizaines de milliers de personnes lors de la Seconde Guerre mondiale. Il a payé le prix fort pour ces actes. Est-ce une histoire pessimiste ?
SB : Non, au contraire, c’est une histoire de courage qui donne à espérer. J’aimerais qu’il y ait beaucoup plus de femmes et d’hommes capables d’agir comme le consul Aristides de Sousa Mendes. Mon pessimisme est donc relatif.
VM : Les deux cultures algérienne et française, les deux traditions littéraires aussi, sont très présentes dans votre écriture, tout comme dans l’œuvre de Camus, dont la vie vous a inspiré pour le roman Le Dernier Été d’un jeune homme. Comment la philosophie de cet écrivain vous a-t-elle influencé ?
SB : Je n’ai pas été influencé par la pensée de Camus, en vérité. Je n’aime pas le Camus penseur, donneur de leçons, qui l’a rendu célèbre. Je suis attaché à l’artiste qui a écrit Noces, L’Étranger et La Chute, le reste me laisse plutôt dubitatif. Camus s’est trompé sur l’Algérie à la fin. Mais j’aime le jeune homme qui commence à écrire alors que tout vise à l’en empêcher : sa maladie, la pauvreté. J’aime le Camus généreux des années trente qui cherche une solution à la colonisation, pas celui qui s’oppose à la fin de celle-ci dans les années cinquante. Quant à mes influences littéraires, elles dépassent un peu ces deux traditions dont vous me parlez. Je suis un écrivain japonais, pour paraphraser Dany Laferrière…
[Salim Bachi, né en 1971 à Alger, a notamment publié : Le Chien d’Ulysse (Gallimard, 2001), qui a obtenu le prix de la Vocation, le prix Goncourt du premier roman et la bourse de la découverte de la Fondation Prince Pierre de Monaco ; Le Silence de Mahomet (Gallimard, 2008) ; Le Dernier Été d’un jeune homme (Flammarion, 2013), Le Consul (Gallimard, 2014) et Un jeune homme en colère (Gallimard, 2018). Dieu, Allah, moi et les autres a obtenu leprix Renaudot du livre de poche en 2018.]
[Extrait]
« Dieu n’existe pas.
Ouf, je l’ai dit.
Aujourd’hui, je peux l’écrire et cela m’engage comme aurait pu le dire Sartre. Cela m’engage d’autant plus que je suis musulman pour les Algériens et pour les Français. En Algérie, on naît, vit et meurt musulman. En France aussi on devient musulman de droit républicain. Il y a quelques années encore, on aurait dit que j’étais un Arabe, une catégorie repoussante pour la majorité des Français. Cette catégorie a été remplacée par celle non moins répugnante de Musulman (avec une majuscule infamante), dont usent et abusent avec allégresse certaines personnes que je ne nommerai pas car elles sont vachardes en diable. Elles ressemblent à l’éructant Céline, le génie littéraire en moins. Elles ressemblent aussi aux islamistes, professeurs, enseignants, marchands de cacahouètes et de tapis qui, dès les années soixante-dix en Algérie, ont considéré que nous étions génétiquement des musulmans, de notre premier à notre dernier souffle, en plus d’être des Arabes, et seulement cela. Exit : Berbères, Africains, Turcs, Français, juifs…
En toute franchise, je ne vois pas de différence entre leurs discours aux uns et aux autres: ils se rejoignent et s’entendent sur l’essentiel. Lorsque je vois à la télévision un homme ou une femme politique s’adresser aux Musulmans de France, j’ai l’impression d’entendre Abassi Madani ou Ali Belhadj, les anciens dirigeants du Front islamique du salut, exhortant les Musulmans d’Algérie à rentrer dans le droit chemin de Dieu, celui qui a conduit au massacre de deux cent mille personnes pendant les années quatre-vingt-dix. J’ai tout de suite tendance à changer de chaîne.
Musulman, je ne le suis point, et, mon cher guide de conscience médiatique, je te dis le fameux mot de Cambronne ! »
Salim Bachi, Dieu, Allah, moi et les autres, p. 18-19.
Velimir Mladenović
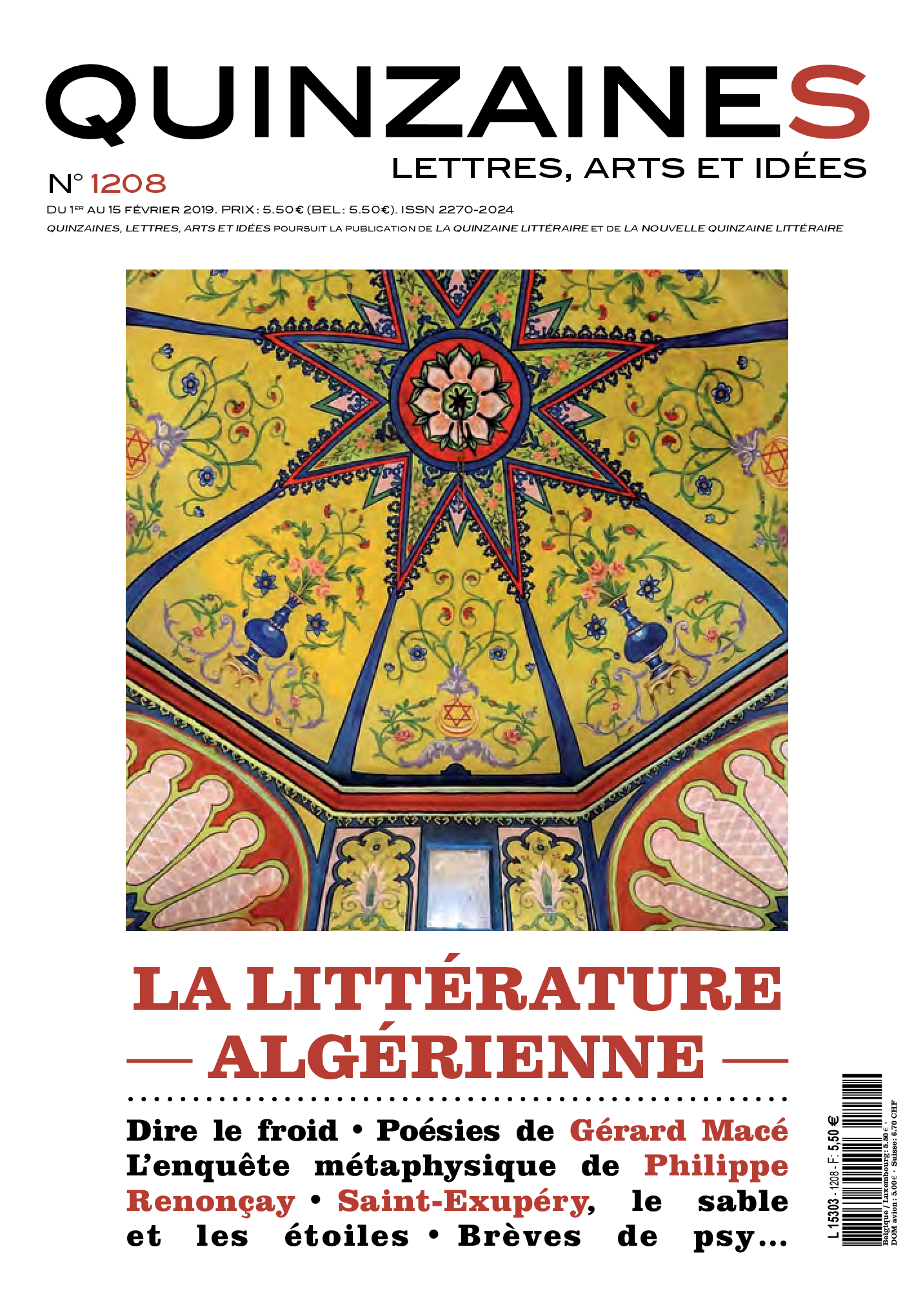

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)