Sans déterminant mais qualifié deux fois, coup sur coup, le nom bref est précisé par les deux adjectifs plus longs (une syllabe, puis deux, puis trois). Vision d’une sérénité gagnée ou évocation indirecte de la mort trouvée ? La grande roue de la couverture, d’après une photo de l’auteur, est-elle celle de l’éternel retour ?
Dès l’incipit apparaît le « nous » qui sera interrogé tout au long de ces pages :
notes sur le fleuve qui nous a perdus :
le corps en premier plan
est immergé
Le corps du « nous » est pris dans ce qui...

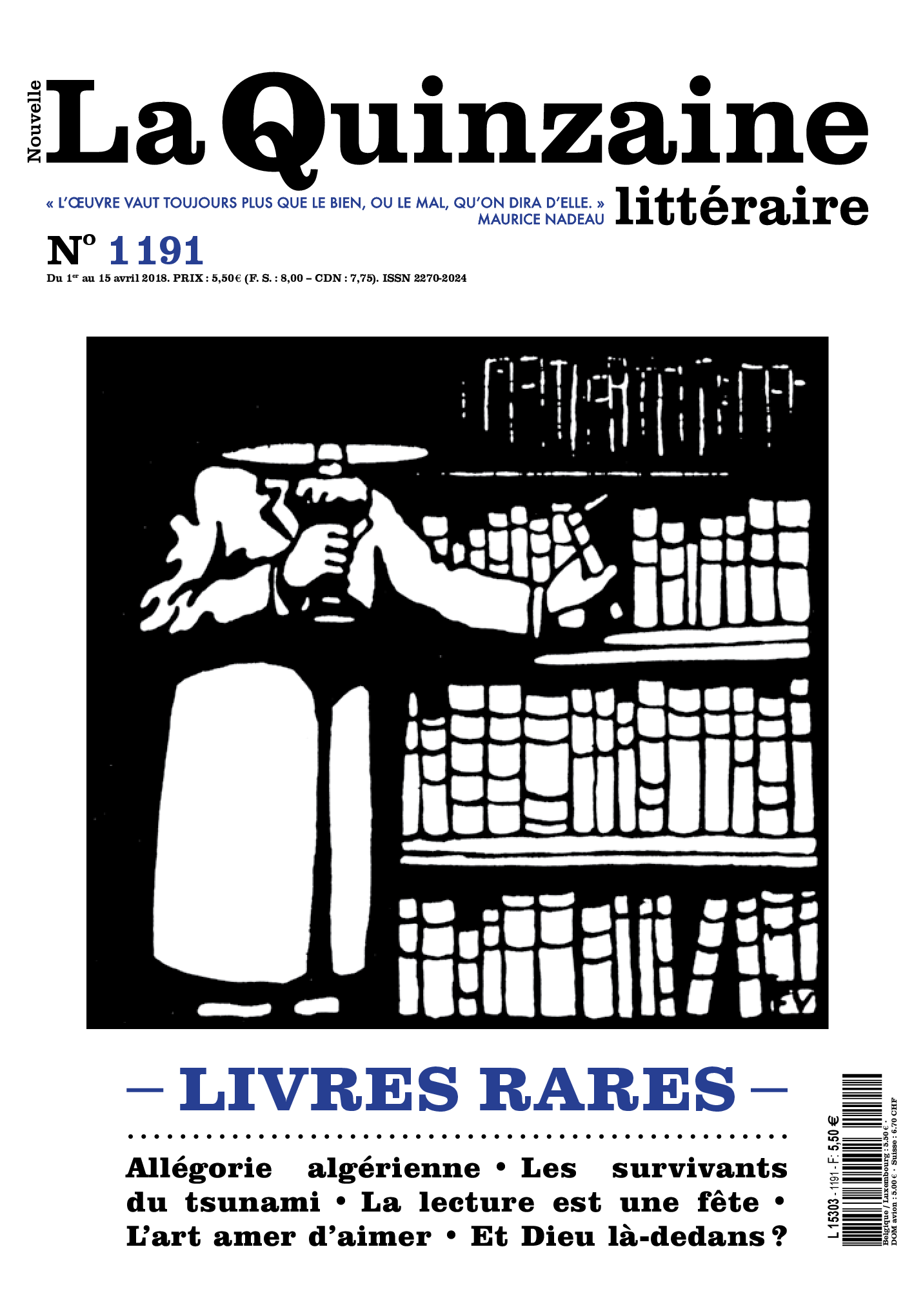

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)