Une légende, celle de la Mère des Mârals à la Belle Ramure, mythe des origines de la tribu des Bougous, parvenu du fond des âges ; un cri, aveu déchirant, jailli des tréfonds de l’être, sur le quai de la petite gare de Kourkoureou ; une mélodie inimitable, fondant en un seul chant les plus belles chansons des peuples frères, kazakh et kirghiz. Au cœur des trois ouvrages disponibles en France, Le Premier Maître, Djamila et Il fut un blanc navire (les deux premiers écrits en langue kirghize et le troisième en russe), une voix porte tout un monde d’émotions et de valeurs, une voix s’immisce, bouleverse et résonne d’échos obsédants jusqu’aux derniers jours des personnages qui sont par elle habités, pour leur plus grand bonheur ou leur sort le plus funeste. Ce sont par exemple un jeune garçon et sa belle-sœur, la solaire, fière et narquoise Djamila, qui s’éveillent une nuit d’août à des émotions nouvelles, l’amour, le désir de peindre, lorsqu’un soldat impénétrable, dans un hymne ardent à la vie et à la beauté de la terre, « ouvre sans mot la grande âme humaine ». « L’âme à l’envers », le narrateur se découvre alors une bouillante envie de partager sa vision. Ces moments de bascule engendrés par une voix qui transporte dans un autre monde sont éminemment poétiques et s’accompagnent souvent d’une intensité dramatique saisissante. Dans Il fut un beau navire , la légende du grand cerf blanc de Sibérie, dont le pouvoir d’émotion sera décuplé lors des apparitions fugaces de l’animal, fera chavirer la vie d’un petit garçon déjà tout entier baigné d’histoires qu’il s’est inventées, au sein d’un univers familial sans scrupule, insensible aussi bien à la poésie de la fable qu’à la nature.
L’évocation lyrique de la nature occupe une place prépondérante chez ce chantre de la beauté et de l’âpreté de la terre natale, qui s'inscrit dans la tradition de l’épopée kirghize. Les récits et les chants se confondent avec la nature en ce qu’ils la célèbrent autant qu’ils en émanent : « C’était une chanson des monts et des steppes, tantôt qui s’envolait sonore comme les monts kirghiz et tantôt s’étendait sans entrave comme la steppe kazakh. » La steppe s’éveille au chant de Daniiar et écoute, reconnaissante, les « caresses » qu’on lui prodigue, les herbes et les rochers sont affublés de noms par l’enfant esseulé et rêveur dont le souhait le plus cher est de se métamorphoser en poisson pour rejoindre le lac d’Issyk-Koul sur lequel vogue un blanc navire. Le souffle épique fait palpiter la nature de vie humaine, la personnifiant souvent ; ainsi les nuits de grand vent, les montagnes craintives se serrent les unes contre les autres au plus près de la maison du petit garçon, là où la lumière se montre au carreau. Comme pour épouser le rythme ancestral de la vie nomade kirghize soumise aux saisons, l’écriture prend soin d’ancrer tout événement dans ces dernières. Le chant de la nuit d’août est ainsi porté par un vent qui « apportait de là-bas la senteur des pommes, les miels chauds du maïs en fleur comme un lait qu’on vient de traire, et le souffle tiède des fumiers séchés ». L’écrivain met tout son art à peindre les métamorphoses de cette nature dont il donne à éprouver l’indocilité et la souveraineté. Si la nature exerce son empire souvent démesuré sur les aïl (mot kirghiz pour « village »), l’auteur s’attache aussi à en montrer la vulnérabilité. Le récit allégorique d'Il fut un blanc navire représente ainsi une trahison, celle des hommes à l’égard de la nature qui les a nourris. Le roman atteint son acmé dans une fin superbe et térébrante, lorsque la famille se délecte d’un plat de viande fraîche de mâral, véritable profanation aux yeux de l’enfant ; son univers vole alors en éclats et il ne lui reste plus qu’à se fondre dans le torrent qu’il a investi de tant de rêves.
Si la part allouée à la nature, au lyrisme, à l’esthétique du conte rattache l’œuvre d’Aïtmatov à la tradition épique, la célébration de héros y participe également, mais ce ne sont pas les héros guerriers habituels de l’épopée. Les hommes que le récit porte à admirer sont des gens simples, voire simplets aux yeux de certains, eux-mêmes arriérés, incapables de respecter ceux qui ne promènent pas à la vue de tous leur importance. Chacun des trois récits porte ainsi en son sein quelques figures dotées d’une profonde humanité contrastant fortement avec les êtres brutaux et sans subtilité qui les entourent. La beauté de ces livres tient précisément au fait qu’Aïtmatov conjugue en permanence un primitivisme ambiant et des âmes foncièrement bonnes qui suscitent la méprise : le silencieux Daniiar, sous sa vieille capote et ses souliers troués, a une âme « plus riche que nous tous » ; Douïchène, l’envoyé presque analphabète du Komsomol édifie, envers et contre tous les éléments et les villageois, une modeste école qui n’a d’école que le nom et la foi de son instituteur dans la nécessité d’instruire les enfants conformément à l’idéal de Lénine ; le Preste Mômoun, vieillard qui est le dévouement incarné, voit son zèle foulé aux pieds.
A travers ces personnages, bafoués par leurs congénères mais révérés par le lecteur, se trouvent cristallisées les tensions entre la tradition et la modernité qui travaillent de manière profonde et subtile l’œuvre et la vie d’Aïtmatov. Lui, le petit-fils de berger kirghiz qui n’a cessé de se pencher sur le folklore de son pays, fut également, après avoir exercé les professions d’agronome et de journaliste, le conseiller de Mikhaïl Gorbatchev dont il soutint la politique de « perestroïka », devenant un partisan de l’ouverture alliée à la mémoire du passé. Ses livres dressent le tableau du Kirghizstan, alors République soviétique au sein de laquelle les peuples nomades connaissent la collectivisation des terres, l’exode rural et la tentative de scolarisation. Les traditions et valeurs ancestrales rencontrent, non sans heurt parfois, les idées et la morale nouvelles, sans qu’un plaidoyer net se dessine pour les unes ou les autres. Les deux cohabitent, l’histoire nationale, la culture des peuples de la steppe et la russification.
Il fut un blanc navire semble opposer le passé, refuge de nobles valeurs tels le sens de la justice, le respect de la nature, l’hospitalité, la mémoire des ancêtres, à un présent qui a perdu son humanité. Face au grand-père, le gendre, ivrogne violent pris dans les rets du fantasme citadin, dédaigne la vie rurale qu’il mène, et se soucie peu de la divinité mère. Plus personne ne paraît porter en soi la mémoire de la lignée et se considérer comme « le fils des enfants de la Mère des Mârals à la Belle Ramure », sauf le grand-père et son petit-fils pour qui la légende tient lieu de conservatoire vivant des traditions, de garant de l’ordre moral. Cependant, c’est ce même grand-père qui est le seul à se soucier d’accompagner son petit-fils sur le long trajet qui mène à l’école... Autour de celle-ci gravite aussi Le Premier Maître dont le héros, Douïchène, porté par l’idéal des lumières soviétiques sans être lui-même très éclairé, met toute son âme à « instruire » les enfants de l’aïl, progéniture de ceux qui ont « vécu dans l’obscurité », « piétinés et humiliés ». Face à lui, ce ne sont qu’incrédulité, railleries et réticences. Mais quelques décennies plus tard, c’est ce même village qui célèbre l’inauguration solennelle de la nouvelle école construite par le kolkhoze, invitant une ancienne compatriote devenue académicienne. Djamila quant à elle semble incarner ce télescopage entre traditions et modernité dans un village qui semble être passé sans véritable secousse au système du kolkhoze. Outrepassant parfois, par son attitude impertinente et indépendante, ce qu’une famille peut accepter d’une bru, elle transgresse les traditions en fuyant avec un homme choisi selon son cœur alors même qu’elle représente en même temps aux yeux de ce dernier sa terre natale, cette terre kirghize si pleine de vitalité et de rudesse.
Nous regrettons qu’Une journée plus longue qu’un siècle, œuvre somme dans la pensée d’Aïtmatov, ne soit pas disponible en France : là y sont pensés la place des traditions des peuples kirghiz dans la société soviétique et les dangers de la russification. S’il y a chez Aragon de la provocation à qualifier Djamila de « plus belle histoire d’amour » éclipsant tout à la fois, selon lui, Werther, Bérénice, Antoine et Cléopâtre, Manon Lescaut, L’Éducation sentimentale, Dominique, rien de moins que cela, il faut donner toute leur mesure aux livres, beaux et pénétrants de cet auteur majeur dont la statue trône à Bichkek aux côtés de celle de Manas, héros épique de l’épopée éponyme.
Éva Philippon
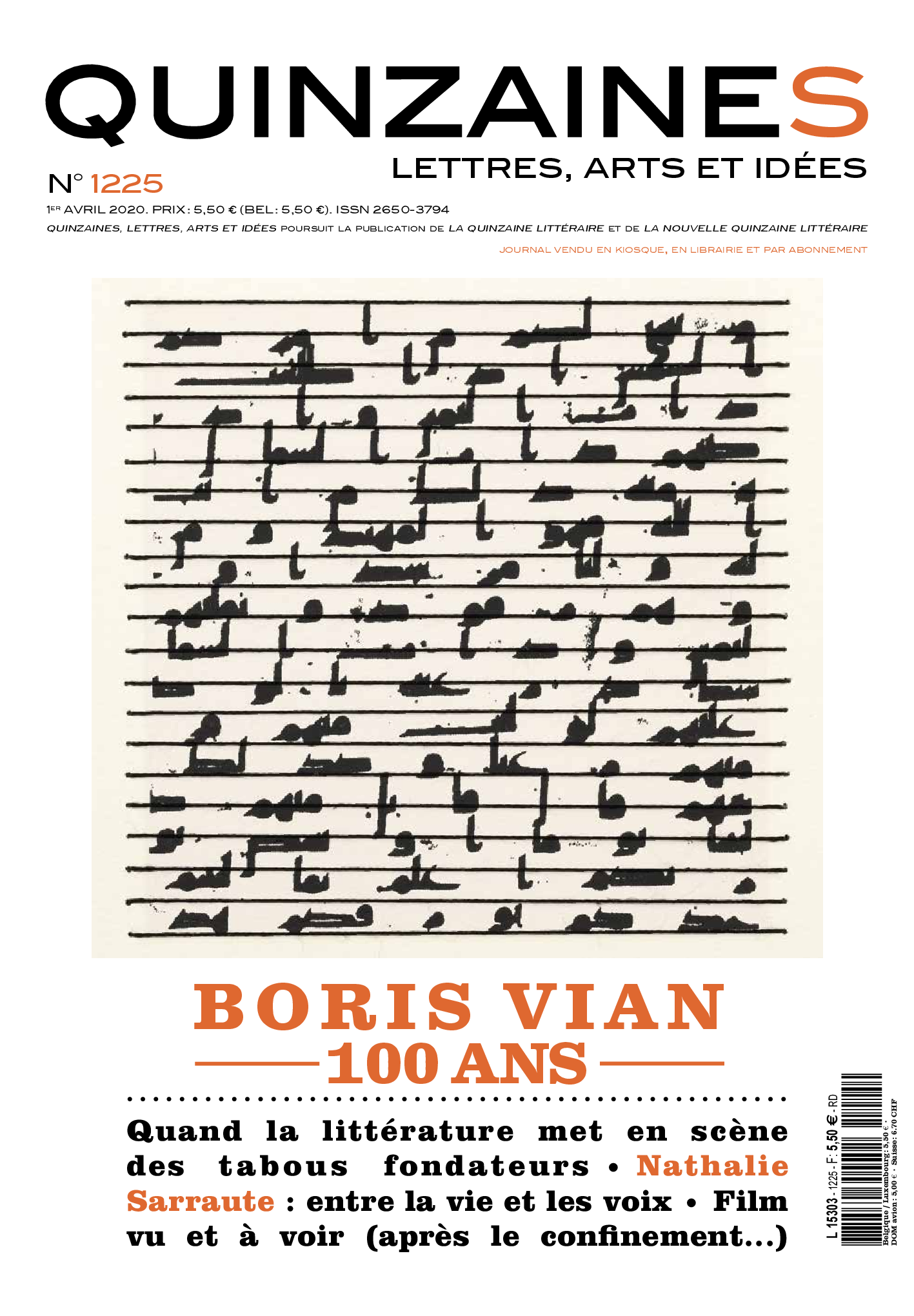

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)