Tout d’abord, notons que fort justement Jean-Luc Steinmetz, dans son « Introduction générale » figurant en tête du premier volume, souligne le rapport intime et devenu comme nécessaire depuis le premier grand in-octavo luxueusement relié et illustré par Hetzel – c’était, en 1866, Voyages et aventures du capitaine Hatteras, avec les formidables dessins d’Édouard Riou – qui s’est établi entre le texte des Voyages extraordinaires (ce titre mythique, démarqué de celui que Baudelaire avait inventé pour sa traduction des Histoires de Poe, revient à l’éditeur) et les planches gravées à partir des compositions romantiques d’un certain nombre d’artistes. Les plus brillants de ceux-ci, outre Riou, furent Léon Benett (Le Tour du monde en quatre-vingts jours, La Maison à vapeur, La Jangada), Jules Férat (L’Île mystérieuse, Les Indes noires), Georges Roux (Le Village aérien, Le Phare du bout du monde).
Or la chose, d’une certaine manière, est cocasse, puisque ces magnifiques éditions, explicitement destinées par Hetzel à servir d’étrennes pour les enfants choyés de la bonne bourgeoisie du Second Empire puis de la Troisième République, rapportèrent une fortune à l’éditeur mais pas un sou à l’auteur privé par contrat (léonin) de cette manne ! Mais enfin les dés en sont jetés désormais : le label « Jules Verne » se confond avec les beaux formats dorés sur tranche, aux merveilleuses couvertures armoriées successives dont l’Album Jules Verne, concocté par François Angelier et sorti en même temps que les deux tomes de la « Pléiade », fournit en ses dernières pages un florilège en couleurs.
Et justement, c’est là que le bât blesse. La restitution sur papier bible en petit format transforme en vignettes un peu ridicules les outrances revendiquées d’illustrateurs qui avaient reçu pour mission de l’excellent commerçant et honorable filou qu’était aussi l’éditeur de Balzac, Hugo, Stendhal (et de P. J. Stahl, pseudonyme de Hetzel pour ses propres romans édifiants) de rivaliser en « extraordinaire » avec les mots. La miniaturisation sied mal aux émules de Gustave Doré et quand il s’agit, dans l’Album, de faire tenir sur une seule page du même module riquiqui deux ou trois images venues soutenir le texte (souvent excellent, dans ses choix littéraires notamment) de François Angelier, malgré la qualité de la reproduction le lecteur se sent frustré.
D’autre part, puisqu’on avait décidé, ce qui d’un point de vue commercial se justifie parfaitement, de ne pas lancer l’entreprise énorme qu’aurait constituée une publication chronologique des œuvres complètes d’un de nos forçats de la plume les plus conséquents (62 romans, 18 nouvelles en quarante-trois ans de labeur), on s’interdisait du même coup le travail en profondeur qui reste à faire dans deux directions : démêler les rapports complexes de subordination/insubordination qui firent du couple éditeur (aîné, substitut du père)/auteur (cadet, respectueux de l’âge et de l’expérience mais secrètement rétif) une collaboration d’un quart de siècle (Verne rencontre Hetzel en 1862, celui-ci meurt en 1886) non exempte de luttes mais sans rupture même après la mort du patriarche, le fils Hetzel ayant pris aussitôt la relève de son père ; redonner aux romans achevés de l’écrivain, au nombre de huit à sa disparition en 1905, leur forme originelle dévoyée par Michel, fils rebelle puis abusif du romancier : à cette seconde tâche la Société Jules Verne s’emploie depuis 1989 à partir des manuscrits conservés à Nantes.
Il fallait donc opérer un choix drastique. On ne contestera pas celui de Jean-Luc Steinmetz, qui semble avoir voulu répondre à une double préoccupation. En présentant comme en continuité romanesque Les Enfants du capitaine Grant, commencé sans doute en 1864, achevé en 1867, Vingt mille lieues sous les mers, écrit entre 1866 et 1871, L’Île mystérieuse (1871-1875), alors que la rédaction d’autres romans (fin de Hatteras, De la Terre à la Lune puis Autour de la Lune, Le Tour du monde en quatre-vingts jours…) occupe les mêmes années, qui sont celles de la production la plus intense – et des interventions les plus envahissantes de Hetzel –, ce qui est mis en lumière, c’est la capacité de Verne à camper une sorte de Comédie humaine qui fait revenir les mêmes personnages d’un roman à l’autre, tentative vaguement balzacienne unique dans son œuvre. Mais on pourrait aussi défendre l’idée que ces trois voyages démesurés (Grant est le plus long des romans de Verne, chacun des autres un monument à peine moins vaste) mettent en scène un thème qui a obsédé sa vie durant (inquiété et fasciné à la fois) le rejeton d’un conformiste notable nantais, devenu lui-même un conformiste et fort antipathique notable amiénois (misogyne, féroce partisan de l’éradication des mutins de la Commune, et antisémite pour faire bonne mesure), le thème du hors-la-loi. Tel est, du côté sombre, Ayrton, le « vilain » du premier livre, abandonné pour y purger solitairement ses crimes, sur l’îlot Tabor au large de la Nouvelle-Zélande. Tel, du côté lumineux, Nemo, le maître du Nautilus, à la condition de se souvenir que ce Janus bifrons est conjointement l’impitoyable justicier qui coule un navire anglais de commerce chargé de femmes et d’enfants dans Vingt mille lieues, et le bienfaisant prince hindou qui, devenu philanthrope, conduit les naufragés de L’Île mystérieuse auprès d’Ayrton ensauvagé mais repenti (bifrons donc, lui aussi) que l’anti-esclavagiste Cyrus Smith sauvera.
Quant au Sphinx des glaces, ébauché peut-être dès 1888, publié en 1897, c’est un des derniers avatars de l’effort romanesque vernien et à coup sûr un cas sans autre exemple dans sa production, puisqu’il se propose la gageure de prolonger et même d’achever Les Aventures d’Arthur Gordon Pym de Nantucket, seul roman (volontairement laissé inachevé) de Poe, publié en 1838, traduit par Baudelaire en 1858. En choisissant ainsi une des œuvres courtes les moins connues d’un écrivain prolifique, il s’agit apparemment de montrer que le pourvoyeur infatigable du Magasin d’éducation et de récréation, par ailleurs capable de venir à bout d’effroyables pensums comme Géographie illustrée de la France et de ses colonies, pour complaire à un éditeur que le brusque décès du géographe Théophile Lavallée laissait fort embarrassé en 1866, n’était pas seulement un lecteur-adaptateur de publications scientifiques et de récits de voyageurs, mais un admirateur secret de poètes sulfureux et d’écrivains de l’étrange. Les Fleurs du mal, Gordon Pym, certes ces référents sont tout sauf anodins !
Mais voilà, examiner Le Sphinx des glaces, ce révélateur, c’est tout de suite se heurter au problème des limites de Verne. Jean-Luc Steinmetz, qui assume ses options avec panache, s’est donc réservé la notice consacrée au livre et il est trop fin lecteur pour ne pas convenir que son auteur, s’il tente effectivement de traduire l’impression de sidération admirative que Poe lui a procurée, se contente le plus souvent de paraphraser en élève appliqué le texte du génial Américain, avec néanmoins un parti pris suprêmement agaçant, qui consiste à rationaliser tous ce qui, chez Poe, obéit au non-dit qui sert d’ancrage au mystère. Son zèle, mortel pour la poésie, le pousse donc à remplir les creux de l’intrigue, à expliciter les relations entre les personnages en leur inventant au besoin d’oiseuses généalogies, en tissant autour d’eux un rassurant cocon familial, bref à banaliser une aventure éminemment incompréhensible et même absurde, l’invention finale de Verne, le fameux sphinx magnétique, réduisant la rêverie métaphysique de Poe en une vulgaire expérience de physique amusante marquée par un consternant scientisme.
Plus gravement encore, et là Jean-Luc Steinmetz ne peut s’empêcher de parler de « platitude », les plus sublimes trouvailles de Poe, celles qui président à la description de l’île antarctique de Tsalal, à sa géographie paradoxale, à ses abîmes alphabétiques, à son eau singulière dont la nature organique fut naguère étudiée par Jean Ricardou dans un de ses articles les plus convaincants (1), tout cela est purement et simplement omis par Verne, bien incapable en effet de suivre le maître américain sur son propre terrain, celui du fantastique à l’état pur. Ce qui fait du Sphinx des glaces un hommage certes révélateur des ambitions cachées de Verne (aller au-delà – il s’en vante imprudemment auprès du fils Hetzel – des fantasmagories de celui qu’il croit à tort être son prédécesseur dans la création d’un certain « extraordinaire » parascientifique), mais bien plus crûment une preuve qu’il est dangereux de se mesurer au génie quand on n’a qu’un grand talent.
Le dernier roman convoqué par l’entreprise risquée que constituait la promotion de Verne en « Pléiade » conduit alors le lecteur à revenir sur son agréable relecture de cet ensemble, et à poser le problème essentiel du statut de l’auteur de tant de best-sellers du XIXe siècle comme écrivain authentique. Comment éviter alors de constater que l’introduction générale des deux volumes par un universitaire d’un goût aussi sûr que Jean-Luc Steinmetz témoigne tout du long de son embarras ? Il y a, en effet, beaucoup à lire entre les lignes de cette analyse qui se veut enthousiaste mais où les réticences sont palpables. Veut-on un signe non équivoque de cette gêne ? On le trouvera dans le fait de rappeler, au titre d’attestation majeure du génie littéraire de Verne, le témoignage éperdu de Raymond Roussel. On sait que ce dernier considère comme un dieu vivant celui à qui il rendit à Amiens la visite du plus inconditionnel des pèlerins. Mais on se souvient aussi que, dans un essai célèbre, Alain Robbe-Grillet put écrire que l’incomparable ensemblier de Locus Solus n’avait rien à dire et le disait mal. C’était là discuter avec humour le style terne du faux romancier et vrai poète Roussel, avant de montrer qu’il était, du fait même de son apparente stérilité d’écriture, un génie littéraire pour qui – selon la formule même de Comment j’ai écrit certains de mes livres – « l’imagination est tout ». Jugement auquel, après les belles éditions de Roussel par Annie Le Brun chez Pauvert, on ne peut que souscrire tout à fait.
Mais Verne ? Chez lui aussi l’imagination, quand elle s’affole (dans ces chefs-d’œuvre oubliés que sont Les Indes noires, La Jangada, Le Château des Carpathes, titres qu’il n’aurait peut-être pas été incongru de substituer au Sphinx des glaces), produit des merveilles. Mais, constante chez Poe, et chez Roussel, elle n’est dans la plupart des romans de Verne que sporadique, produisant alors ces fulgurations que l’on trouve dans Le Voyage au centre de la terre (la mer souterraine), Les Enfants du capitaine Grant (l’arbre géant où Paganel, cet Ariel géographe fabriqué à partir du Papageno de Mozart, concurrence les oiseaux), et en cent endroits de L’Île mystérieuse, le plus constamment réussi de ses grands livres.
Partout ailleurs que dans ces moments de folie écrivante, les défauts d’écriture littéraire abondent et la lecture suivie les repère sans peine chez un auteur qui abuse des effets téléphonés empruntés au mélodrame le plus inepte de son temps, des pantins clownesques auxquels il laisse le soin, par leurs plaisanteries vaudevillesques de garçons de bains, de détendre l’atmosphère dramatique, pour ne rien dire du remplissage d’intrigues vides par le recopiage pesamment informatif d’Élisée Reclus et autres compilateurs. Mais je crois surtout qu’un lecteur actuel lui pardonnera mal la nullité d’une majorité de ses personnages féminins, stéréotypes geignards, d’une insupportable bondieuserie, de l’épouse ou de la fille conventionnelle que le mari ou le père idolâtre (voir Grant et les femmes de Lord Glenarvan ou Glénervant) avec les « transports » les moins crédibles qui soient.
De ce point de vue, le choix de la « Pléiade » se révèle d’ailleurs pertinent en soi. Grant, où l’élément féminin joue un trop grand rôle, montre des faiblesses que Vingt mille lieues, histoires de braves, ne présente pas. Mais ce second titre s’alourdit fort de nomenclatures, et seule L’Île mystérieuse, qui ne comporte ni femme ni listes interminables, brille encore aujourd’hui des mille feux d’un imaginaire flamboyant. Est-ce la raison pour laquelle, des trois savantes notices qui accompagnent ces reprises, celle de Marie-Hélène Huet, consacrée à L’Île, est la plus intéressante, tandis qu’Henri Scepi (Vingt mille lieues) tire son épingle du jeu sans apporter au lecteur de nourriture vraiment excitante, et que Jacques-Rémi Dahan (Grant) peine à s’évader du simple résumé commenté de l’histoire et des personnages ?
- « Le caractère singulier de cette eau », Problèmes du nouveau roman, Seuil, 1967, pp. 193-206, cité par Jean-Luc Steinmetz dans la note 2 page 1 195 de sa notice du Sphinx des glaces (volume II). J’ai proposé, en m’appuyant sur le précédent de cet article de Ricardou, qui correspond aux meilleures années de la théorie du Nouveau Roman, ma propre interprétation du même passage énigmatique de Pym et l’expression « abîmes alphabétiques » est de moi : « Le caractère singulier de cet autre », numéro spécial d’Esprit « L’espace du texte », décembre 1974.

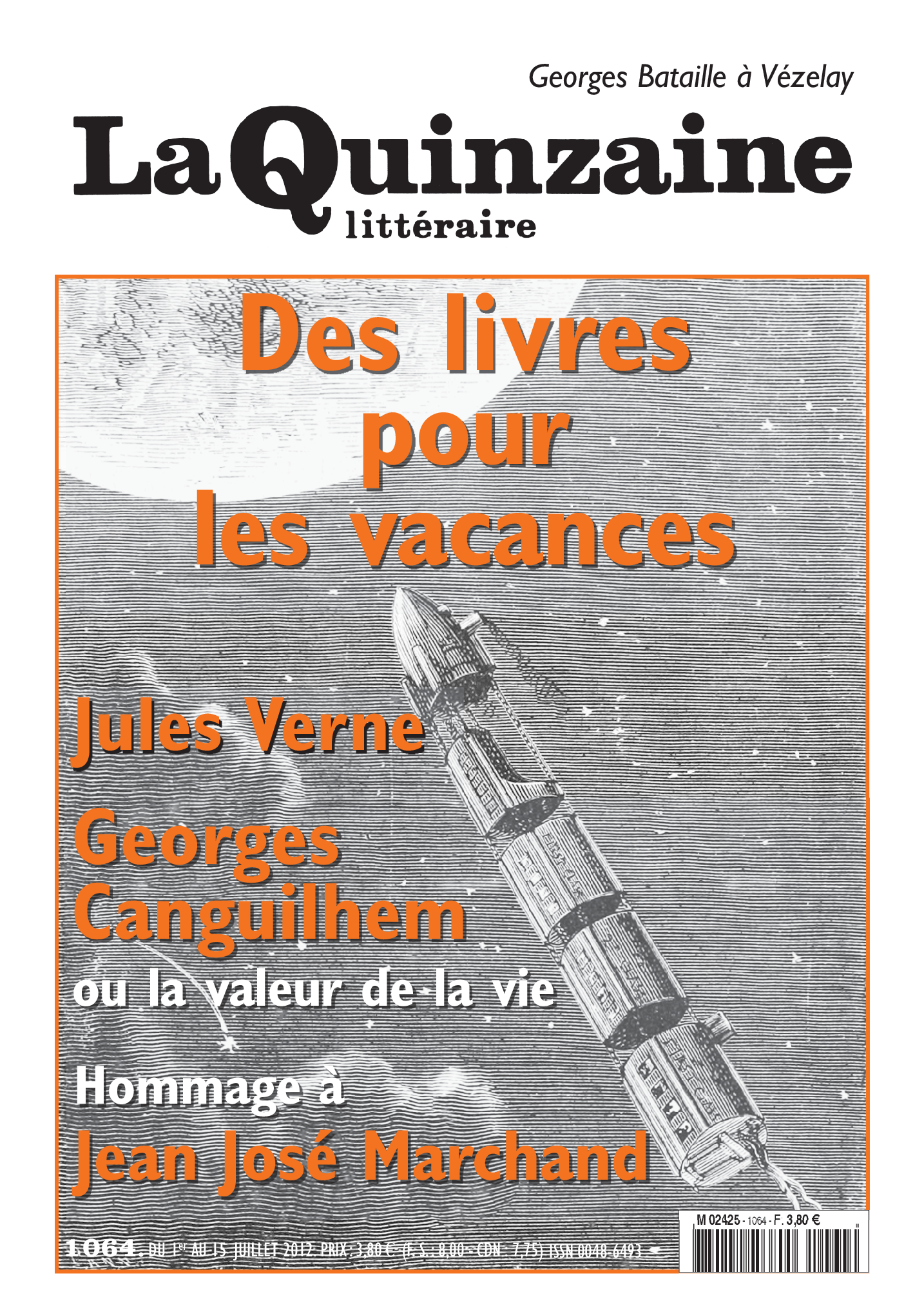

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)