Si l’on voulait continuer de jouer sur les titres des œuvres de Drieu, et sur deux titres qui ne figurent pas dans cette sélection, on songerait à L’Homme couvert de femmes ou à Histoires déplaisantes. Drieu s’y retrouve, l’air un peu fatigué, la cigarette entre les lèvres. Il a connu bien des succès sentimentaux, s’est lassé, en dandy. Et puis ce qu’il écrit, ce qu’il met en relief, ressemble à ces histoires déplaisantes évoquées il y a un instant. Mais pourquoi reste-t-il sinon actuel du moins intéressant ? D’abord parce qu’il est cet homme capable de s’emballer, d’adhérer à son temps avant de renoncer, de s’isoler. Drieu est un intellectuel dans l’entre-deux-guerres. Ses contemporains se nomment Berl et Aragon, Malraux, Breton ou Martin du Gard. On n’en finirait pas de dresser la liste de tous ces écrivains qui, dans l’essai, le journalisme, le reportage et bien sûr le roman, se confrontent à leur présent et s’affrontent. Drieu a été des leurs. Berl a été son meilleur ami et ils ont fondé ensemble la revue Les Derniers Jours. Il deviendra « Le Juif Preuss », dans Gilles, le roman par lequel, d’une certaine façon, Drieu solde les comptes avec son époque. « L’antisémitisme l’a pris comme un diabète », écrit Berl en 1956, comme pour l’excuser. Ce diabète-là avait frappé Céline, Brasillach et tant d’autres, mais on préfère se rappeler tous ceux qu’il a épargnés. Les pages du Journal publié il y a quelques années sont effrayantes, plus par leur bêtise aveugle que pour d’autres raisons.
Aragon était l’autre compagnon, quand Drieu côtoyait les surréalistes. Les deux jeunes gens fréquentaient les mêmes maisons, les mêmes femmes. Dans Gilles, Galant (Aragon) est une cible parmi d’autres mais Drieu tait ce qu’il sait des goûts de son ancien ami. Et puis Jacques Rigaut, proche compagnon d’un temps, devient le héros du Feu follet, après l’avoir été de La Valise vide. Celui que nous pouvons tenir pour l’un des grands écrivains sans œuvre, à l’instar de ce qu’en pense Vila-Matas, est surtout dénigré par son ex-ami. Dénigré vraiment ? Pas sûr ; plutôt perçu comme l’un de ces doubles qui l’effraient.
Drieu est d’abord un homme déçu, tant par ses amis que par l’homme qui émerge de la boucherie de 14-18. « L’homme moderne est un affreux décadent » note-t-il dans Gilles. Tout se serait effondré avant, il y a un certain temps. Le Gilles de Watteau, peint vers 1720, reste un idéal. Il y voit « une belle figure de Français, pleine de bonne volonté, mais prête aussi à s’inquiéter de ce qui ne va pas en France ». Lors d’une visite au Louvre, en compagnie de Victoria Ocampo, il dit à l’intellectuelle argentine combien il se reconnaît en lui. La toile, il est vrai, traduit la mélancolie, et en arrière-plan, la moquerie. Et Drieu est un homme seul, très souvent. Dans Blèche, il a cette phrase qui vaut pour lui comme pour son personnage : « Je n’ai plus cru en rien tout à coup. »
Drieu nous est proche en ce sens. On sent la fragilité, la fêlure. Certes, comme l’écrit une critique de l’époque à propos de Gilles, il est « un des grands poètes de la méchanceté » quand il raille les hommes politiques des années trente, mais ce n’est pas ce que nous retenons de lui. L’échec est plus flagrant. Il n’a pas la haine obstinée d’un Céline, cette haine qui le tient vivant. Il n’a pas l’énergie d’un Malraux (sans doute l’un de ses pires rivaux, peu épargné dans Gilles), il n’a pas le talent insolent d’Aragon. À son propos, et cela restera longtemps, on parle de charme et de désinvolture. Le charme est fugace, incertain ; la désinvolture serait stendhalienne pour le meilleur. C’est le cas lorsqu’il se fait cynique et retrouve les accents de Lucien Leuwen. Mais sa manière de bâcler les fins n’égalera jamais celle de l’auteur de La Chartreuse de Parme. On n’invente pas Fabrice Del Dongo toutes les semaines, ni tous les siècles. Drieu est un romancier de ce XXe siècle qui se soûle d’idées, de concepts et d’élans pas tous aboutis. Ses romans sont à cheval sur plusieurs genres. Rien de surprenant si on raisonne sur le genre romanesque à l’échelle mondiale. Après tout, il est contemporain de Mann, de Musil et de Broch. Mais les connaît-il ? Il est aussi contemporain de tous ceux qui comme lui ont vécu les tranchées, ont appartenu à cette génération mutilée, survivante, désireuse de vivre ardemment son temps. Et mêler la réflexion et le romanesque, user du registre satirique ou tenter le lyrisme sont des façons de vivre intensément. Plusieurs romans de Drieu sont empreints de cette tonalité satirique qui prendra toute son ampleur dans Gilles. La satire est d’abord celle de la bourgeoisie, puis celle des intellectuels, mais le Gonzague ou le Alain des premiers textes, qui lui ressemblent beaucoup, sont aussi victimes de cette satire. Un roman, qui ne figure pas dans cette anthologie, L’Homme à cheval, tente de contrebalancer cette tendance par l’usage du registre épique. Sans aboutir complètement.
Drieu l’inaccompli, pourrait-on résumer. Son œuvre est abondante mais aucun texte ne s’en dégage nettement, n’a valeur de manifeste ou ne résiste à la critique. Gilles est un roman important, assez symptomatique de l’époque, mais on ne peut citer de pages qui marqueraient. Le Feu follet a l’éclat de certaines étoiles, fugitif. La Comédie de Charleroi mérite qu’on s’y arrête. Drieu n’a toutefois pas le brio, l’élégance de Morand (surtout le nouvelliste), pas la beauté de certains Giono, pas le délié d’Aragon, pour ne citer que ceux-là. Il est autre. Est-ce ce qui nous le rend proche aujourd’hui ? Cette dimension inaboutie ou le pessimisme qui va s’accentuant au fil des années conduisant au désastre de 1940 et d’après ? Ou bien reste-t-il loin, figure d’un Temps en noir et blanc, hanté par ses rêves et ses hurlements de haine, que ce Gilles devait considérer avec un peu de mépris.
Norbert Czarny

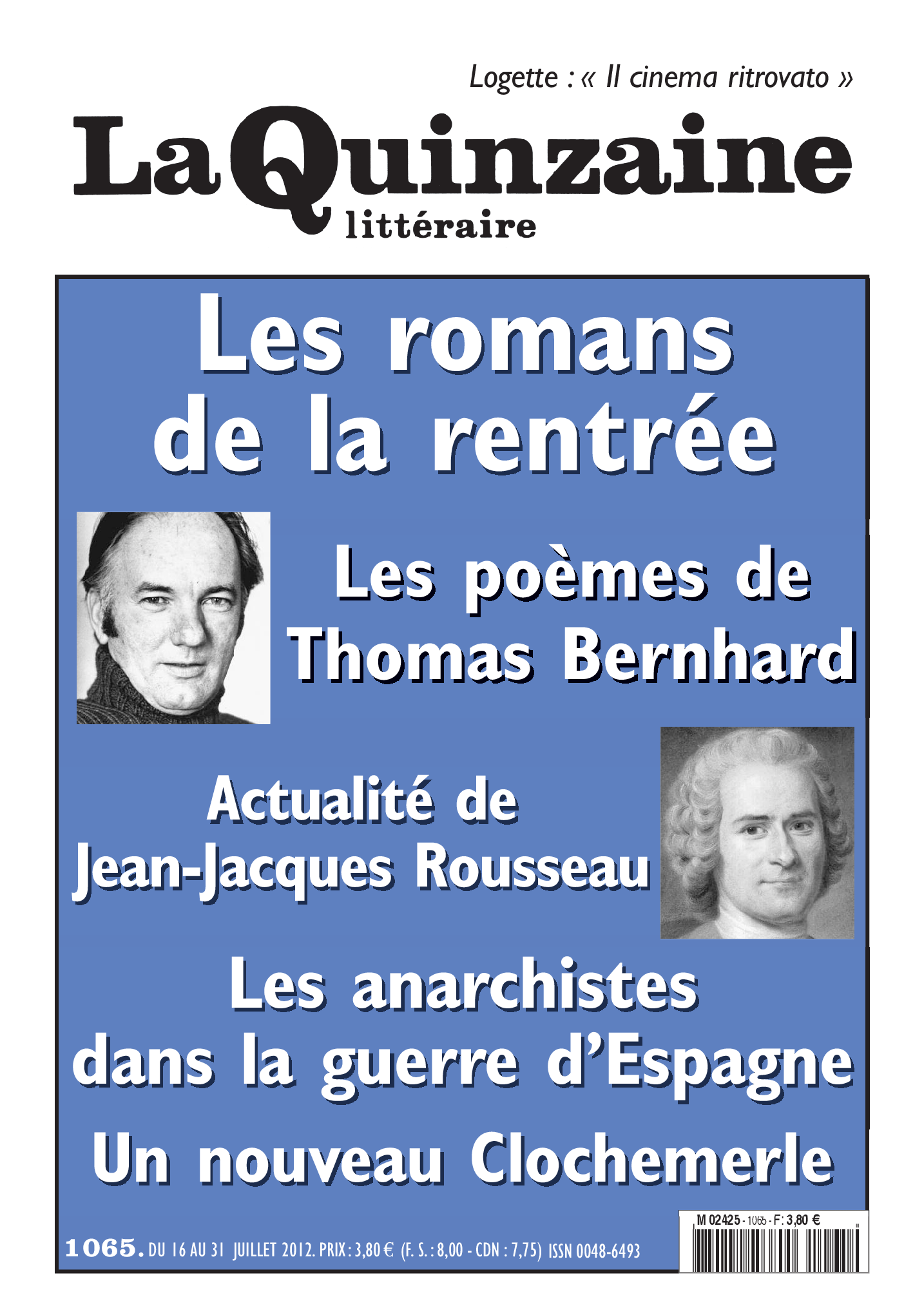

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)