Omar Merzoug – Comment analysez-vous la crise de 2008/2009 dont les effets se font encore sentir ?
Alain Touraine – Remarquons d’abord que nous sommes dans une période dominée par la crise et qu’intituler ce livre Après la crise ne signifie pas naturellement que la crise est derrière nous.
Il s’agit d’une crise systémique : on n’avait aucun moyen de rétablir la confiance. Il a fallu pour cela faire une opération éminemment discutable et discutée et même que certains économistes reprochent à Obama, c’est-à-dire jeter dans le trou toutes les ressources dont on dispose. Entre Obama et les grands pays européens nous avons tous ensemble jeté 2 trillions, 2 000 milliards de dollars, moyennant quoi des entreprises connues, comme la General Motors, qui était plusieurs fois en faillite, ont pu ne pas déposer leur bilan. Il y a des banques à qui on a évité la faillite cinq ou six fois.
Or, il faut remarquer que cette crise n’est pas une crise mondiale, c’est une crise occidentale. Le monde va bien, va même très bien. L’Afrique, l’Amérique latine, l’Asie ont de la croissance et même beaucoup de croissance et il n’y a qu’une zone principale qui subit un marasme : l’Occident et une zone, qui pèse très peu, et c’est le monde arabe. Voilà la nature de cette crise, elle joue sur un phénomène énorme, classique, qui est le même que celui de la crise de 1929, la finance se sépare de l’économie. Il vient un moment où l’essentiel des ressources du globe ne sert pas à faire de l’investissement ou du crédit, mais de la spéculation. On est là dans une crise d’une extrême gravité et que fait-on ? Ça fait quatre ans que ça dure, on ne fait rien. On dit qu’on va faire des économies, mais ce n’est pas la crise de 2007 qui a inventé le déficit. Il y a un certain nombre de pays moins importants, qui ont été mis en faillite par la crise, la Grèce, l’Islande, l’Irlande, la Hongrie, les pays baltes. La Grèce a été la plus grosse affaire et il s’est produit un événement important : les Allemands ont refusé de payer pour la mauvaise gestion des Grecs. Alors on a réussi à les convaincre que, sans eux, on n’y arriverait pas, et que ça a fait payer aux Grecs et, à nous aussi, des charges plus lourdes. Là, c’est plutôt le FMI qui nous a sorti d’affaire avec l’idée qu’il faudrait créer un FME (Fonds monétaire européen), ce qui n’est pas une mauvaise idée en soi. La faillite grecque a pesé lourdement sur nos finances, mais si par exemple l’Espagne s’effondre, on ne voit pas qui pourrait éponger la facture. Ce qui empêche l’Espagne de tomber, si elle tombe, la zone Euro tombe. Tout ça n’est pas brillant.
Retenons les points essentiels : vous avez une industrie financiarisée avec une absence de contrôle public énorme mais selon moi ce qui s’est surtout produit, c’est quelque chose d’inouï : c’est que nous avons toujours été habitués à considérer qu’une société, c’était de l’économie, de la société, de la politique, de la culture. Tout ça se tient, était interdépendant. Actuellement, c’est devenu faux. Il s’est produit une séparation de la finance et de l’économie doublée d’une séparation de la finance, de l’économie et de l’ensemble de la société ; c’est ce qu’on appelle la globalisation.
O. M. – Vous dites à un moment dans votre livre : « ce qui est en ruine, ce sont les acteurs, les modes de domination, les conflits traditionnels et les interventions de l’État au sens classique du terme ».
A. T. – Ce qui se passe, c’est que l’économie productive, financière, technologique largue les amarres de toutes les sociétés, l’économie globalisée, on le voit dans l’aspect crise, n’est plus contrôlée par personne. Nous tenions à une définition, c’est que nous étions un pays de réformes, il n’y a plus de réforme possible, de prise possible à une réforme, ce monde de la globalisation est hors de portée de tous, de la Banque mondiale, du FMI et de tous les organismes, et je dirais, c’est hors de portée du président des USA. Le Président a réussi à bloquer la crise, je m’en réjouis, à rétablir un minimum de confiance, il n’a pas rétabli le contrôle de la Banque fédérale américaine ou de la Banque européenne sur ce monde, qui est une sorte de cumulus nimbus qui passe au-dessus de nos têtes et qui nous envoie de la grêle et qui n’est pas contrôlable.
Depuis cinquante ans, en Europe quel que soit le gouvernement de droite ou de gauche, c’est une Europe social-démocrate. Nous dépensons la moitié de notre revenu national hors du marché, à travers l’État, la Sécu, tous les systèmes de protection, tout à coup (je ne parle pas de communisme, il s’est effondré il y a vingt ans), mais maintenant c’est la social-démocratie qui s’écroule. Et par conséquent, nous sommes dans un monde sans contrôle. Du reste – je ne veux pas trop toucher à l’actualité –, la France vient de donner un exemple où la politique n’a aucun rapport avec l’économie, on aurait pu imaginer qu’on allait proposer un débat politique sur les retraites, ça le méritait bien, mais dans l’ensemble non.
O. M. – « L’écroulement du système bancaire international a créé un choc et des peurs, mais n’a pas suscité de réaction massive de la part des victimes » ? Pourquoi ?
A. T. – Pour un ensemble de raisons. Permettez-moi de faire une comparaison pour rendre votre question plus intéressante. Après 1929, il y a eu des réactions nombreuses. La pire fut le nazisme. Mais, en 1932, Roosevelt est élu. Les Américains étaient socialement très en retard : ils font des réformes et ils parviennent là où en étaient l’Angleterre ou l’Allemagne en 1880. En France, il y a le Front populaire et on rattrape une grande partie du retard. Là, vous avez des crises commandées en grande partie par les économies nationales ou les plus fortes, tandis que dans la crise actuelle, il n’y a plus de responsable. On ne sait plus sur quoi agir, parce que les choses se passent à un niveau où les gouvernements n’ont pas prise.
Mais vient un moment où ceux qui sont écrasés relèvent la tête. Ça a commencé par la révolte contre le roi, c’est la Révolution française, ensuite les salariés finissent par se regrouper en syndicats et finissent par obtenir des droits. Quant aux colonisés, ils s’émancipent de manière pacifique et d’autres de manière plus violente comme les Algériens. Les femmes obtiennent une certaine égalité. Ceux qui ne se sont pas libérés, ce sont les enfants, mais nous commençons à être sensible à cette dimension-là, les affaires de pédophilie et d’inceste le montrent.
Dans nos pays, la seule force de mobilisation qui peut nous amener à recontrôler l’économie, c’est de faire appel aux valeurs universelles. Pendant longtemps les droits de l’homme avaient disparu. Avec l’arrivée de la société industrielle, on n’en parlait pas, c’était rangé dans la catégorie des droits dits « bourgeois ». Aujourd’hui ça réapparaît à toute force et hélas, cela ne parvient pas au niveau d’une forme d’organisation politique. Ce que je défends comme idée, ce thème de la dignité humaine, est une revendication existentielle et repose sur du vécu.
Propos recueillis par Omar Merzoug.
Omar Merzoug
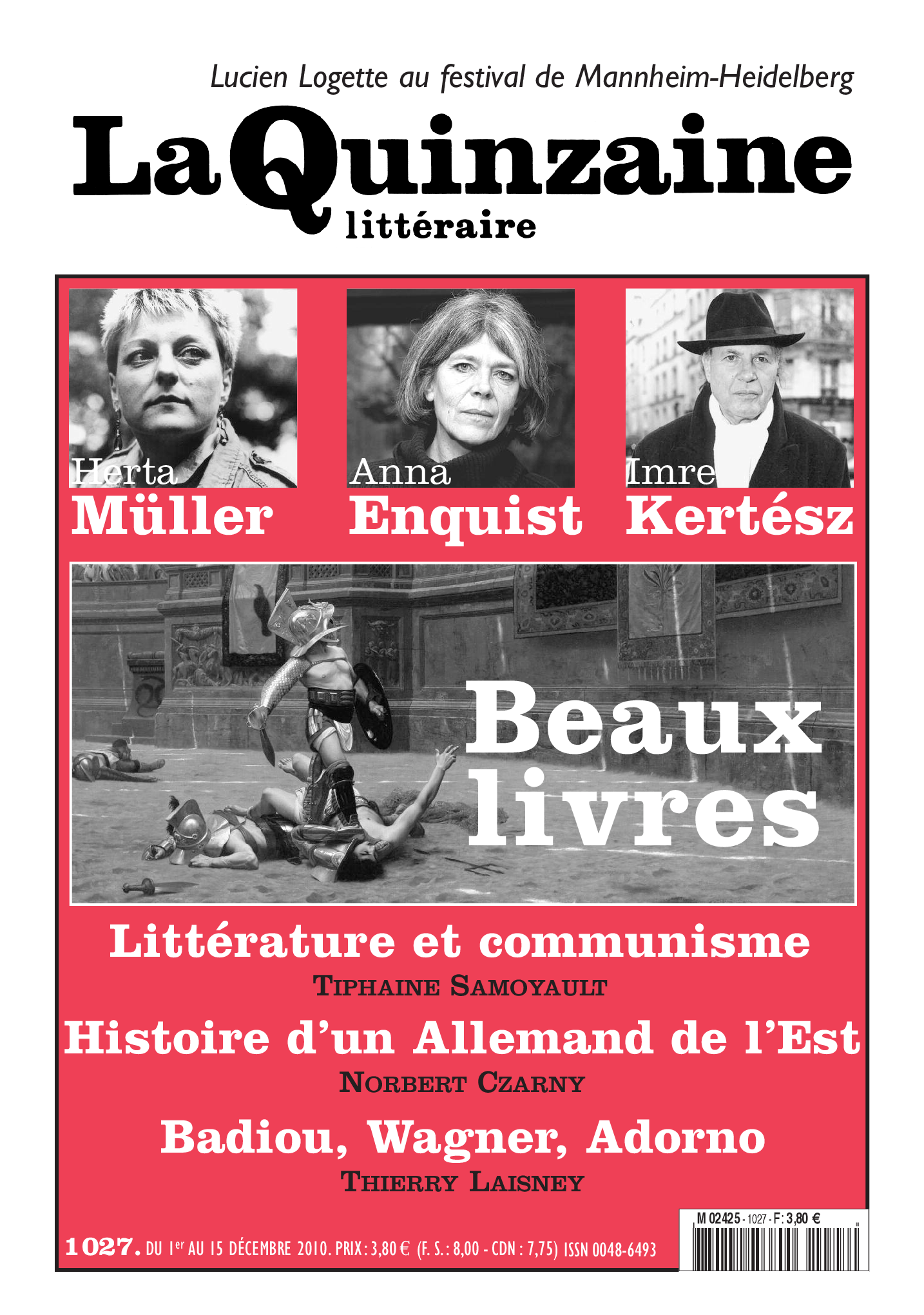

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)