JEAN-PAUL CLÉBERT
PARIS INSOLITE (ROMAN ALÉATOIRE),
AUTHENTIFIÉ PAR 115 PHOTOS DE PATRICE MOLINARD
Attila, 352 p., 22 €
Les éditions Attila republient l’ouvrage de Jean-Paul Clébert avec, pour la première fois depuis 1954, les photographies de son comparse Patrice Molinard. Une sorte d’aventure pédestre et humaine dans un Paris de la débrouille plein de surprises et d’émois.
Jean-Paul Clébert, fils de la bourgeoisie proprette du XVIe arrondissement, s’enfuit, alors qu’il n’a que seize ans, pour courir les filles et s’engager dans la Résistance. Il se jette dans la gueule du monde, se libère de son milieu et fait mille expériences qui l’entraîneront, pour quelques semaines seulement, jusqu’en prison. Il entreprend l’aventure de sa vie, libre, désœuvré. Il ne connaît pas de moule. Et il revient. Il retourne à Paris après la Libération, réinvestit les cloaques miséreux de cette ville qui grossit, s’extirpant, au prix de sacrifices humains et de la destruction d’un milieu entier, du XIXe siècle pour entrer dans la modernité citadine. Les zones franches et anarchiques sont sur le point de disparaître, les faubourgs mutent à toute vitesse, certains hommes périclitent, perdus, au bord du chemin d’un nouveau monde. C’est l’aventure de ces quelques semaines du retour dans la ville lumière dont il va, réinvestissant les ombres, penché, le godillot usé et la faim au ventre, faire le récit passionné.
Paris insolite est un livre « écrit à la sauve-qui peut dans les bistrots et sur les places publiques, au ras même des trottoirs où s’en passait l’action », franchement, par un homme dont l’expérience fait « partie vivante du paysage », un homme qui erre par les rues, au hasard des rades familiers, changeant sans cesse de logis, allant de mal en pis, affamé, mais les yeux grand ouverts sur une réalité qui aurait pu lui échapper. Car il s’agit de la vision d’un homme, de sa manière de percevoir le monde terriblement dur qui l’entoure, manière d’auscultation d’un Paris conçu comme « une cour des miracles ». Dans ce livre, la parole est action, suit l’action, l’entreprend avec l’énergie du désespoir et un appétit de vie féroce, inépuisable. Clébert raconte tout, la misère, la grandeur des petites gens, les douleurs quotidiennes, les liens qui unissent la population, les flics qui le regardent de travers, ses petits boulots, les souffrances des vagabonds, la sexualité, la prostitution, le labeur des chiffonniers, les repères dessansabri, les quartiers un à un parcourus, l’architecture, la Seine, la vraie bohême, dure, ravageante. Il raconte au fil de ses pérégrinations – qu’accompagnent les très belles photos de Molinard magnifiquement traitées par les éditeurs –, faisant le tour d’un Paris qui semble à la fois gigantesque et minuscule, la foultitude de ses expériences et de ses rencontres, les regroupant par thèmes, rebattus, comme si l’expérience était sans fin.
Mais Clébert, avant tout, s’avère un vagabond à la langue fertile, à la prose enivrante, riche de mille trouvailles, d’une spontanéité fascinante, fluide, profonde, chargée à la fois de sa rancoeur terrible contre un certain état du monde et d’un appétit formidablement joyeux pour la vie de cloche, celle qui rend tout possible. Il écrit que : « La ville est inépuisable. Et pour la conquérir il n’est d’être que vagabond-poète ou poète-vagabond. » Il écrit le roman des humbles, desinvisibles miséreux, un livre de la déambulation et du hasard. Le lisant, on pensera à Cendrars, à Céline. Roman spontané de l’aléa, Paris insolite est un requiem pour « le caravansérail extraordinaire », une tentative de saisir « la poésie à l’état brut », de proposer une « poétique des paysages citadins », d’envisager la ville comme le poumon de l’œuvre, de la rendre vivante, précise, d’en révéler les secrets et la langue, de la donner à voir complètement, mise à nu.
JULIO LLAMAZARES
LA PLUIE JAUNE
La Lluvia amarilla
trad. de l’espagnol par Michèle Planel
Verdier, coll. « Poche », 144 p., 9,80 €
Dans une vallée reculée des Pyrénées aragonaises sur les flancs de laquelle périclitent quelques maisons, semble dormir un village abandonné, manière de désert sur lequel tombe « la pluie jaune de l’oubli », un regroupement de vieilles maisons sur lesquelles, lentement, la Nature reprend ses droits : Ainielle. Seuls le vent venu de France et quelques bruits d’oiseaux ou le cri d’une chienne viennent troubler le silence éperdu de la combe qui semble ensommeillée d’ombres et de silence. La pluie qui peu à peu baigne tout d’une lueur jaune s’apparente au leitmotiv d’une ruine progressive, au grignotement de l’oubli, à la nostalgie qui s’empare des êtres, à la suspension du temps, à la terreur de se perdre. Un couple n’a pourtant pas délaissé ses lieux abandonnés et s’obstine à maintenir un semblant de vie alors que tous les habitants s’en sont allés, rendant aux solitudes montagnardes ce hameau minuscule. Et, lorsque Sabina, l’épouse taiseuse, se pend dans la grange, à la corde même qui avait servi à suspendre un sanglier, l’univers familier du narrateur, homme vieilli et atrocement seul, s’écroule. Il se laisse glisser alors dans le néant, disant, comme dans un murmure : « Dès lors, j’ai vécu en me tournant le dos. »
La langue de Llamazares semble habitée, animée d’une force extraordinaire, tendue, faite pour le désert qu’elle décrit avec une précision et un lyrisme implacables. Lisant ces pages retenues et affermies, nous découvrons un langage d’où sourd une raucité sauvage, une voix désespérée. Le langage tisse alors un lien presque inexplicable, mystérieux, de plus en plus incompréhensible, qui unit l’Homme à la Nature, aux saisons qui passent, au vent qui, inexorablement, revient, aux bruits cristallins de la neige qui fond et s’égoutte des toits, aux bruissements de la végétation, aux remuements de la forêt. La Nature se conçoit alors à la façon d’un antidote à la solitude, comme une aventure répétitive de la survie, elle se fait corps elle-même. La pluie jaune est un récit de l’ultime solitude, d’une terrible déréliction, la chronique d’un abandon. Le narrateur, « comme un survivant entouré des vestiges d’un naufrage », n’attendant que la mort, s’abandonne à l’hébétude de cette solitude, s’y laisse choir pour mieux sentir la perte de soi-même. Le roman suit la chronique d’un être perdu – en lui-même et dans le lieu qui le fait – qui s’interroge sur l’après, sur ce qui adviendra inéluctablement, se questionne sur la survie d’un milieu dans une époque, sur l’écart infranchissable qui les séparent plus le temps passe, inquiet, ne se parlant qu’à soi, devenu incompréhensible, inconnu du monde contemporain. La pluie jaune peut tomber et rincer le monde, ne demeurent que les ruines, et le passé s’enténèbre jusqu’à n’être plus. Le narrateur s’achemine vers sa fin, imaginant sans cesse ce que penseront ceux qui viendront bien un jour, de sa vie, de son monde englouti, abandonné, et s’étonne, bien que résigné, qu’il puisse disparaître si vite, comme le dernier souffle d’un agonisant que soudain plus personne ne perçoit. Llamazares l’écrit, fataliste et indigné à la fois : « Et que la nuit aille à la nuit. »
JACQUES FRESSARD
RICARDO PIGLIA
LA VILLE ABSENTE
trad. de l’espagnol (Argentine) par François-Michel Durazzo
Zulma, 199 p., 20 €
Avec l’humour qui lui était consubstantiel Macedonio Fernández – qui fut un des maîtres de Borges – soutenait qu’il fallait qu’eût paru l’ultime mauvais roman (entendez le roman miroir qui se veut une copie de la réalité) pour qu’il pût enfin offrir au public le premier bon roman de création pure, dont il écrivait en attendant sans discontinuer les multiples prologues possibles dans son Musée du roman de l’Éternelle, dédié à sa jeune épouse Elena trop tôt décédée.
L’idée au moins a été stimulante puisqu’on peut considérer qu’elle a inspiré la Marelle de Cortázar et plus récemment cette Ville absente où Piglia élargit à l’ensemble du pays et de son histoire le tableau qu’il avait donné dans Respiration artificielle (1) de l’étouffante Buenos Aires quadrillée par l’armée.
La violence urbaine se double ici d’une violence rurale, comme enregistrées l’une et l’autre par la machine à narrer éternelle dont avait rêvé Macedonio, de sorte que se trouvent mêlées toutes les trames et les tonalités possibles. On retrouve, dès le début, le personnage de Renzi, un habitant de la capitale qui se souvient de l’époque où « son vieux passait des nuits entières à écouter les bandes magnétiques de Perón [alors en exil] que lui rapportait clandestinement un envoyé du Mouvement ». La dégringolade du pays est captée dans le goût expressioniste à travers une ancienne chanteuse de tangos devenue alcoolique réfugiée dans un hôtel de passe. Autre figure archétypique de la nation, un gaucho se trouve avoir été converti à l’anarchisme par le fameux militant italien Enrico Malatesta. Le cavalier rassembleur de bétail, ou l’un de ses compagnons, ont vu les cadavres empilés dans les puits, les dizaines de fosses rapidement comblées avec de la chaux qui refait surface en de multiples rectangles blancs, comme « une carte de tombes » à travers la pampa.
D’innombrables histoires traversent ainsi le livre. Chacune est absolument saisissante et emblématique de la violence ou de la passion. Chacune s’efforce à un dessin imprévisible. Bon nombre sont à double fond, intertextuelles, et nous renvoient à d’autres histoires issues d’autres romans et d’autres auteurs de la littérature universelle. On y rencontrera plus souvent bien sûr des souvenirs de Finnegans Wake que de Madame Bovary, encore que Macedonio lui-même semble avoir eu quelque compréhensible faiblesse pour Bouvard et Pécuchet. Quoi qu’il en soit on est irrésistiblement porté à poursuivre sa lecture. « Je suis pleine d’histoires, je ne peux m’arrêter » dit le dernier personnage féminin aux dernièreslignes de la dernière page. On y consent aussi mais quelques notes infrapaginales auraient été bienvenues pour éclairer notre lanterne sur certains héros spécifiquement argentins.
1. Éd. André Dimanche, 2000, dans une traduction d’Isabelle et Antoine Berman, voir QL n° 794.
Hugo Pradelle
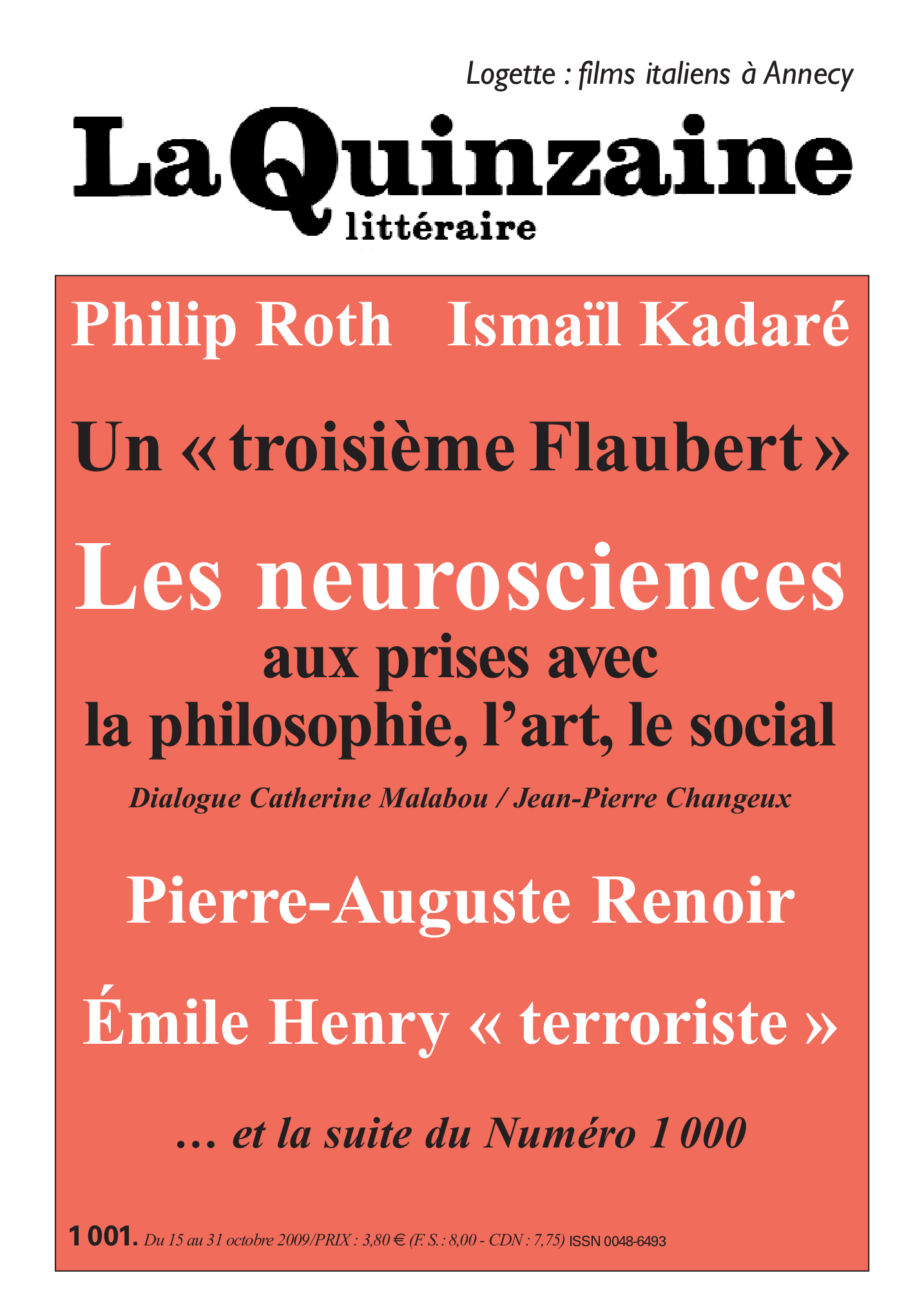

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)