Poisons de Dieu, remèdes du Diable est un roman des rebours, du temps impénétrable, des psychés, des illusions et du langage qui en conforme le labyrinthe tortueux. Tout y est voix. Les êtres égarés qui le hantent ne s’occupent que d’un éternel retour sur soi, d’un monde contrefait où ils peinent à survivre, du temps qui passe et détruit tout sur son passage, de la perte qui les déchire, de ces fables qu’ils se murmurent dans la pénombre, des lieux presque maudits qui décantent les culpabilités et les remords indicibles, de la tristesse inénarrable qu’il y a à vivre, de l’intranquillité fondatrice qui les défait. C’est un roman de la fuite et de la sédentarité, d’une confrontation terrible aux confins du monde, de voix qui se brisent dans leur propre néant, de l’inutilité de la vie, du trouble de la parole et du rêve, des vides qui ne se peuvent jamais combler.
Comme souvent chez Couto, le paysage dit presque tout. « La brume – qui a donné son nom à Vila Cacimba – c’est la suie des nuages. Et nulle part ailleurs dans le monde il n’y a autant de nuages qui brûlent. » Voici l’un de ces coins les plus reculés et les plus arides du Mozambique où tout semble réglé par une météorologie de songes qui irévèlent des êtres profondément habités par un malaise défiant la raison, des gestes barbares, des secrets à la fois grotesques et terrifiants qui semblent dire toujours plus avant la folie, la brutalité des mots, la cruauté singulière d’êtres à la limite d’eux-mêmes et de l’humanité. Tout y est étrangement instable, changeant, bouleversé, et les personnages semblent devoir errer à la frontière de la réalité, souffrant sans limites et s’égarant dans les fables qu’ils s’obstinent à se confier dans les ténèbres brûlantes d’une Afrique angoissante.
Là, dans cette manière de désert, au fin fond du monde, un jeune médecin lisboète visite chaque jour un étrange malade confiné dans sa chambre remplie d’ombres, « forteresse » où il « s’est enfermé et s’étiole depuis des mois », souffreteux et amoindri, « lent comme de la lave froide ». Y « mâchant des souvenirs », ressassant sa fascination pour la mer, cette « habile dessinatrice d’absences » hantée par une vieille rancune, dissimulant dans son « antre » les lourds secrets d’une vie finissante qui ne se résume plus qu’à une trop longue « dispute » avec son épouse, il n’est plus que l’ombre de lui-même, souhaitant disparaître sans mourir vraiment, ne pouvant finalement plus que « s’imbéciliter à la fenêtre pour les filles qui passent ». C’est dans cette haine recuite qui est aussi de l’amour que survit l’infernal couple que forment Bartolomeo et Munda, laquelle pleure à heures fixes, entretient le docteur étranger du « médicament définitif » qu’il faudrait prescrire à son époux, lui confiant leurs souffrances innombrables, leurs étranges conditions de Noirs écartelés entre le présent, leur fille absente et l’époque ambiguë de la domination lusitanienne, s’abîmant dans sa propre voix qui n’est « qu’une variation du silence ». Au-dessus de ce trio improbable qui fouille le silence et des paroles vaines, une épidémie « nébuleuse » de méningites fait rage, emportant très vite des malades innombrables que « les mauvais esprits habillent avec leurs ordures ».
Pourtant, cet univers étréci qui semble tourner tout entier par des mouvements hasardeux de la parole, toujours par appositions abruptes, comme par sursauts successifs, n’est pas qu’un simple aléa injustifié. Le médecin n’est pas ici pour rien, il est à la recherche d’une femme noire qu’il a passionnément et brièvement aimée à Lisbonne. Persuadé qu’il « ne reviendrait plus de cette étreinte », que « le corps de l’un » était « le drap de l’autre », réalisant « qu’il souffrait de son incertitude », il met son « existence dans une valise » et part, « dépouillé de mémoire, dépourvu de regrets », pour ce village perdu où, obstinément, il attend son retour, entretenu d’illusions par sa parentèle bavarde et fascinante qui le tient dans les rets de sa parole infinie. Le roman ne consiste qu’en la déportation perpétuelle de cet événement, dans la complication des discours qui lui laissent, par strates successives, par le détournement d’une langue habitée par d’étranges fantômes et d’effrayantes obsessions, peu à peu deviner les secrets obscurs qui les enferment dans un jeu de dupes infini.
Mia Couto déploie, avec une sûreté exceptionnelle, les discours ramifiés, contradictoires et envoûtants de ces êtres perdus en eux-mêmes, les entremêle sans fin pour composer un requiem bouleversant de voix qui s’égarent dans leurs sinuosités compliquées, les faisant revenir toujours au même désir de n’être pas, de vivre ailleurs, de s’oublier dans « une douce inexistence ». Le monde, les relations des personnages, les lieux, les temporalités, tout ce qui est décrit, n’existent que dans le labyrinthe de leurs discours, dans leurs congruences énigmatiques. Couto, comme déchiré par « le couteau de la poésie », parvient, dans une brièveté qui confère au roman une puissance nouvelle (1), comme augmentée par le resserrement formel, à construire un livre tout entier sur la parole, son entremêlement subtil, son questionnement permanent, ses glissements discrets et finalement son angoissante nullité. Par un jeu d’une finesse inouïe, il parvient à enchâsser les discours les uns dans les autres, à entreprendre, dans un même mouvement, le présent et le passé, faisant entrevoir leur pure potentialité, faisant se jouer la nature même du verbe dans des échos infinis qui se répondent pour toucher à l’âme de ces personnages intranquilles.
Car ce qui se joue dans ce bref roman n’est rien d’autre que l’âme, sa nature, les retournements tristes qui la conforment. Dans la langue de Couto quelque chose se perd et quelque chose se gagne. Les discours y trouvent, malgré des errements effrayants, une forme de dignité singulière. Tout ce que les êtres profèrent en ces lieux, si loin de tout, n’est que mensonge ou rêve, qu’une frénésie triste qui ne conduit qu’à la disparition, de la saudade singulière qui nourrit un rapport au monde distordu, incertain, implacable dans sa capacité à se nier toujours plus, à s’empêcher encore et encore, à disparaître lentement en « ce sombre abîme » où nos « pas s’enfonceront toujours ». Mia Couto répète sans fin l’obstination à vivre une vie qui n’en est pas une, à se contrefaire éternellement. Il nous plonge dans l’immensité de la tristesse, nous démontre la capacité humaine à se perdre dans des rêves terribles, invente un langage qui puisse les dire, et répare ainsi, opiniâtrement, les épars sinistres et euphoriques de l’existence, nous accompagnant au bout de la vie, de son deuil, puisque c’est elle « qui est incurable ».
- Nous pensons à Un fleuve appelé temps, une maison appelée terre (Albin Michel) et à L’Accordeur de silence (Métailié, coll. « Suites »), ouvrages précédents de grande qualité certes, mais qui n’avaient pas la même puissance brève et ne concentraient pas autant leurs effets poétiques. Cf. « Quinzaine des libraires n° 11 » sur le blog de la QL.

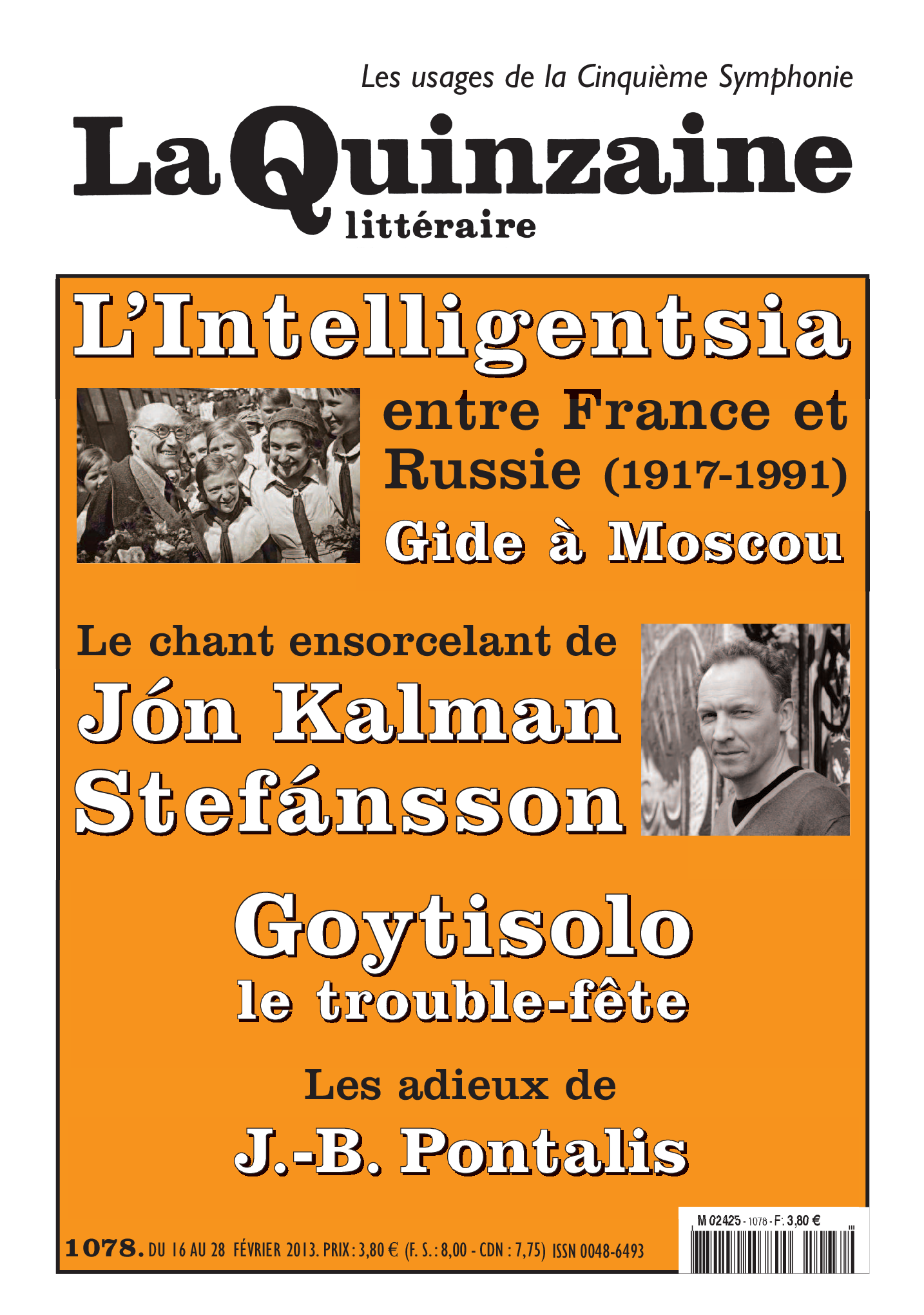

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)