Fuyant les discours techniques, la cueillette puise dans les écrits d’écrivains, de poètes, de musiciens, de philosophes (une courte notice présente l’apport de chaque auteur (1)). Il ne faut pas, en effet, se laisser intimider par ceux qui prétendent que la musique se joue, s’écoute et qu’on n’a pas à en parler. Parler de musique, c’est transformer les sons en musique, c’est faire, selon l’expression de Thomas Dommange, « d’un vulgaire palefrenier un chevalier poursuivant le Graal » (hors anthologie) ; « Que les mots par lesquels nous poétisons la musique viennent à manquer, qu’ils deviennent impossibles, interdits ou illégitimes, que pour une raison ou pour une autre nous soyons contraints de nous taire et que cesse le désir de parler autour du discours musical, et la musique disparaît comme musique (2) ».
L’usage de la musique a suscité la méfiance. Platon, dans La République, redoute la nouveauté : « Qu’on y prenne garde : innover en musique, c’est tout compromettre ; car […] on ne saurait toucher aux règles de la musique sans ébranler en même temps les lois fondamentales de l’État. » Aristote nous invite au discernement : « Puisque la musique est une jouissance, et que la vertu consiste à jouir, aimer et haïr comme la raison le prescrit, il faut évidemment que la première de nos études et de nos habitudes soit de juger sainement et de ne placer le plaisir que dans les sensations honnêtes et dans les actions vertueuses » (La Politique). Settembrini, un personnage de La Montagne magique de Thomas Mann, professe une « antipathie d’ordre politique » à l’endroit de la musique (il la soupçonne de quiétisme, trouve qu’elle est dangereuse, qu’elle ne fait pas avancer le monde). Si Kant n’évoque pas les dangers de la musique, il en déplore, dans la Critique du jugement, les nuisances : « Il y a dans la musique comme un manque d’urbanité, car, par la nature même de ses instruments, elle étend son action plus loin qu’on ne le désire (dans le voisinage). »
Nombre d’autres grands penseurs de la musique sont présents dans le florilège : Schopenhauer, Hanslick, Proust, Barthes… Au chapitre des textes plus rares, je retiendrai trois « contributions » : Ronsard, Chabanon, Rosolato.
Selon Ronsard, il y a un lien entre l’amour de la musique et la vertu. Comme « toutes choses sont composées d’accords, de mesures et de proportions, tant au ciel, en la mer, qu’en la terre », sans la musique et ses accords aucune « chose de ce monde ne pourrait demeurer en son entier ».
Michel Paul Guy de Chabanon, à la fin du XVIIIe siècle, rejette la théorie de l’imitation qui prévalait depuis toujours. L’anthologie nous fournit un bon exemple de cette théorie avec Charles Batteux (Les Beaux-Arts réduits à un même principe), pour qui toute idée musicale doit avoir sa source dans la nature : « Le musicien n’est pas plus libre que le peintre : il est partout et constamment soumis à la comparaison qu’on fait de lui avec la nature. » Chabanon argumente contre l’imitation : le fait que les animaux et les nourrissons sont sensibles à la musique prouve qu’elle n’a pas besoin d’imiter pour plaire. Il s’oppose aussi à l’idée selon laquelle toute musique devrait avoir une signification déterminée. La nature n’a pas voulu que la musique nous serve à communiquer mais qu’elle reste « un langage uniquement propre à nous procurer du plaisir ». Regardez les oiseaux, s’ils ne chantent pas l’hiver, « c’est que le froid qui contriste leur existence étouffe en eux les accents du plaisir ».
Autre texte original et intéressant, deux siècles plus tard. Guy Rosolato (né en 1924) rapproche sous plusieurs angles l’écoute psychanalytique de l’écoute musicale : la méditation de l’auditeur de musique renvoie à la perlaboration, en tant qu’elle appartient à l’analyste comme à l’analysant ; l’« attention flottante » répond à un certain type d’écoute musicale ; la désaffection à l’égard de la musique peut aussi trouver son équivalent chez certains psychanalystes.
Le lecteur d’une anthologie ne peut guère reprocher à celui qui l’a composée l’absence de tel ou tel auteur ; il peut seulement avoir envie d’enrichir la cueillaison de quelques fleurs glanées au cours des années récentes.
Le philosophe américain Peter Kivy nous offre un exemple passionnant de mise en relation musique/philosophie (3). Typique de l’opera seria, l’aria da capo (où la première partie de l’air est reprise après une section contrastante) a pu être critiquée pour son manque de réalisme dramatique. En réalité, selon Kivy, ce schéma ABA était parfaitement adapté à la façon dont étaient comprises, d’un point de vue philosophique, les émotions à l’époque baroque. La théorie des émotions qui dominait alors était celle que Descartes avait exposée en 1649 dans Les Passions de l’âme. Les émotions se réduisaient à quelques types fondamentaux et avaient quelque chose de statique. L’aria da capo, avec ses sections bien closes, correspondait idéalement à cette conception. Mais les théories des émotions changent. À la vision cartésienne a succédé l’associationnisme, qui n’établit pas les mêmes frontières entre les émotions : les émotions changent sans cesse, elles n’ont plus rien de statique. Ce flux continuel, l’aria da capo ne peut pas en rendre compte. La nouvelle théorie des émotions va se traduire musicalement par l’adoption de la « forme-sonate » (dans le domaine instrumental surtout) et par celle des ensembles dramatiques dans l’opéra (Mozart en est le maître incontesté).
Pour Philippe Lacoue-Labarthe, la musique dévoile – en l’amplifiant – une « chose entendue absolument avant ». « On obtient donc ceci : la musique a pour tâche de clarifier l’étouffement (maternel) du son. Dans le ventre de sa mère, l’enfant ne se distingue sans doute pas du corps de sa mère : il n’y a pas d’espace, de distance. S’il entend, cela le fait immédiatement réagir : bouger, avoir un mouvement, être ému, au sens fort du terme. Ce que je veux dire, c’est que si la musique existe, c’est pour retrouver cette première, toute première émotion (4). »
Jean Molino (5) enseigne que le fait musical est un « fait social total » (expression empruntée à Mauss, qui l’applique au don). Une musique ne peut se voir dénier la qualité d’œuvre d’art sous prétexte qu’elle endosse une fonction sociale ou religieuse particulière. Il n’existe pas de musiques plus « pures » que d’autres : « l’activité artistique est une réalité mixte ».
Thomas Dommange voit dans l’« homme musical » une modalité particulière de notre être : « Dire que l’homme musical est un rêveur éveillé, c’est dire que ce qu’il fait, que sa manière de faire ce qu’il fait, c’est de ne pas le faire. L’homme musical est celui qui déploie un réseau d’actions impuissantes à produire les effets qui leur sont pourtant intrinsèquement liés (6). »
Un inédit de Félix Guattari vient de sortir, son dernier chapitre est consacré à la musique. Je lui laisse la parole pour finir. « Dès l’époque baroque, la musique occidentale a eu la prétention de devenir un modèle universel, absorbant occasionnellement et avec condescendance quelques thèmes “folkloriques” […]. Vue de l’“extérieur”, cette musique pure – déterritorialisée – semble plus riche, plus ouverte, plus créatrice que les autres. Mais qu’en est-il exactement au niveau des agencements “consommateurs” individués ou collectifs ? Les ritournelles capitalistiques de consommation courante, celles qui nous tournent dans la tête le matin en prenant le métro, ne [se] sont-elles pas, au contraire, appauvries, à mesure qu’elles se rétrécissaient sur un individu solitaire et que leur production se “mass-médiatisait” (7) ? »
Il y a encore des fleurs à cueillir.
- La formulation de ces notices est parfois alambiquée. D’autre part, on s’étonne de l’attribution à Liszt (p. 212) d’une Symphonie héroïque. Il s’agit plutôt de la Symphonie révolutionnaire (1830), dont il ne reste qu’une ébauche.
- Thomas Dommange, L’Homme musical, Les Solitaires intempestifs, 2010, p. 41. (Cf. QL n° 1 017, p. 28.)
- Peter Kivy, Introduction to a philosophy of music, Oxford, 2002, pp. 169 et s.
- Philippe Lacoue-Labarthe, Le Chant des muses, Bayard, 2005, pp. 37-38.
- Jean Molino, Le Singe musicien, Actes Sud, 2009. (Cf. QL n° 1 003, p. 30.)
- Thomas Dommange, op. cit., p. 270.
- Félix Guattari, Lignes de fuite. Pour un autre monde de possibles, Éd. de l’Aube, 2011, p. 318.

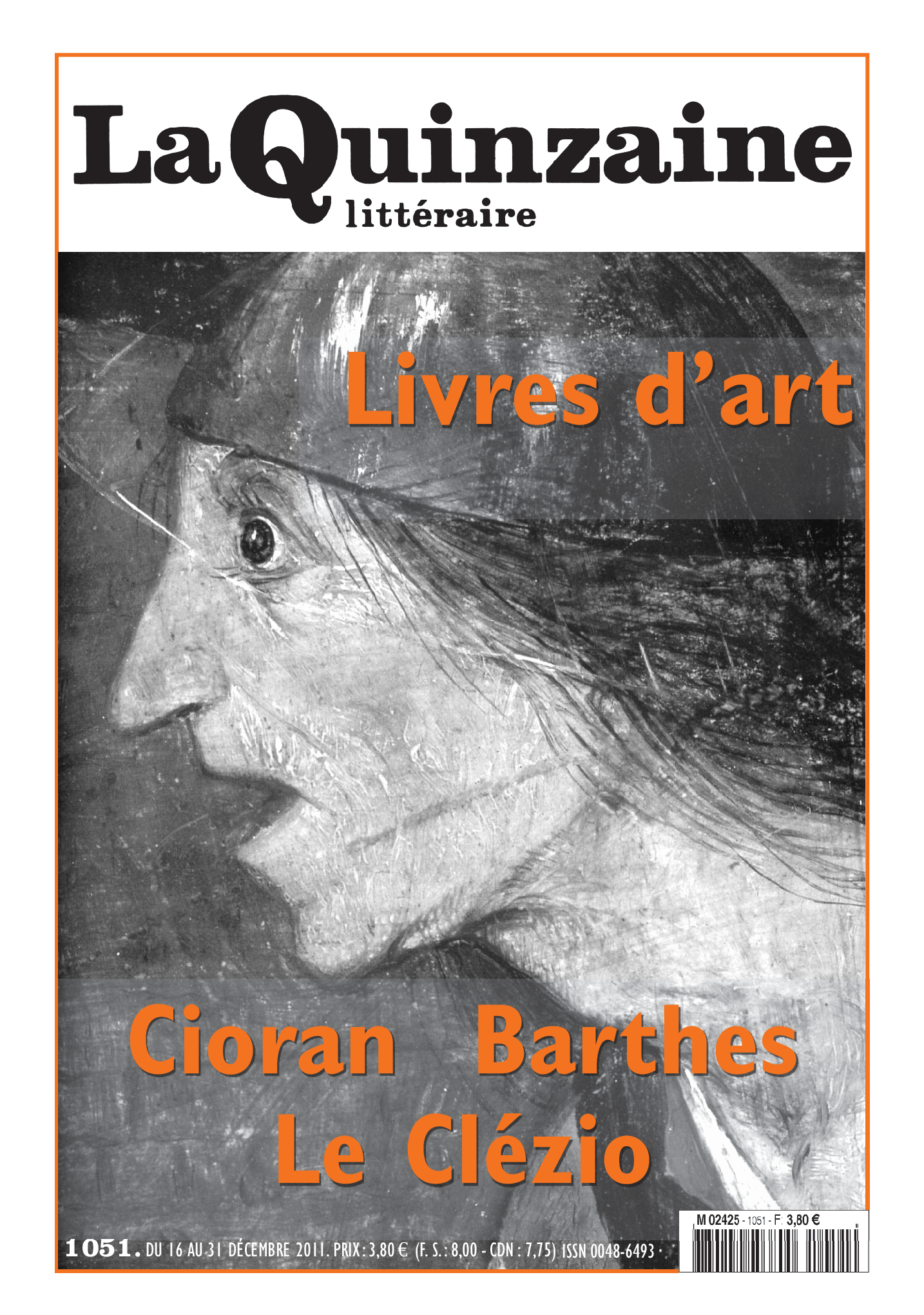

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)