Pas seulement, il est également, rappelons-le, critique dans de nombreuses publications et auteur de trois films. Pour être juste, l’étonnement n’est pas total avec Maurice Mourier car Ajoupa-Bouillon, dont l’héroïne fait une apparition dans la postface (pardon, le post-scriptum), est un ensemble de textes brefs, proche du poème en prose.
Ce qui frappe dès l’abord, c’est la mise à distance par l’humour, qui s’apparente parfois à l’autodérision. Le titre ressemble à une bonne blague, qu’échangeraient deux vieux amis : Eh oui, on se fait vieux, la pluie n’arrange rien. On a une impression de canular que prolongent les exergues :
« Auguste, comte ?
par Hector Malotru »
« … elles sont fausses, mes citations, je les ai inventées, ou parfois tu vois j’en ai tourneboulé de vraies… » explique Mourier dans sa postface.
Très vite, à la lecture, l’impression goguenarde se dissipe, même s’il demeure par-ci, par-là un vocable emprunté au lexique plus terrien de qui ne s’en laisse pas conter : les ailes vont par « flopées » et la mort « se rencogne ». Ou elle (l’impression goguenarde) revient en force : « la bave de la patience », « le ciel est là, pur ou pus », « l’aube était transpirante ainsi qu’une diarrhée », ce qui a pour effet de rendre surprenante, d’autant plus délicieuse l’extrême délicatesse de la plupart des vers. Délicatesse qui tient, nous semble-t-il, à peu de choses : un vers qui s’interrompt, une répétition, une reprise, le tout écrit comme par hasard, sans y penser (nous voulons dire : par la grâce d’un travail invisible).
« J’aurais bien cueilli du lilas, dit grand-mère
Du lilas rose et bleu gonflé comme je l’aime
Ce sera pour une autre année
Ce sera pour la tombe retournée
Pour rien ce sera
Puis ce ne sera plus
Plus rien »
Demeure alors un métissage, le mélange d’un appel vers le haut, ou l’azur et la constatation qu’on est bien de ce monde, cul-terreux.
« On a plus d’azur qu’il n’en faut
On n’a plus d’azur »
Subtil retournement du sens avec la simple introduction du négatif, qui était entendu dans le vers précédent avant qu’il n’apparaisse…
Le petit garçon qui marche sur la berge (l’enfance, avec Mourier, n’est jamais loin) s’en va à la rencontre du vieillard et du mort qu’il sera. Il a « l’élégance d’un spectre ». Notation théâtrale. Le jouet est cassé, l’enfant attend
« tristement seul
la fête ».
Qu’attendait-il, une fois adulte ? Surtout, venant de quoi ?
De la littérature ? Mais elle est condamnée. N’en demeure que
« le souvenir farouche
d’un temps d’aventure et de grès ».
Le titre donne le ton (vieillesse de soi, grisaille du monde), l’arrivée des gros mots évitent les grands mots (comme le souligne François Lescun dans la préface), mais retenons surtout, de cette poésie, sa qualité majeure : le talent du poète à glisser sur les mots sans les abandonner, d’en conserver un ou plusieurs, cailloux dans la forêt ou pierres dans la rivière, pour trouver son chemin, éviter de sombrer. Les vers s’enchaînent, tantôt chansons et tantôt chants, ramenant des images d’une enfance campagnarde (du moins à ce qu’il semble).
On aimerait le consoler, notre poète secret, on aimerait qu’il soit moins triste, qu’il se sente très vivant. Comme l’est ce livre unique.
« Il faut de l’azur
Sûr on n’est pas toujours assis sur soi
Le cœur chavire qui entend les longues plaintes bêtes des orchidées
Ressaisissez-vous fleurs vivaces vestiges du vert
Mais l’air hivernal n’a pas entendu
Allez il n’a pas entendu. »
- Les Nuits de Nara, EST-Samuel Tastet éditeur, 2006.
- Ajoupa-Bouillon, EST-Samuel Tastet éditeur, 2009.
BERNARD MANCIET
L'ENTERREMENT A SABRES
C’est effectivement une première : la collection « Poésie »/Gallimard publie en version bilingue, une grande poésie de « langue française », pour autant que l’on respecte les définitions : langue du territoire national, serait-ce un gascon traduit par son auteur. Ces 131 poèmes de Bernard Manciet (1923-2005) n’ont rien de passéiste même pour ce tombeau des temps modernes, sans élégie, mais la langue avant toute chose. On y entend le parler « nère », un gascon haché à souhait dans ses diérèses qui sonnent de toutes ses consonnes assourdies ou éludées. C’est celui de la grande lande, celui qui se parle à Sabres, et de La Réole ou Laboueyre à Mont (-de-Marsan). Il a tout pour séduire André Velter, amateur de textes qui se profèrent quand souffle et sonorités subvertissent tout ce qui est attendu. Le paradoxe, ou la logique éditoriale, est qu’il nous faut cette édition parisienne qui va faire autorité par les relectures multiples qui ont été engagées. Guy Latry a livré la bio-bibliographie (et par ailleurs sorti les manuscrits les plus touffus d’un auteur qui aime perdre son lecteur par de foisonnantes références, vrai dédale lié au jeu de registres sans équivalence décidable).
Le vide de la lande, le bruit de la langue est pour l’auteur celui du Triangle des Landes (Paris, Arthaud, 1981 ; Pau, Atelier in8, 2004) et celui plus vaste du Golfe de Gascogne (Paris, Arthaud, 1987 ; Pau, Atelier in8, 2008) constitués en carrefours pour inscrire des palimpsestes trans-époque et trans-classes. La déterritorialisation de la modernité devient condensation de sens jetés aux quatre vents des tempêtes de grande marée et autres dévastations. Le Mauriac aux parfums de sacristie s’en abolit, quitte à flamber, chez Manciet, de mysticisme, quand les brisures du siècle sont dynamisme narratif.
Jacques Roubaud, commis en préfacier, en aime le savant assemblage de contraintes pour une épopée non réductible à un décor, moins encore en poésie que dans les nouvelles du casau (Casaus secrets, Reclams, Pau, 2005 et Jardins perdus, traduction de Guy Latry, L’Escampette, 2005). À la fin de sa vie, Bernard Manciet a pratiqué la valeur d’oralité de sa poésie en s’accompagnant/en accompagnant le ténor basque Beniat Achary, ou à Uzeste, en produisant ses lectures avec Bernard Lubat à la basse ou Michel Portal à la flûte pour de mémorables prestations. Paris a pu l’entendre lu en français, et par lui-même, en gascon, à la Maison de la Poésie. Nous en avions alors parlé car les premières éditions de ce texte mythique furent successivement Ultreïa à Garein en 1989 et Mollat à Bordeaux en 1996. Aujourd’hui, c’est L’Escampette qui publie la plupart des écrits disséminés de Bernard Manciet que l’on traduit et commente de Vienne à Madrid, en sus des sections universitaires de langue d’oc (un terme que Manciet n’aimait pas).
Maïté Bouyssy
Marie Etienne
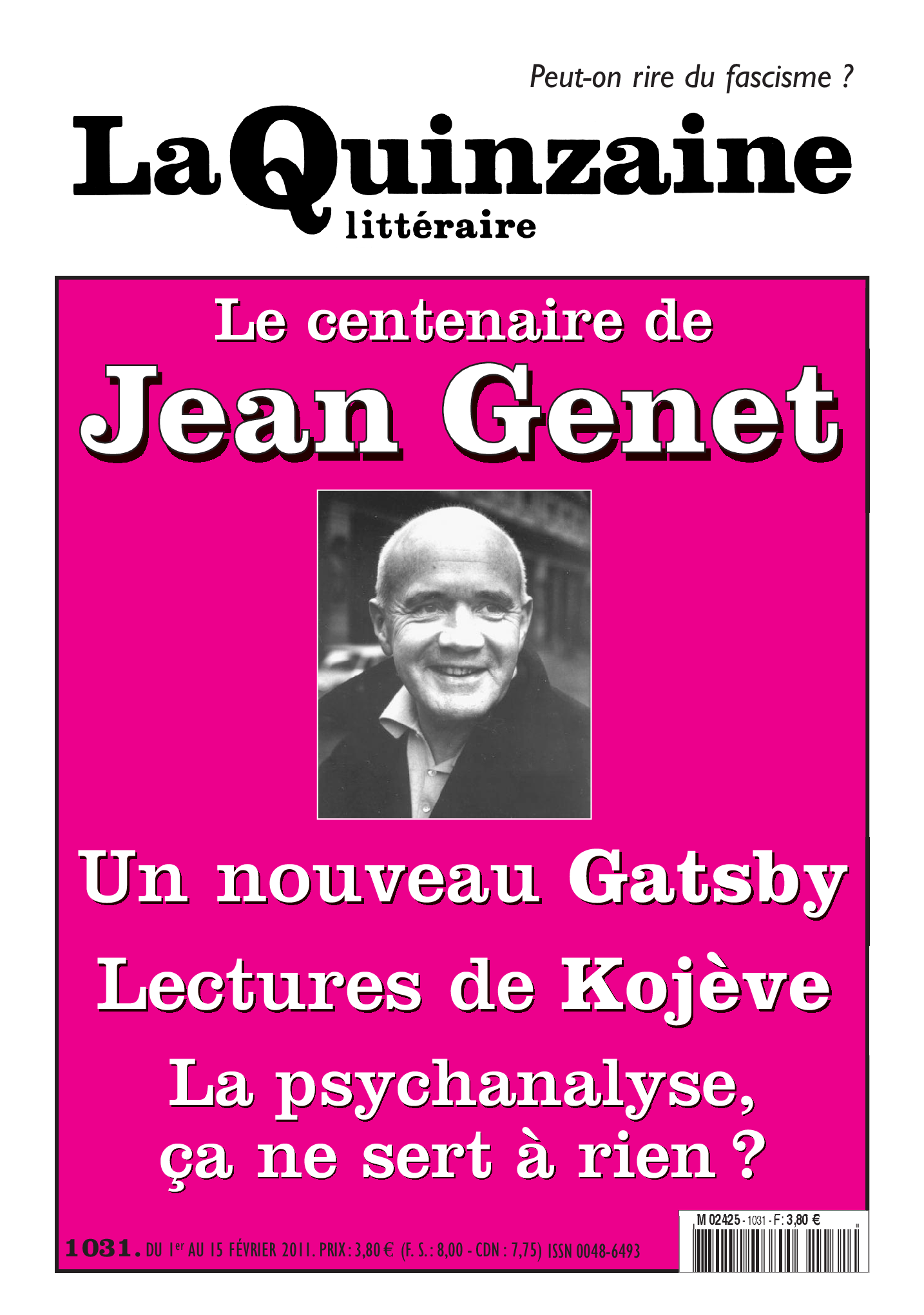

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)