Velimir Mladenović : Vous êtes née à Belgrade, mais vous avez grandi dans un milieu francophone. Comment la littérature et la culture françaises ont-elles imprégné votre pensée et votre écriture ?
Sonia Ristić : J’ai en effet passé sept ans de ma scolarité dans des établissements français, à Kinshasa puis à Conakry (ma mère était diplomate avant l’éclatement de la Yougoslavie), mais comme il s’agit d’années d’enfance et d’adolescence, je ne me posais pas trop la question à ce moment-là. C’était seulement la manière de vivre de ma famille, ces allers-retours entre l’ex-Yougoslavie et différents pays d’Afrique, entre Belgrade et la côte dalmate, entre le serbo-croate et le français. Ce n’est que beaucoup plus tard que j’ai compris à quel point ce parcours m’avait construite. Chaque langue est avant tout un système de pensée, une manière de concevoir le monde, et d’avoir été amenée à m’exercer à cette gymnastique mentale depuis l’enfance m’a sans doute appris à ne pas me fier aux grilles de lecture uniques, aux binarismes, aux interprétations univoques, mais à tenter d’observer le monde en empruntant sans cesse différents points de vue. Lorsque nous passons d’une langue à l’autre, quelque chose bascule en nous, nos timbres de voix changent, ainsi que nos mimiques, nos gestes ; on pourrait presque dire que nos personnalités varient légèrement. Pendant ces années décisives d’enfance et d’adolescence, je naviguais de l’un à l’autre quotidiennement, et il y a aussi, peut-être, quelque chose d’un peu schizophrène dans cela. Peut-être qu’on apprend alors à se glisser dans la peau de personnages différents. Peut-être que le désir d’écrire vient en partie de là.
VM : Dans les pages de ce journal (cf. La Quinzaine littéraire, no 317 du 16 janvier 1980), Danilo Kiš a répondu à une question sur la position d’écrivain serbe en France. Pourriez-vous nous dévoiler ce que représente pour vous cette « double nationalité » ?
SR : Je me définis comme ex-Yougoslave, car c’est le pays dans lequel je suis née, dans lequel j’ai grandi et que j’ai quitté pour venir faire mes études à Paris en 1991. Même si, aujourd’hui, j’ai une double nationalité croate et serbe, ce sont des catégories dans lesquelles, de manière intime, je ne me reconnais absolument pas. Je me sens profondément slave du Sud et issue de ce pays (la RSFY) qui a duré un peu moins d’un demi-siècle et qui n’existe plus. D’une certaine manière, quel que soit le nombre de passeports que je peux avoir, je pense que je me sentirai toujours apatride. Je ne suis pas française et je crois que je serai toute ma vie une immigrée dans ce pays, même si un jour je demande la naturalisation. Mais je me sens très parisienne, en revanche. La langue dans laquelle je travaille et dans laquelle j’ai bâti un grand nombre de relations amicales, amoureuses, professionnelles, est le français. On peut dire que je suis une apatride qui a trouvé refuge dans le cosmopolitisme parisien et dans la langue française !
VM : Je constate que votre travail n’est pas suffisamment reconnu dans votre pays natal. Est-ce que c’est important pour vous d’être présente dans les deux langues et cultures en même temps ?
SR : On peut dire que mon travail est complètement inexistant dans les pays issus de l’ex-Yougoslavie. Rien de ce que j’ai écrit n’a jamais été traduit, publié ni monté là-bas. Aucun théâtre ni maison d’édition n’a jamais manifesté le moindre intérêt. Les seuls endroits où l’on trouve certains de mes livres sont les bibliothèques de centres culturels français. Je ne sais pas si c’est dû au fait que ma « yougonostalgie » assumée et mon cosmopolitisme ne sont pas populaires en ces temps de replis communautaires et de nationalismes déchaînés ; au fait qu’étant partie très jeune, je n’y ai aucun réseau professionnel ; au fait que ce que j’écris ne correspond pas aux courants esthétiques en vigueur – ou tout simplement est-ce parce que la scène littéraire et théâtrale est déjà très riche ? Cela m’attristait à une époque et cela a certainement contribué à mon sentiment d’exil, mais au fil du temps j’ai fait la paix avec cet état des choses. J’aurais aimé entendre comment mes mots sonnent dans ma langue maternelle et j’aurais aussi aimé que certains proches puissent me lire, mais, d’un autre côté, j’ai la chance immense que mes textes circulent non seulement en France, mais aussi en Afrique, dans la Caraïbe, au Québec, au Liban, un peu en Italie et en Allemagne, et il serait malvenu de me plaindre.
VM : Vous écrivez des romans et des pièces de théâtre. Pourquoi pensez-vous que le travail sur une pièce de théâtre est plus complexe que sur le roman ?
SR : Parce que l’écriture théâtrale repose beaucoup sur l’implicite, le non-dit, et qu’un texte théâtral doit rester aussi ouvert que possible, vu qu’il ne peut être « fini » ; il doit offrir un espace pour que les autres couches d’écriture puissent venir s’y superposer : la mise en scène, le jeu des acteurs et des actrices, le travail du son, de la lumière, de la scénographie, etc. Il faut arriver à dire, à raconter, à être aussi précis que possible, mais sans rien fermer. Tout est entre les lignes. De par sa relative brièveté comparée au roman, le texte théâtral demande une certaine concision, tout en œuvrant à ce qu’il y ait suffisamment de « chair » et de langue, parce que les comédiens vont travailler à partir de cela. Les premiers jets de mes pièces sont toujours un brin trop bavards, et le travail consiste ensuite à réduire, comme on le fait en cuisine, à feu doux. Dans mes romans, pour filer la métaphore de la cuisine, j’ai l’impression que je procède à l’inverse : je ne cesse de rallonger en rajoutant du bouillon.
VM : Est-ce qu’il y a plus de place pour la politique dans le théâtre ou dans le roman ?
SR : Du point de vue thématique, je ne crois pas. Chaque auteur trouve sa cohérence et son alchimie entre ses sujets et les formes qu’il explore. Mais le théâtre est une expérience collective, vivante, instantanée, et cela en fait une expérience politique par définition, dans le sens premier du terme. Un groupe de personnes se réunit pour entendre ce qu’un autre groupe de personnes a à dire sur le monde, l’humain, etc. On y retrouve l’agora de la naissance de la démocratie, la place publique où, ensemble, on réfléchit et on discute des problèmes de la cité. La lecture est une expérience solitaire, individuelle ; le théâtre repose complètement sur le collectif. Il repose aussi sur le fait que tous les individus qui constituent le public passent un pacte, adoptent un code – ce que les anglophones appellent « the suspension of disbelief » –, se mettent tacitement d’accord sur l’adoption d’un langage commun durant le temps de la représentation.
VM : Pourriez-vous éclairer votre pensée selon laquelle le théâtre est le jumeau de la démocratie ?
SR : C’est en lien avec ce que je disais plus haut. Il y a aussi le fait que les deux (tels qu’on en a hérité dans le monde occidental, en tout cas) sont nés à peu près au même moment et au même endroit, en Grèce antique. Ce que la fiction apporte dans la perception du monde, des humains et de leurs sociétés est vital. Le fait qu’au moment où des gens réfléchissaient à une « nouvelle » organisation sociale, Eschyle ait commencé à représenter ces mêmes interrogations scéniquement, n’est sûrement pas le fruit du hasard. Le besoin de fiction, de représentation, comme de passeurs d’idées philosophiques dans une expérience collective et immédiate, me semble être un fil conducteur dans l’évolution de nos sociétés.
VM : Dans votre dernier roman, Des fleurs dans le vent, vous racontez une histoire qui commence le jour où François Mitterrand a été élu président. Dans quelle mesure les personnages de ce roman vous ressemblent-ils ?
SR : Le roman suit les parcours de trois jeunes Français, issus d’un quartier populaire, durant les vingt-six années qui séparent l’élection de François Mitterrand de celle de Nicolas Sarkozy, avec, en toile de fond, les transformations de la société française et les événements qui ont secoué le monde durant ce temps. Même s’ils ont quelques années de moins que moi, on peut dire qu’ils sont de ma génération, celle qui a fait face aux désenchantements en chaîne. La génération de nos parents a vécu la fin des Trente Glorieuses, a grandi en entendant les « plus jamais ça » d’après la Seconde Guerre mondiale, a vu la décolonisation, les avancées des droits des femmes, a vécu dans l’espoir. La nôtre est entrée dans l’âge adulte dans les années 1990, avec le retour des camps de concentration en Europe, les guerres yougoslaves et tchétchènes, le génocide au Rwanda, la « décennie noire » en Algérie, de nouvelles escalades dans le conflit israélo-palestinien… Il y a eu le 11-Septembre et tout ce qui s’est ensuivi. On assiste à la montée des extrémismes et des intolérances, à la perte des acquis sociaux, au libéralisme à outrance, à des reculs inouïs, inimaginables il y a trente ans. Je voulais surtout raconter la France que j’aime, celle des grandes villes et de leurs banlieues, de la mixité. Et puis, avant toute autre chose, c’est une histoire d’amitié, de famille choisie, d’amour qui se nourrit d’altérité, et je crois que c’est en cela que mes personnages me ressemblent le plus.
[Née en 1972 à Belgrade, Sonia Ristić est romancière et dramaturge. Elle a, entre autres, été lauréate des Journées de Lyon des auteurs de théâtre avec L’Enfance dans un seau percé (Lansman, 2011) et du Prix des lycéens allemands avec Orages (Actes Sud junior, 2008). Son travail a bénéficié de nombreuses bourses et récompenses : CNL, Centre national du théâtre, fondation Beaumarchais-SACD. Son dernier roman paru, Des fleurs dans le vent (Intervalles, 2018), a reçu le prix Hors Concours 2018.]
Velimir Mladenović
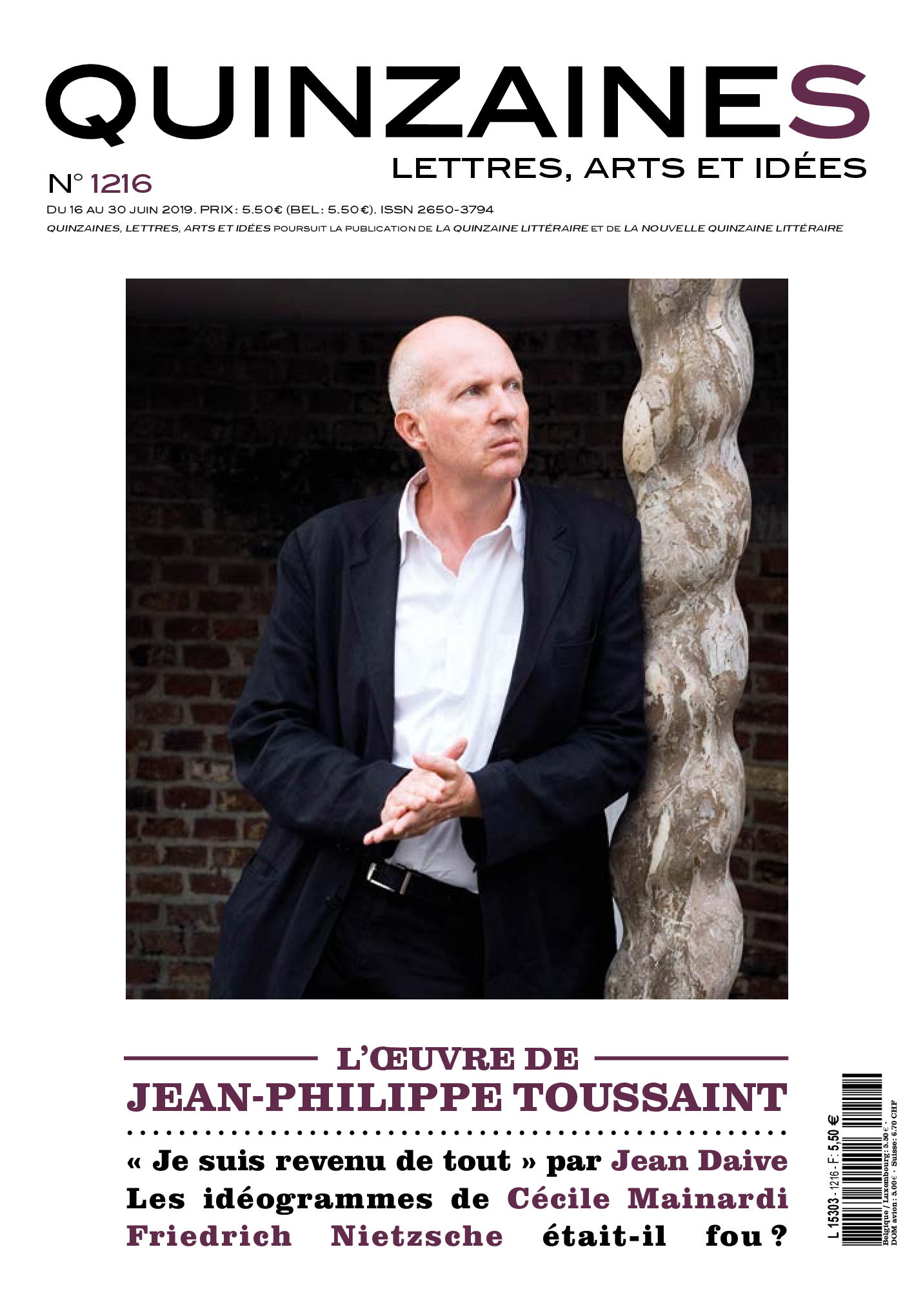

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)