En quelques années, Tim Burton est devenu un des cinéastes les plus estimés du paysage cinématographique, un de ceux dont chaque nouveau film est attendu avec impatience, même (surtout ?) si le précédent n’était pas tout à fait à la hauteur espérée – phénomène similaire pour Woody Allen ou Martin Scorsese, ou jadis pour Kubrick : la griffe de l’auteur suffit. Ce qui ne signifie pas que leur réputation est usurpée ; simplement que, leur nom étant une garantie, ils échappent désormais à l’obligation de résultat et s’inscrivent dans un horizon d’attente toujours positif.
Seize films en vingt-sept ans, Tim Burton n’a pas chômé : l’encre des articles à propos d’Alice in Wonderland (2010) était à peine sèche que Dark Shadow était déjà sur le métier (sortie en mai prochain), ainsi que Frankenweenie, long métrage d’animation d’après son court métrage de 1989 (sortie en septembre). On ne s’en plaindra pas, chacune de ses productions étant un régal pour l’œil – même si sa version de Lewis Carroll ne nous avait pas transporté (cf. QL n° 1014), elle offrait un intérêt visuel sans commune mesure avec les films environnants. Burton est classé, à juste titre, parmi les cinéastes « visionnaires », trop peu nombreux pour que l’on chipote. Certes, l’effet prime parfois sur le sens, le syndrome de « Monsieur Plus » se manifeste un peu lourdement – essentiellement dans ses films les plus récents, Charlie et la chocolaterie et Sleepy Hollow –, mais ne reprochons pas à la mariée d’être trop belle.
Reconnaissons notre erreur : à la vision de Pee Wee’s Big Adventure, son premier ouvrage (1985, mais sorti à Paris en juin 1987), nous n’aurions pas parié un maravédis sur l’avenir de son signataire, tant cette apothéose d’un débile léger, gloussant symbole asexué de la régression, nous avait semblé digne d’être immédiatement oubliée. Burton cachait-il (bien) son jeu ? Avait-il besoin, à 27 ans, de se débarrasser de tout un univers d’enfance encombrant ? Pourtant rien de ce qui avait passionné l’adolescent de Burbank ne transparaissait dans la « ligne claire » de Pee Wee ; les programmes du ciné-club qu’il animait à 17 ans, présentés dans une vitrine de l’exposition, sont conformes à son image : des classiques de l’épouvante, des films de monstres, des séries Z naïves, les nanars d’Ed Wood, « le plus mauvais réalisateur du monde » à qui il consacrera un de ses meilleurs films en 1994. Tout ce que l’on retrouvera dans Beetlejuice (1988), réjouissante et intelligente histoire de fantômes, à la fois comique et horrifique, qui n’était donc pas un coup d’essai mais demeure un coup de maître. La machine était lancée.
Dans la filmographie burtonienne, alternent grosses productions de récupération, où le cinéaste reprend des mythologies modernes déjà largement visitées (Batman, La Planète des singes, Mars Attacks !) et oeuvres d’inspiration plus mince et personnelle (Edward aux mains d’argent, Big Fish), qu’il exécute avec une maîtrise identique. Il existe une bonne dizaine de versions des aventures de Batman, entre son Batman de 1989 et celui de Christopher Nolan, The Dark Knight (2008). Il est le seul (avec ce dernier) à avoir bien intégré le justicier de Gotham City à son univers propre – surtout dans Batman Returns (1992), le meilleur de la série. Sans doute parce que nourri à la mamelle des comics et de leur adaptation à l’écran (le Batman de 1966, dû à Leslie H. Martinson, est une petite perle du second degré qu’il a assurément savourée), il a su ingérer ce qu’on a longtemps considéré comme une sous-culture et en faire un élément naturel.
Car Burton fut, dans son adolescence, autant fasciné par les images fixes que par les images animées : d’un côté, les films d’horreur fauchés – l’exposition présente quelques films réalisés par Tim et ses copains, vers 14 ou 15 ans, avec matière molle extra-terrestre dévorante et autres aliens –, de l’autre, les bandes dessinées. La première publicité qu’il signe et qui figure à Bercy, une enseigne métallique pour un marchand d’appareils à éliminer les ordures, est manifestement « empruntée » à Don Martin, l’immense dessinateur de la revue Mad. Et parmi les centaines de dessins de jeunesse exposés – jusqu’à des serviettes en papier de restaurant, soigneusement décorées –, on peut déceler l’influence de Saul Steinberg, Ronald Searle ou Roald Dahl (justifiant ainsi son adaptation du Charlie and the Chocolate Factory de ce dernier).
Burton est un graphiste extraordinaire. On le savait depuis L’Étrange Noël de Monsieur Jack, le film qu’il a dessiné et produit en 1994, mais chaque mètre carré de l’exposition nous le rappelle, qu’il s’agisse de simples croquis ou de dessins travaillés à l’extrême. Il y a là une invention, une grâce, un mouvement (dont sont d’ailleurs totalement dépourvus les quelques tableaux accrochés, comme si la peinture figeait l’inspiration), les mêmes que l’on retrouve chez d’autres grands, Eisenstein ou Fellini. Une invention et une grâce qui subsistent lorsqu’il passe de la planche à l’atelier, comme le prouvent les quelques objets rassemblés, représentation en volume de dessins préexistants (superbes monstres métalliques tout en pattes et en mâchoires), ou pure création nonsensique (un manège construit comme un cadavre exquis animé d’un lent mouvement musical, un bébé frankensteinien transpercé de clous). S’il n’y avait pas d’écran, Burton existerait tout de même.
Ainsi, le cinéma apparaît relativement peu dans l’exposition. Certes, il y a ses films d’animation (dont Vincent, son très court métrage initial, 1982), une petite anthologie de ses longs métrages, les casques de Batman, un animal en sculpture topiaire d’Edward aux mains d’argent, l’épouvantail de Sleepy Hollow, le pull rose porté par Johnny Depp dans Ed Wood, les créatures à l’exocerveau hypertrophié de Mars Attacks !, quelques rasoirs de Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, les marionnettes des Noces funèbres, mais ce n’est pas l’essentiel. L’essentiel tient dans le nombre et la richesse des dessins, qu’ils aient ou non servi à la préparation de ses films, dans l’étrangeté de cette série de polaroïds inquiétants qui ouvrent l’exposition et plantent immédiatement le décor intérieur du cinéaste. Un décor intérieur que la carte blanche à lui procurée par la Cinémathèque permettra de compléter. « Miroir de son imaginaire », annonce celle-ci. La formule suinte le cliché, mais les titres sont cohérents avec ce que l’on sait de l’auteur : aux classiques attendus (Caligari, Nosferatu, Dracula, Frankenstein, Répulsion, Huit et demi) se mêlent quelques moutons noirs, les films d’Ed Wood, évidemment, de Roger Corman (La Chambre des tortures d’après Poe) ou de réalisateurs oubliés par l’Histoire, William Cameron Menzies (Invaders from Mars) ou Nathan Juran (Le Cerveau de la planète Arous). Même parvenu au sommet, Burton n’a pas renié ce qui l’a construit. Qu’il en soit félicité.
- Avec la projection, les 26 et 27 mai, de Out One : Noli me tangere de Jacques Rivette, dans sa version intégrale de 750 minutes, troisième présentation depuis 1972.

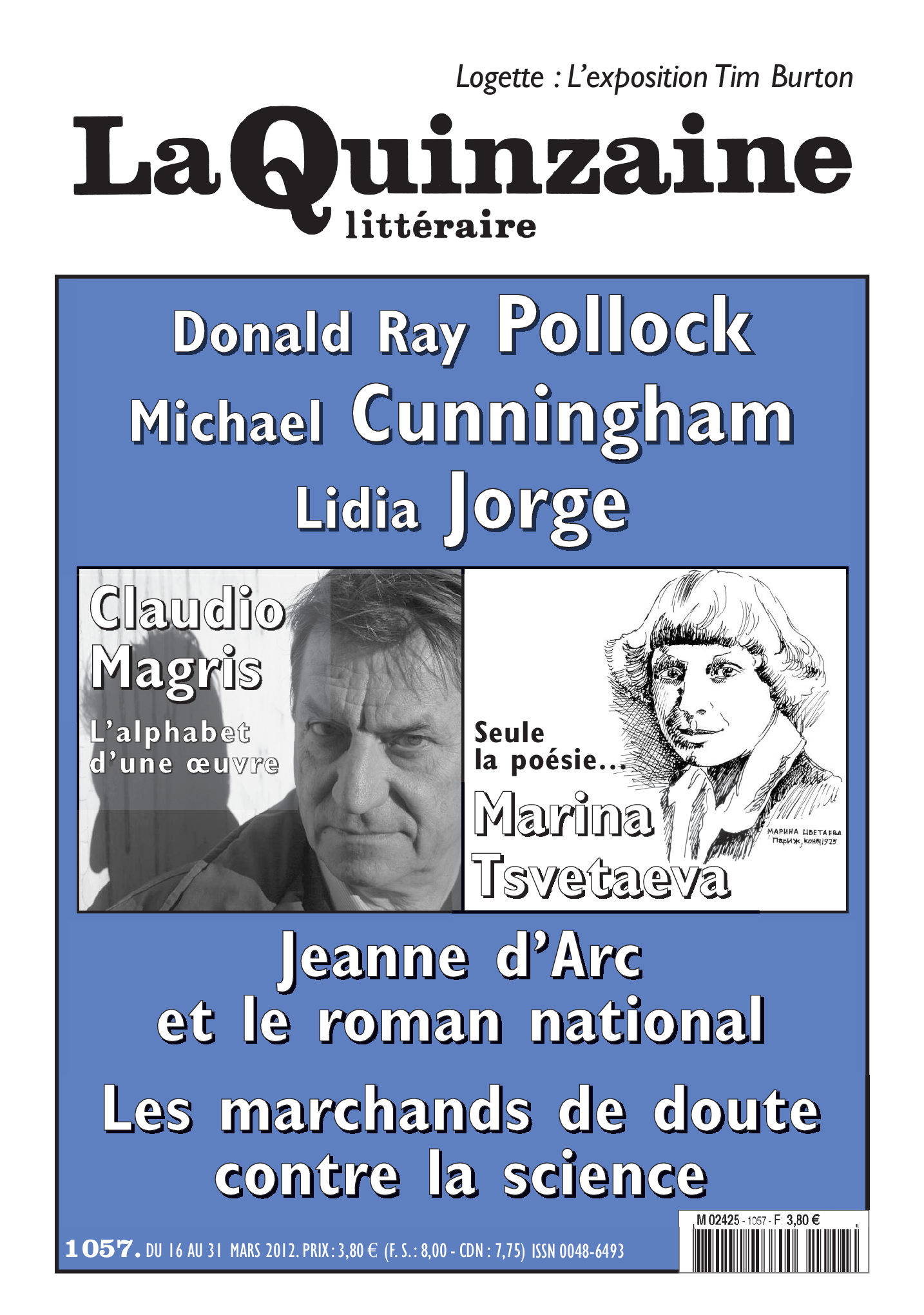

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)