Patricia de Pas : Le poète péruvien César Moro avait délibérément tourné le dos à sa langue maternelle pour adopter le français, rejetant l’espagnol comme langue du colonisateur. Est-il exagéré de dire qu’une langue maternelle peut parfois être (et le serait dans ce cas-là) perçue comme une langue étrangère ?
Marc Cheymol : Je n’irais pas jusque-là. Je pense que Moro était convaincu que le français était la langue de la modernité. L’innovation poétique depuis le début du XXe siècle se faisait en France. Le Pérou était un pays plus fermé et où toute innovation littéraire peinait à s’exprimer. César Moro avait appris le français à l’école, et toute l’Amérique latine était très francophile. Dans la haute société, il était traditionnel d’apprendre le français. La culture française était généralement considérée comme le sommet de l’élégance. Les latino-américains qui en avaient les moyens allaient à Paris – la traversée durait plusieurs jours mais cela ne les décourageait pas... Non seulement Moro est allé à Paris, mais il a décidé d’écrire en France comme Paul Éluard et André Breton. César Moro a donné à Éluard ses poèmes en français. Il s’est rapproché du cercle des écrivains surréalistes grâce à une cousine qui chantait à Paris.
P. D. P. : Donc le français fut un choix raisonné ?
M. C. : Oui, Moro aimait le français et il est même devenu professeur de français à Mexico puis au Pérou. Il a d’ailleurs eu comme élève Mario Vargas Llosa. La langue française rayonnait sur tout le continent (entre autres), car la France était réputée avoir apporté la philosophie des Lumières. Cette philosophie avait également été l’œuvre de penseurs allemands qui écrivaient dans cette langue, mais à la fin du XIXe siècle, les libertadores (Bolivar, Morelos, José de San Martin, entre autres) étaient pétris de culture française et de cette philosophie. Même aux Etats-Unis, Lafayette, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson étaient inspirés par la philosophie française du XVIIIe siècle.
P. D. P. : La Tortue équestre est le seul de ses textes littéraires où Moro écrit en espagnol et non pas en français. Quelle en est la raison ? La violence qui émane du texte peut-elle être interprétée comme une volonté de malmener, de déconstruire la langue espagnole ?
M. C. : Oui, on peut dire cela mais c’est surtout une attitude surréaliste. Les surréalistes français sont très raisonnables par rapport à César Moro qui n’hésitait pas à faire exploser les carcans syntaxiques et la cohérence du sens pour faire surgir un nouveau sens. La Tortue équestre aurait peut-être été mal reçue en français car l’homosexualité n’était pas très prisée au sein du mouvement surréaliste. André Breton et Benjamin Peret notamment y étaient assez hostiles. Dans Arcane 17, Breton écrivait que tout être humain était jeté dans la vie « à la recherche d’un être de l’autre sexe et d’un seul qui lui soit sous tous rapports apparié ». L’homosexualité était plutôt mieux acceptée au Mexique, où régnait aussi une hospitalité politique, rare à l’époque (1938-1948), qui permettait l’accueil de républicains espagnols, d’artistes de tous horizons, et même de personnalités comme Trotsky.
P. D. P. : Vous co-dirigez la collection bilingue et trilingue « Les Langues du poème » aux éditions Eliott. Cette collection publie des poètes de toutes les époques et de toutes les cultures avec l’idée que le poète écrit en plusieurs langues en passant de l’une à l’autre sans perte de l’intensité poétique. Quelles sont vos parutions récentes et à venir ?
M. C. : Prochainement nous publierons un poète roumain, Albert Denn, qui traduit lui-même ses poèmes en espagnol : l’édition sera trilingue, roumain-espagnol-français (Îmi pipăi cu frică tălpile / Antes de que desaparezcan los polos / J’aimerais regarder au-delà de l’échiquier). L’espagnol Miguel Angel Cuevas écrit en espagnol et se traduit en italien, nous l’avons traduit en français (Triptyque/Trittico/Tríptico). Cuevas fait beaucoup d’allusions à des poètes français et espagnols de toutes les époques. Ces productions dans sa langue maternelle ou sa langue d’adoption, l’italien, imprègnent sa création. La présentation des poèmes en plusieurs langues permet de reconnaître la culture que portent les langues, et d'entendre les différentes voix qui s'y expriment. Nous publions aussi des poèmes du « français d’ailleurs » (Ernest Pépin par exemple, pour le français de la Guadeloupe, À tout pays dédié). En Afrique, nombre d’habitants parlent le français mais à la maison c’est une autre langue qui est parlée : wolof, sérère, swahili, etc. Et ils ont le plus souvent deux prénoms, l’un français et l’autre propre à la langue maternelle. Nous allons publier une poétesse de Côte d’Ivoire, Tanella Boni (Mémoire du pays des femmes), très connue dans toute l’Afrique. La poésie en Afrique a bien meilleure presse qu’en France et les festivals de poésie sont très fréquentés.
P. D. P. : De manière générale, la langue littéraire des auteurs bilingues est-elle spontanément leur langue maternelle ?
M. C. : Spontanément, dans un premier moment de leur activité créatrice, oui. Mais il arrive parfois un moment où en fonction de leurs voyages, de leurs lieux de résidence, de leur expérience de vie, ils écrivent dans une autre langue. C’est le cas par exemple de Joseph Conrad, de Samuel Beckett, de Vassilis Alexakis, d’Hector Bianciotti, d’Andreï Makine…
[Marc Cheymol est un universitaire ayant enseigné au Mexique pendant dix-sept ans. Il co-dirige la collection Les Langues du poème aux éditions Eliott.]
Patricia De Pas

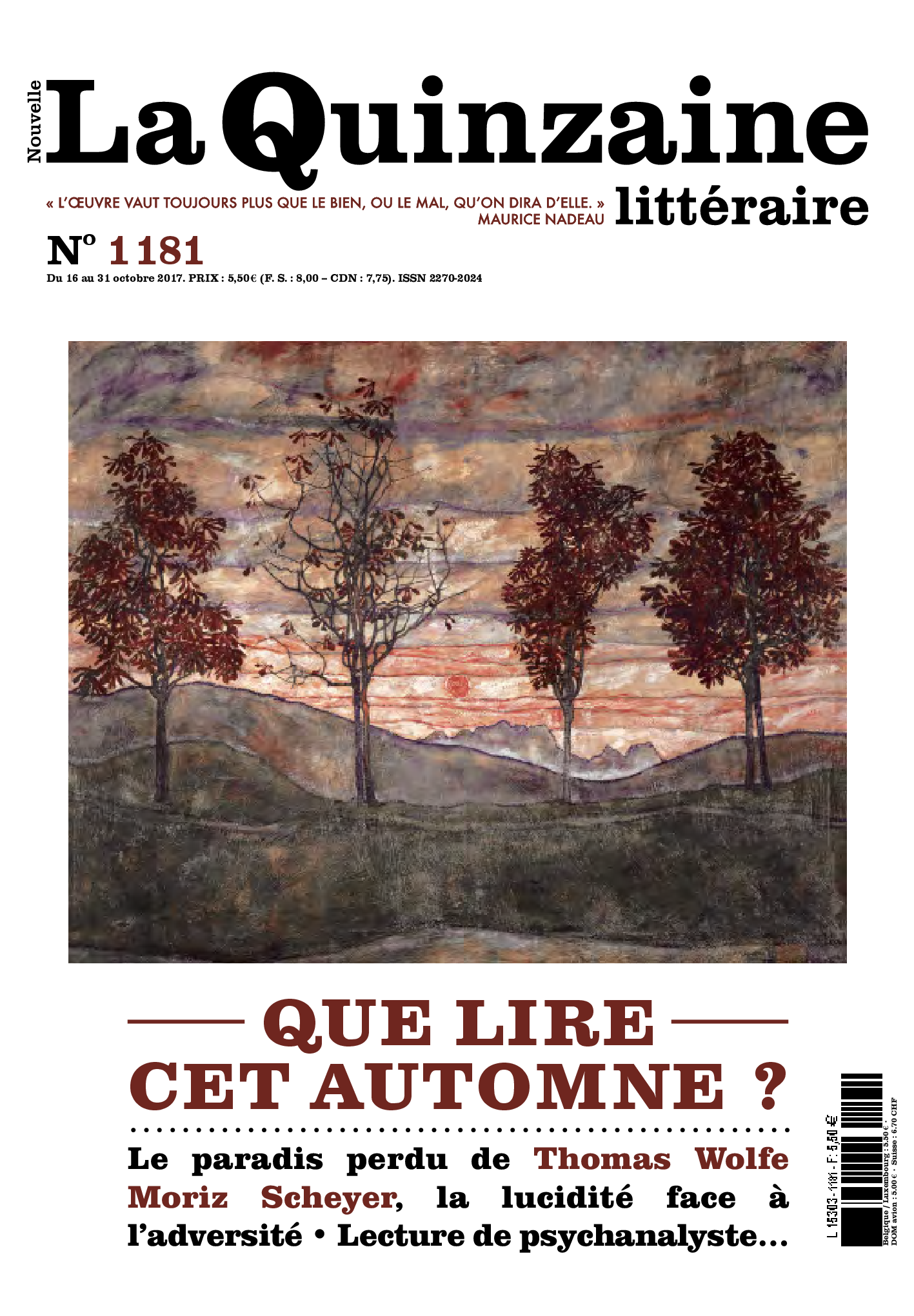
Commentaires (identifiez-vous pour commenter)