Hanté par la langue perdue des origines précoloniales de l’Amérique latine, Moro considérait le français comme une langue de libération poétique tandis qu’il associait l'espagnol à l’oppression coloniale. Influencé par le surréalisme parisien des années 1930, Il critiquait l'académisme et le conservatisme linguistique des cercles littéraires de Lima, notamment au sein de la revue El uso de la palabra (1939), cofondée avec le poète Emilio Adolfo Westphalen. Ses manifestes volontiers provocateurs dénonçaient le « milieu liménien stagnant ».
Par la suite, étant entré en relation avec André Breton, il s’installa en France et collabora à la revue Le Surréalisme au Service de la Révolution. Il publia ses premiers recueils en français (Le Château de grisou, 1943 ; Lettre d'amour, 1944) tout en restant dans la nostalgie de la langue maternelle mythique que l’espagnol avait supplantée du fait « des envahisseurs ignorants et des fanatiques assoiffés d’or »[1].
Après dix ans passés en France, il rentra en Amérique latine tout en continuant à écrire en français. L’image de la France est « érotisée » pour reprendre le mot de l’universitaire et écrivain Marcos Eymar, et le français abordé comme langue idéale, dont une des fonctions était de remplacer la langue originelle perdue. La hantise des origines tourmentait une grande partie des auteurs bilingues hispano-américains de cette époque (Vergalo, Gangotena, Costa du Rels…) et les encourageait à inventer une langue hispano-américaine à partir du bilinguisme, pour rendre l’espagnol étranger à lui-même.
À la fin de sa vie, Moro réinvestit l'espagnol de manière provocatrice pour écrire son unique recueil dans cette langue, La Tortuga ecuestre (publié à titre posthume en 1957). Ce texte est un modèle du genre surréaliste. Il joue à déformer la syntaxe et le lexique, traitant l'espagnol comme un corps à transformer, dans une esthétique de la rupture. La raison pour laquelle Moro a repris sa langue natale pour écrire ce recueil est probablement liée au fait qu’il s’adresse à Antonio, l’être aimé, dont il veut être sûr d’être compris. Mais le texte est irrigué par une telle flamme que l’on peut aussi supposer que cette ardeur ne pouvait trouver à parfaitement s’exprimer que dans la langue de l’inconscient, fût-elle aussi celle du colonisateur.
[1] César Moro, « La pintura en el Perú ».
Patricia De Pas

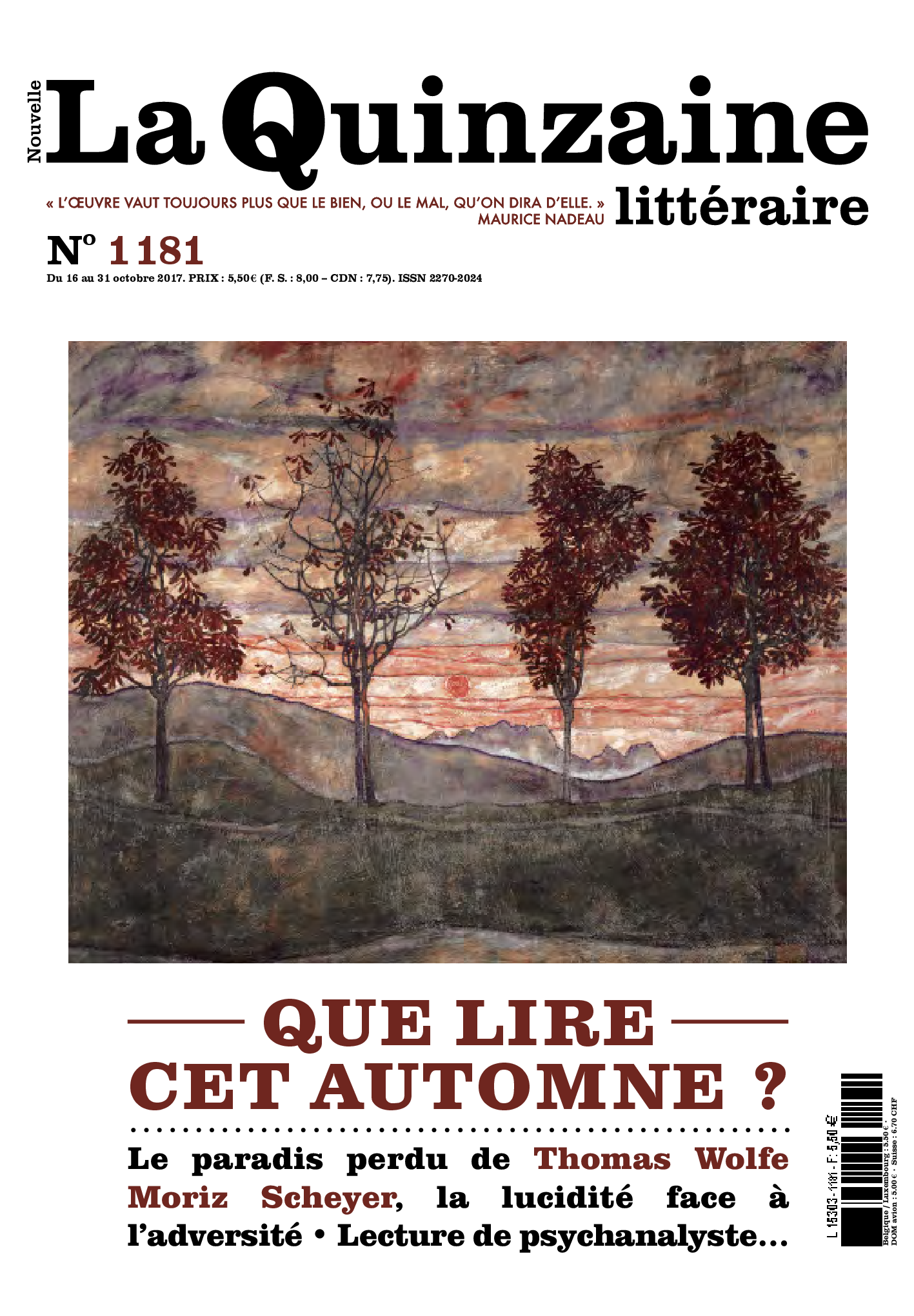
Commentaires (identifiez-vous pour commenter)