Langue maternelle… L’expression semble vouloir signifier que la langue dans laquelle l’enfant parle avant de l’apprendre serait nécessairement celle de sa mère. Quant aux dictionnaires courants, ils définissent la langue maternelle comme celle « du pays où l’on est né ». Mais quand les deux ne coïncident pas ?… La langue maternelle serait-elle la langue de la mère ou celle de la mère-patrie ?
S’interroger ainsi, c’est émettre un doute à la fois sur l’unité et sur la « naturalité » de la langue maternelle. Elle serait le support de l’identité psychique, la langue de l’inconscient selon Lacan qui a forgé le concept de lalangue. « Dans quelle langue souffres-tu ? », demandait Georges Duhamel au bilingue pour connaître sa langue maternelle (Les Plaisirs et les Jeux, 1922).
De fait, le bilinguisme est toujours une claudication. Cette claudication, tous les exilés la connaissent, que la décision d’écrire en langue étrangère relève d’une volonté émancipatrice (Nancy Huston), du désir d’explorer de nouvelles formes littéraires (Andreï Makine) ou qu’elle soit dictée par les circonstances (Gao Xingjian a commencé à écrire directement en français car les commandes qu’il recevait l’exigeaient).
« C’est à Paris que je suis devenu écrivain », aimait à répéter l’écrivain péruvien Mario Vargas Llosa (Prix Nobel de Littérature en 2010), disparu en avril dernier.
L’actualité littéraire nous fournit deux occasions d’aborder le thème de la langue maternelle. La première nous est donnée par l’écrivain et traducteur français Georges-Arthur Goldschmidt qui, dans deux récits parus en janvier chez Verdier, explore les ressorts de ce qu’il définit comme son « dédoublement linguistique ». Né en Allemagne en 1928, l’auteur avait fui le nazisme à l’âge de dix ans pour la France, qui lui donna sa « seconde langue maternelle ».
En outre, la toute première traduction française de La Tortue équestre (La Tortuga ecuestre, Lima, 1957) nous invite à évoquer la trajectoire de l’un des plus grands poètes péruviens du XXe siècle, César Moro, et à lire cet auteur sous le prisme de sa relation tourmentée à une langue maternelle ressentie comme étrangère – la langue du colonisateur. Grâce à l’universitaire et écrivain Marcos Eymar, nous découvrirons comment le rêve d’une langue maternelle absente peut modifier les rapports des auteurs avec leur « vraie » langue maternelle.
Ce dossier sera introduit par une approche de la psychologue et psychanalyste Josiane Froissart qui, à partir des trajectoires de François Cheng et d’Elias Canetti, tentera de répondre à cette question à l’évidence plus complexe qu’elle n’y paraît : Qu’est-ce donc qu’une langue maternelle ?
Patricia De Pas

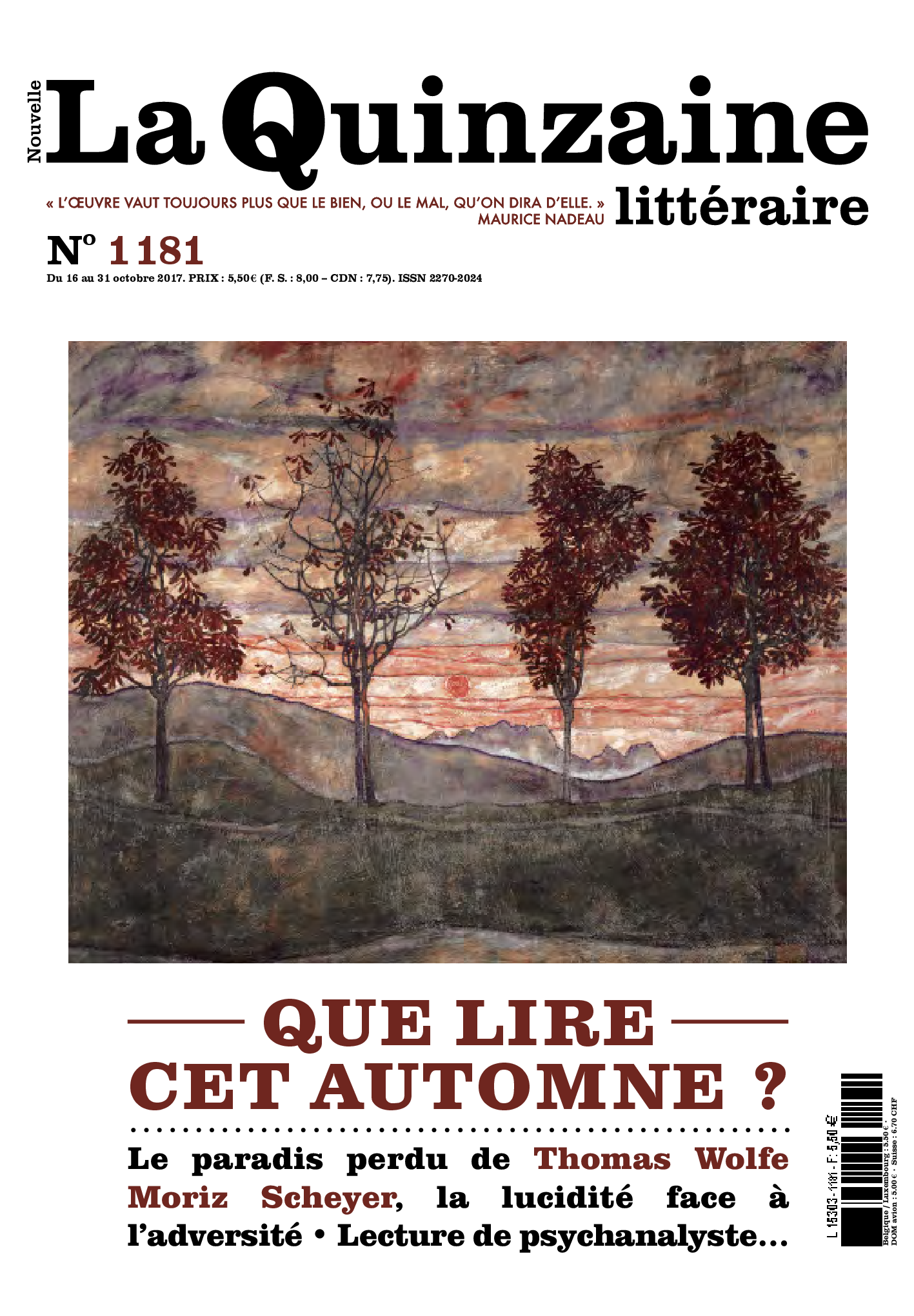
Commentaires (identifiez-vous pour commenter)