Nous ne nous étonnerons pas de voir Marie-José Mondzain placer son essai sous l’ombre portée de Pasolini, pour qui le nouveau fascisme était l’hydre consumériste. Elle ne le dit pas, mais Pasolini connaissait sa dette envers Gramsci, à qui il dédia des poèmes (Les Cendres de Gramsci, 1957). C’est lui qui, le premier sans doute, dans sa prison, comprit que la vie politique était ailleurs que dans la simple conquête des appareils. Il distingua ainsi le temps révolu de la guerre de mouvement (où les forces politiques s’affrontaient en pleine lumière et où il s’agissait de s’emparer du gouvernement, du central téléphonique, du poste de police) et le nouveau paysage de la guerre de tranchées (où la lutte est partout et où s’exercent des « micro-pouvoirs » qui rendent caduque toute idée de révolution par le sommet). C’est dans la tranchée du langage que nous convie la philosophe.
Le sabotage du langage, permis par le bombardement accéléré des signifiants et des icônes, et la soumission du temps humain à un état d’urgence permanent sont les armes les plus subtiles du pouvoir. Thucydide est cité pour nous rappeler l’antériorité de ces armes de guerre. Ce qui est nouveau, c’est le bain constant d’hypercommunication qui est le nôtre. Ce sabotage, devenu plus efficient, sape à la base tout effort de critique.
C’est l’usage d’un terme, celui de « déradicalisation », illustrant une pente de civilisation, qui déclenche l’essai très lucide, acéré et plein de colère méditée, de Marie-José Mondzain. Essai noir, mais qui s’égare sans doute dans l’abstraction scolastique, après avoir posé ses constats. Il saute aux yeux de l’essayiste que ce terme n’a rien de neutre. En ciblant les terroristes se réclamant de l’islam, il emporte au passage toute idée de radicalité. Or, nous ne pouvons opposer auxdits radicalisés que d’autres radicalités, mais aussi leur contester leur caractère radical. Dans les définitions de la « radicalisation », la violence n’est pas le seul critère : on note l’intransigeance, la rupture. Les radicalisés offriraient donc l’occasion d’en finir avec toute radicalité – et Marie-José Mondzain juge cette manœuvre inacceptable et catastrophique !
Ce tour de passe-passe lexical est d’autant plus contestable que l’on peut discuter ce qualificatif de « radical » appliqué aux terroristes concernés. Ces sujets, apathiques devant le massacre qu’ils perpètrent, d’abord obsédés de leur propre « publicité » (comme le tueur del’Hypercasher et Mohamed Merah, si préoccupés par les caméras), sont-ils si radicalisés que cela ou plutôt dénués de subjectivité ? Comme le dit Jean-Louis Comolli dans son bel essai, Daech, le cinéma et la mort[1], les vidéastes terroristes reprennent les codes d’un cinéma hollywoodien dégradé, ce qui devrait nous imposer de réfléchir à ce substrat plutôt que de psychologiser à l’excès nos analyses.
Est-on, en outre, certain que la question posée soit de déradicaliser ? La radicalité n’est-elle pas inhérente à la jeunesse, notamment ? L’enjeu n’est-il pas de proposer d’autres chemins à la radicalité ? Le problème n’est-il pas que le modèle dominant ne fournit aucune issue à la pulsion de radicalité qui anime les êtres ? Que la seule « offre » de radicalité est malheureusement celle des fanatiques ? Déradicaliser, ce serait permettre de revenir sur terre ; ce serait « démystifier ». Mais de quel réel parle-t-on ? Ces radicalisés aspirent-ils à revenir dans le réel ? L’obstacle n’est-il pas la sécheresse de ce monde réel, justement ?
Il y a cette phrase, sans doute énigmatique, souvent citée (et encore dans ce livre), due à Hannah Arendt, selon laquelle « seul le bien est radical ». Arendt oppose, à la radicalité du bien, la banalité du mal. Elle ne juge pas pour autant tout mal banal. C’est l’absence de pensée, la démission éthique, la soumission bureaucratique aux procédures, qu’elle vise à travers le cas Eichmann, dont on sait maintenant qu’il ne correspondait pas au profil. Les terroristes sont-ils aussi banals que des ronds-de-cuir déresponsabilisés ? Médiocres parfois, lorsqu’ils oublient leur carte d’identité dans leur voiture. Banals, on peut en douter… Le parcours de ces gens n’a souvent rien de banal. Certains sont tout à fait redoutables, notamment pour recruter, entraîner, propager une idéologie, organiser et aussi combattre. La philosophie aurait tort de leur appliquer des concepts réductionnistes.
Pour l’auteure, la manière dont sont présentés les radicalisés par la doxa s’intègre dans un dispositif plus large, celui du « choc des cultures », expression elle aussi sabotée, puisque, et ici la démonstration est brillante, la culture est ce qui ne peut pas s’entrechoquer avec une autre culture : « La chapelle Sixtine ne saurait déclarer la guerre à un temple aztèque. » La culture est précisément le fruit d’un « non-rapport », qui devient rapport à partir de la création, et uniquement à partir d’elle.
Le mot « radicalisé » associe désormais, d’une part, le fait de saisir un sujet à la racine et, d’autre part, la terreur. Ainsi, chemin faisant, sans assumer un discours explicite, mais en s’introduisant au cœur de la compréhension, le consentement s’impose comme la seule option possible, toute autre attitude étant renvoyée à la complicité ensanglantée. La répétition du terme le rend indiscutable. Ce qui est proprement insupportable à la philosophe, la pensée consistant justement à saisir le monde par ses racines, à la manière de Descartes. Il est pourtant évident qu’« il existe des combats radicaux qui se font sans violence ».
L’autre perversion de ce terme de « radicalisé » est qu’il désigne de facto uniquement les terroristes se réclamant de l’islam. Or, on ne manque pas d’une belle diversité de tueurs… Comment appeler les assassins de Columbine ? On ne les affuble pas du qualificatif de « radicalisés » ! Au bout du compte, vouloir ramener à ladite normalité n’empêche-t-il pas d’interroger la normalité comme ventre fécond des monstruosités ? Serait-ce l’utilité indicible des monstres les plus terribles ?
[1] Jean-Louis Comolli, Daech, le cinéma et la mort, Verdier, 2016.
Jérôme Bonnemaison
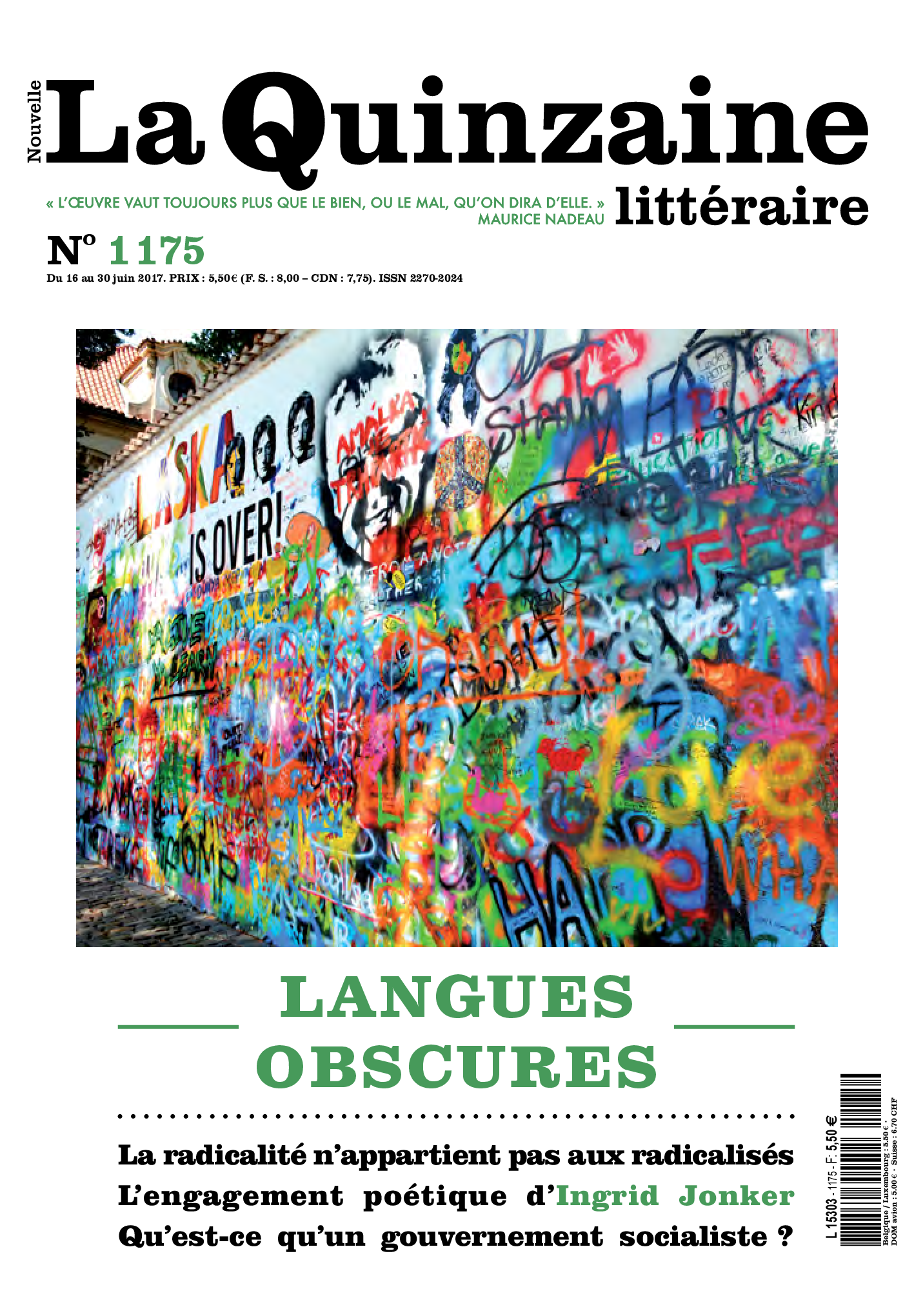

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)