Elle l’est toutefois pour commencer, quand Thérèse arrive dans la ville pour rencontrer Will Jung, un « immense » artiste, peintre âgé qui n’ouvre guère sa porte aux étrangers. Elle doit l’interroger, réaliser un reportage sur son œuvre et sur lui. Elle arrive en taxi en longeant le fleuve, dont la crue brutale vient de provoquer un drame : Madina S., une jeune femme d’origine tchétchène, vient de mourir noyée, ainsi que l’un de ses enfants tombé à l’eau et qu’elle essayait de sauver. Le fait divers a bouleversé la population locale et l’on ne cesse de parler de ces corps flottants dans les eaux agitées, descendant le fleuve sur de nombreux kilomètres.
Entre-temps, le soleil de juillet est revenu et c’est dans la canicule que se déroule le séjour de la jeune femme. Elle ne parle pas allemand, a du mal à se débrouiller, d’autant que son amie Dora, qui lui prête son appartement et devait l’accueillir, n’est pas là et est difficile à joindre par téléphone. Puis, assez vite, la rencontre qu’elle avait longuement préparée devient improbable, et impossible. Elle doit alors passer un long week-end dans ce lieu aimable mais sans agrément particulier, sinon la fondation dédiée au peintre, qu’elle ne visitera pas, et un concert qui permettra à la société locale de se retrouver.
Une rencontre change tout : Thérèse sent « presque violemment le regard » de Karl Ritter sur elle. Il est assis près d’elle, à une table de restaurant. Il s’approche et ils font connaissance. La suite, ce samedi et ce dimanche passés non loin de Salzbourg où elle pourrait prendre son train pour rentrer à Paris, nous laisserons aux lecteurs le soin de la découvrir en détail. On s’y laisse prendre, on s’y reconnaît, en tant que proie du sentiment, comme l’héroïne d’Hélène Lenoir : « si je le touche, il tombe » se dit Thérèse au milieu du roman. Lui craint plus que tout « l’horreur partagée d’un dimanche qui s’annonçait torride ».
Entre Thérèse et Karl Ritter, le lien est en effet vite tissé. Il a cinquante-trois ans, c’est un homme élégant, bien installé, ayant acquis une certaine réputation comme architecte restaurateur, mais pas seulement. Sa mère est considérée comme une folle, lui-même rendrait les femmes folles, et Hella, son ex-compagne, l’était assez pour qu’il ait peur d’elle, comme des autres femmes désormais. Cette peur sera l’un des moteurs de la relation avec Thérèse. Il préfère se comporter en « solitaire, grincheux et fatigué », mène une « vie d’homme traqué » passant son temps à faire des réussites ; il bat et rebat des cartes. Elle est plus jeune que lui, son statut est des plus précaire. Elle semble vivre (habiter serait plus juste) chez un homme qui la « paie en nature ». Pour être précis, il l’envoie en reportage sans la rémunérer, considérant sans doute son hébergement comme un paiement. Bref, elle manque de ressources et les heures qu’elle passe dans la ville étrangère lui coûtent plus cher qu’elles ne lui rapporteront. Rester une nuit supplémentaire ne lui est pas possible, et pourtant, quand elle doit quitter le logement que lui a prêté Dora, c’est nécessaire.
L’instabilité de Thérèse n’est pas que matérielle. Elle est attirée par Ritter, autant par son charme, la solidité qu’il incarne, que par sa fragilité. Dans une belle scène nocturne, le samedi soir, elle s’accroche à lui, et l’on se figure certains plans de Bergman, un fond de parc en été, la fulgurance des émotions, leur vanité soudaine et une scène presque triviale, qui se termine sur une fuite éperdue. « Lass mich in Ruh », lance-t-il en s’éloignant. « Laisse-moi tranquille » : l’expression reviendra comme un leitmotiv au fil de ce roman qu’on entend, et qu’on voit, comme toujours chez la romancière. Entre le travelling d’arrivée dans la ville, le taxi longeant le cours du fleuve, et le moment de la rencontre, plan fixe sur la jeune femme vue par Ritter, comme on en avait dans Son nom d’avant, on est sensible à ce souci du cadre, et à celui de la bande-son qui accompagne les images. Elle est multiple, parfois confuse, à l’image de ces êtres qui ne savent pas, qui cherchent, qui veulent et ne veulent pas : monologues, phrases interrompues, échanges parfois directs, souvent en sous-conversation, on est pris dans cette trame sonore qui, par certains côtés, s’apparente à du marivaudage. Certes, pas à celui du dramaturge qui lui a donné son nom, mais à celui qui naît de l’incertitude qui pèse sur nos vies. Faut-il se livrer à l’autre ? Et jusqu’à quel point sans en devenir la dupe ? La relation que Dora, l’amie qui l’héberge, entretient avec « son Dragan » fait écho à celle que vivent Karl et Thérèse, le temps d’un week-end. Et on pourrait s’interroger sur le lien qui unit Jung à Yvonne, son épouse et Cerbère, les deux fonctions n’allant pas l’une sans l’autre.
Communiquer. Ça ne va jamais de soi dans les romans d’Hélène Lenoir. Cela ne fonctionne jamais comme on le voudrait et la technique joue son rôle dans l’échec. On ne compte pas les téléphones qui fonctionnent mal, les répondeurs qui parlent dans le vide, les messages qui n’arrivent jamais à leur destinataire. On ne décroche pas, on masque son nom… C’était le cas dans Pièce rapportée, sur un mode dramatique, c’est le cas dans ce roman plus léger, presque une comédie sentimentale. Et à ces objets qui ne remplissent pas leur fonction font écho les phrases torrentielles, mêlant pensées multiples et faits, brassant comme le fleuve les eaux tourmentées des sentiments. On se laisse emporter, sans jamais se perdre ; l’écriture d’Hélène Lenoir est toujours maîtrisée sous le dehors de la confusion, de l’excès.
À la fin du roman, la narratrice procède par séquences brèves, champ/contrechamp sur Karl et Thérèse, tandis que se déroule le concert, ses bis, ses applaudissements. Elle est dans la salle, sinon dans l’écoute de la musique ; il est chez lui, puis en chemin. Le rythme se fait haletant ; on attend l’issue.
Le mot « chaleur » clôt le roman. Ce n’est pas vraiment un hasard.
Norbert Czarny
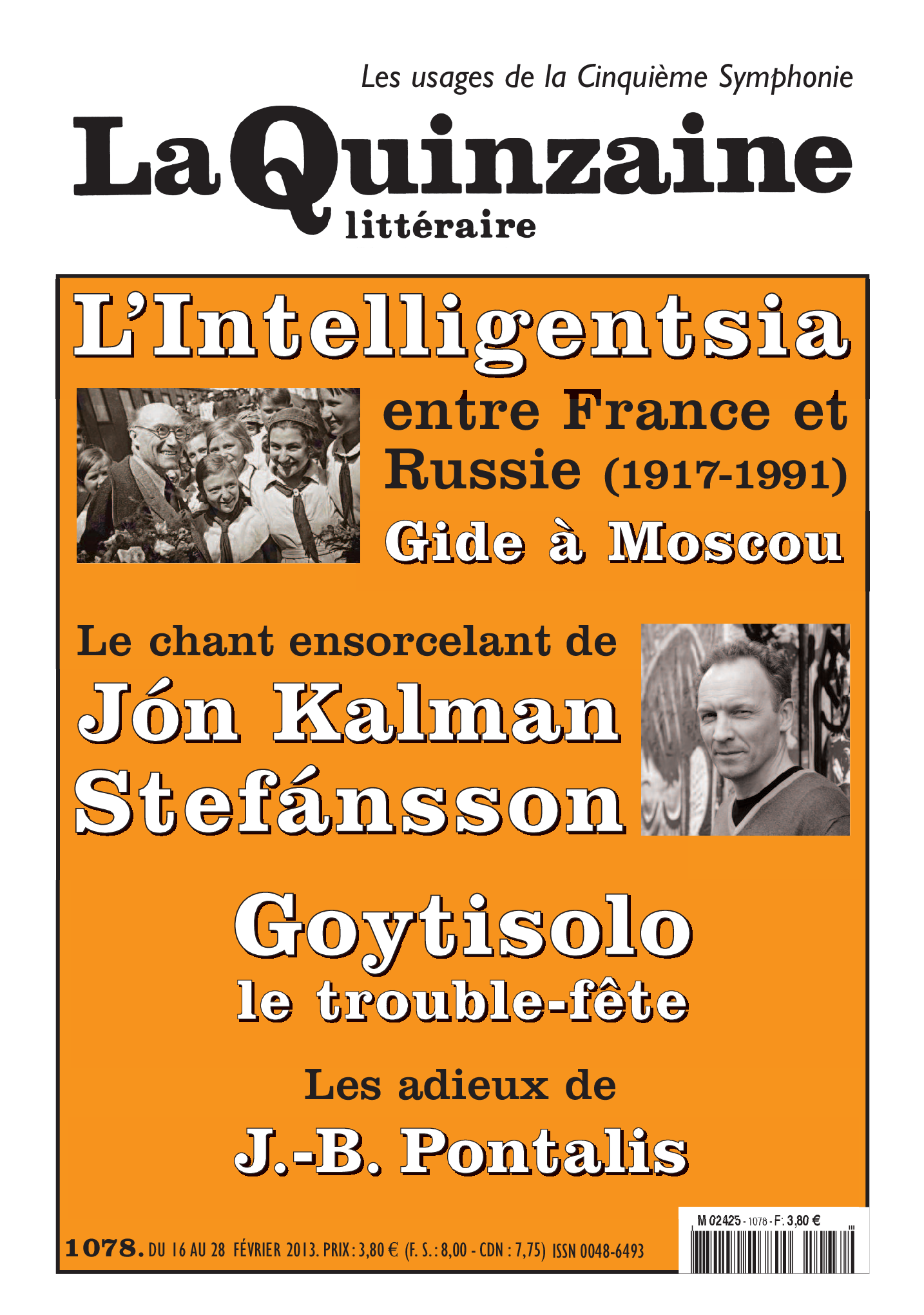

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)