Nous n’irons pas jusqu’à écrire que le programme hivernal est de premier intérêt et rachète l’institution, l’hommage rendu à Steven Spielberg, avec master-class et compagnie, étant manifestement organisé pour faire du chiffre. On ne comprend pas sinon l’urgence de rassembler trente titres déjà vus par quelques milliards de spectateurs planétaires, qui passent régulièrement sur toutes les chaînes de télévision et sont tous disponibles en DVD – même si sont inclus deux téléfilms inconnus du début des années 70. On sent là-dessous comme une intention de fournir en janvier 2013 un bilan record, comme celui de janvier 2012, lui-même bien meilleur que le millésime précédent, etc. Le talent de l’auteur du récent Secret de la Licorne n’est pas en cause, pas plus que celui de Tim Burton, sujet de la prochaine Grande Exposition Annuelle (7 mars/5 août) avec rétrospective à la clé – même si le mérite du second nous semble plus réel et moins tapageur que celui du premier –, mais cette course au remplissage des espaces est assez pénible, et apparemment destinée à se renforcer. La raison d’être d’un organisme patrimonial n’est pas de faire résonner constamment les tiroirs-caisses, mais de multiplier les propositions capables de satisfaire l’appétit de découverte de chacun.
Par bonheur, la Cinémathèque, en parallèle avec l’hommage au wonder boy hollywoodien, annonce pour février une rétrospective King Hu, dont A Touch of Zen avait estomaqué ses premiers spectateurs il y a maintenant quarante ans. On rêverait presque de n’avoir jamais vu Raining in the Mountain (1978) ou L’Hirondelle d’or (1964), afin d’avoir le plaisir de les découvrir aujourd’hui. Malgré leurs efforts et la beauté de certains de leurs produits, les spécialistes du wu xia (films de sabre) n’ont jamais fait mieux dans la fulgurance du mouvement et la chorégraphie des combats. L’œuvre est courte, une quinzaine de films, mais essentielle et inoubliable.
Des qualificatifs que l’on peut accoler au nom de Robert Altman, qui va être longuement honoré par Bercy presque deux mois durant. Et là, nous ne pouvons qu’applaudir, car il s’agit d’une première, aussi surprenant que cela paraisse : jamais, à notre connaissance, son œuvre entière n’avait été rassemblée. Il aura fallu attendre le cinquième anniversaire de sa mort pour avoir l’occasion de revenir de façon complète sur celui qu’ici même (QL n° 937, 1er janvier 2007) nous définissions comme « le cinéaste américain le plus important du demi-siècle ». Cent dix-sept numéros plus tard, et avant même d’avoir jeté un œil sur les quelques titres qui nous avaient échappé, nous sommes prêt à répéter la même phrase : rien de ce que nous avons pu voir depuis, signé Eastwood ou Scorsese (ou la revisitation de Kubrick l’an dernier), ne nous autorise à changer d’avis.
La Palme d’or (qui n’était d’ailleurs à l’époque que le Grand Prix international du Festival et ne deviendra Palme qu’en 1975) récoltée par M*A*S*H en 1970 a fait ranger son auteur dans les rangs du Nouvel Hollywood. En réalité, Altman était de quinze à vingt ans plus âgé que ses collègues Coppola ou Spielberg, tournait sans discontinuer depuis 1951 et avait une filmographie déjà très chargée en séries télévisées célèbres, Alfred Hitchcock Presents, Bonanza ou Peter Gunn. C’était tout sauf un débutant. L’engouement pour la Nouvelle Vague américaine et le succès cannois lui a permis d’abandonner la télévision (il y reviendra dix ans plus tard) et d’aligner en une décennie quinze films, dont une grosse partie d’œuvres époustouflantes, de Brewster McCloud (1970) à Popeye (1980), via John McCabe (1971), Le Privé (1973), Trois femmes (1977), Un mariage (1978) et un chef-d’œuvre, Nashville (1975).
Un mystère demeure, que nous n’avions pas su expliquer sur le moment et que la relecture de ses productions dans l’ordre permettra peut-être d’élucider. Comment Altman avait-il pu si bien cacher qu’il était un auteur, avec un univers particulier, une maîtrise et une intelligence telles qu’il pouvait s’emparer d’un genre, western, polar, comédie psychologique, drame choral ou science-fiction (l’étonnant Quintet, 1979), les tordre pour en exprimer le meilleur et passer à autre chose ? Dans le peu que nous connaissions de lui avant M*A*S*H*, rien ne nous était apparu comme identifiable : Countdown (1968), film assez ennuyeux sur la conquête spatiale, That Cold Day in the Park (1969), psycho-thriller peu mémorable, auraient pu être attribués à n’importe quel réalisateur de série. Du jour au lendemain ou presque, surgit un cinéaste qui, à 45 ans révolus et 110 titres télévisés au compteur, va renouveler en profondeur la vision que nous avions du cinéma américain. La rétrospective présente deux titres antédiluviens, datés tous deux de 1957, The Delinquents et The James Dean Story, de quoi traquer les prémisses de l’Altman futur. En tout cas, notre théorie d’une histoire du cinéma réduite à la liste du premier film de chaque auteur et néanmoins significative est ici défaillante.
Ce n’est pas parce qu’il est un géant qu’il a toujours transformé en or tout ce qu’il touchait. Les années 70 s’achèvent sur Popeye, film précieux, d’une invention rare, fourmillant de détails succulents, sans doute la plus pertinente adaptation d’une bande dessinée à l’écran – également, côté finances, un des naufrages les plus mémorables de l’histoire d’Hollywood. Il lui faudra dix ans pour regagner la confiance des producteurs. Dix années pendant lesquelles il travaille (une douzaine de titres), en resserrant son inspiration : terminées les fresques à la Nashville (24 personnages), les sociétés en coupe type Un mariage (48 personnages), vivent les films clos, Reviens, Jimmy Dean, reviens (1982), le monologue de Secret Honor (1984), les adaptations de Harold Pinter (Basements, 1987). Films imparfaits, passionnants sur le plan de la direction d’acteurs (Philip Baker Hall/Richard Nixon dans Secret Honor, John Travolta dans Le Monte-charge de Pinter), à l’égard desquels on conserve un attachement certain – ce qui n’est pas le cas pour Beyond Therapy (1987) ou le catastrophique O.C. & Stiggs (1985), qu’il conviendra d’éviter.
En revanche, tout est à (re)voir de ce qu’Altman a tourné après 1990 : The Player (1992) est un réjouissant jeu de massacre anti-Hollywood, Short Cuts (1993), d’après Raymond Carver, est le pendant en altitude de Nashville, un film-monde dont chaque nouvelle vision renforce la puissance. Gosford Park (2001), à travers sa recréation des années 20, trace une subtile illustration de la lutte des classes et The Last Show (2006) nous adresse un adieu (non prévu) en beauté. Même les films peu renommés, Prêt-à-porter (1994) ou Dr. T et les femmes (2000), méritent le détour, car porteurs de richesses mal perçues sur le moment. Mais le cadeau sans prix que nous offre la rétrospective est la projection des onze épisodes de Tanner (1988), série télévisée mythique, digne, selon les témoignages, de ses fameux successeurs, À la Maison-Blanche ou The Wire, que nous allons enfin pouvoir juger sur pièces.
Chacun de ses films tournait le dos au précédent – et ne ressemblait à aucun de ses contemporains. Insaisissable et imprévisible, à l’écart de tout ce qui constitue la majeure partie du cinéma qui se fait : décidément, Altman nous manque.
Lucien Logette
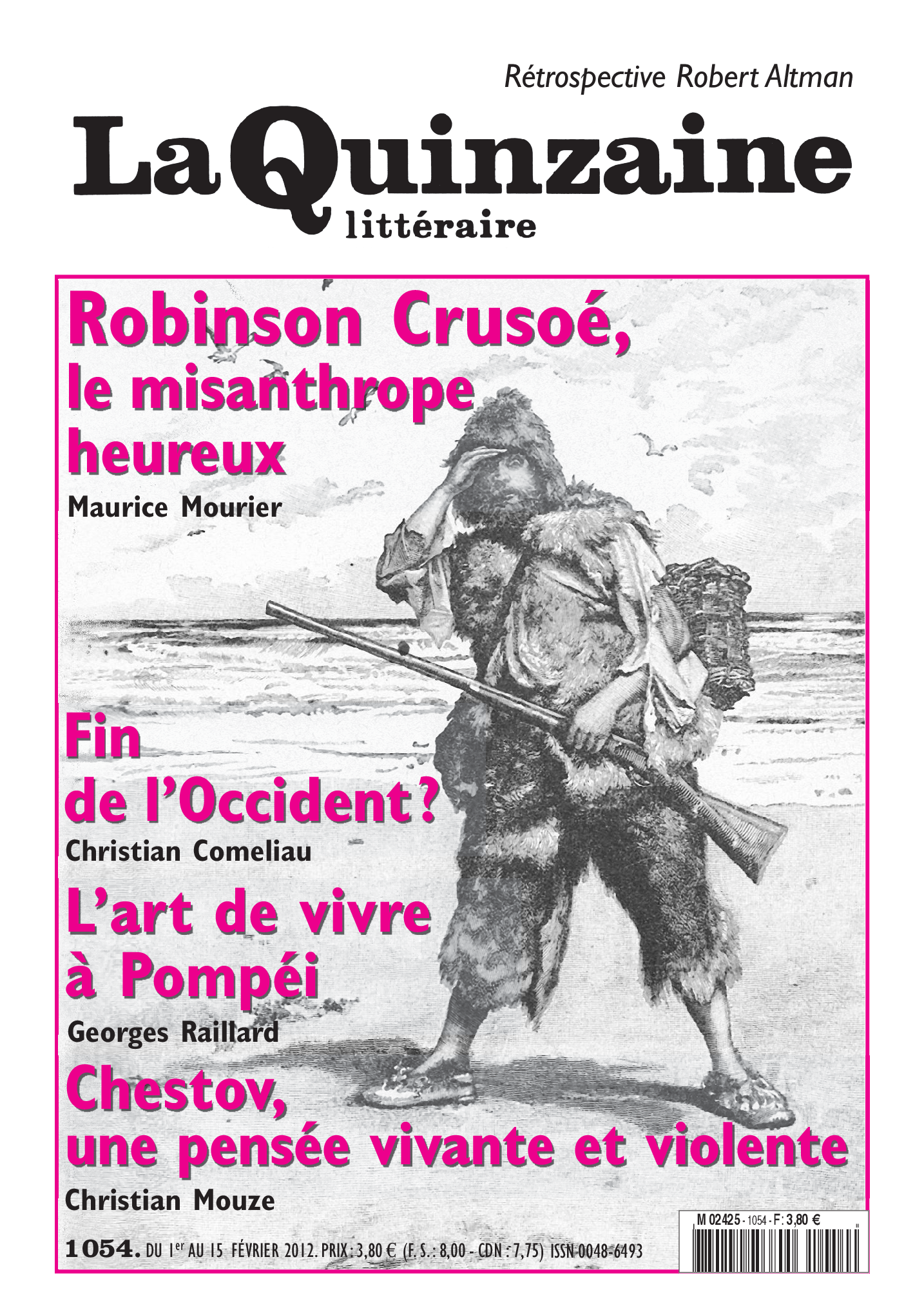

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)