Le Kojiki ou « Récits des Temps Anciens », une compilation effectuée pour le compte de la Maison impériale par le barde Hieda-no-Are en 712 de notre ère chrétienne, raconte entre autres mythes réjouissants l’histoire édifiante d’Amaterasu, la déesse du soleil. Fille de l’œil gauche d’Izanagi, lui-même issu de la huitième et dernière génération des dieux créateurs primitifs, elle entre en conflit avec son frère Susanowo, sorti, lui, du nez d’Izanagi et dieu de l’orage, parce que celui-ci, en vilain garnement, a bouleversé les champs de riz bien irrigués sur lesquels la chaleur solaire, c’est-à-dire la déesse en personne, répandait ses largesses. Irritée, Amaterasu s’enferme alors dans une caverne, privant ainsi le monde de lumière.
Consternation des autres divinités, petites ou grandes – les kami – qui ne sont pas moins de huit millions. Elles se réunissent en conclave et imaginent toutes sortes de stratagèmes pour extirper la boudeuse de son trou. En vain, jusqu’à ce que l’une des participantes, du nom d’Ama-no-uzume, montée sur un podium, entreprenne de se dévêtir en cadence au son d’une musique, on veut croire, céleste. Au terme de son effeuillage, quand elle ôte l’ultime voile et montre son sexe à l’assemblée des dieux, ceux-ci, à la fois ravis et gênés, éclatent d’un rire si communicatif – pensez, ils sont tout de même huit millions ! – qu’Amaterasu, cédant à la curiosité, entrouvre l’huis et pose un pied dehors.
Aussitôt on l’empêche de réintégrer son gîte à l’aide d’une corde qui bouche le passage, la divine lumière revient, avec elle la vie, cependant que le rire des kami fait le tour de la terre. Et voilà pourquoi, aujourd’hui encore, un des spectacles les plus japonais qui soient consiste en l’exhibition du sexe ouvert des strip-teaseuses au fond de petites salles populaires que l’on trouve près des gares et dans les innombrables quartiers chauds qui, depuis des siècles, sont un des agréments indispensables de la ville nippone, voyeuse en diable et bon enfant, plus portée sur l’extase passive que sur la violence de la possession.
Que François Laplantine, dans son excellent livre Tokyo, ville flottante (Stock, 2010), où il analyse en sociologue subtil la « scène urbaine » d’une capitale entre toutes fascinante, n’ait pas consacré une ligne à ce divertissement underground, voilà qui ne laisse pas d’étonner. N’a-t-il trouvé personne pour l’affranchir à ce sujet (au Japon, le respect éprouvé à l’égard de l’autorité venue d’Europe ou d’Amérique a parfois un effet paralysant) ? Mais en l’occurrence, c’est dommage, car il n’y a rien là d’anecdotique, le soleil étant l’emblème du Japon et la légende d’Amaterasu, héroïne féminine, ce qui constitue déjà une étrangeté, nous paraissant à peu près unique au sein des diverses mythologies. N’est-elle pas dotée de détails si particuliers qu’ils ne peuvent pas ne pas en dire beaucoup sur l’archipel et ses habitants ?
Sur la chambre japonaise notamment, qui s’oppose en tout point à la déplaisante et obscure caverne du conte, connotée si négativement. Soit une minuscule aventure dont l’authenticité est garantie. L’un des charmes du Japon, qui en compte tant, c’est l’auberge traditionnelle, qui n’a comme défaut, si elle est vraiment conforme à l’idéal ancien du bien-être, que de coûter beaucoup plus cher que les hôtels à l’occidentale, partout répandus aujourd’hui par commodité. Au cœur de l’été torride entrons ensemble dans une de ces auberges, sise en bordure d’un isthme sablonneux de la mer Intérieure, du côté d’Okayama par exemple, au sud-est du Honshu, l’île principale.
Vous venez – supposons que c’est vous l’acteur – tout juste de finir de dîner sobrement d’exquises babioles crues ou saisies à grande friture, de gâteaux à la pâte de haricots rouges, vous avez pris un bain brûlant, vous êtes en yukata, le pyjama léger d’une seule pièce fermé à peine d’une fine ceinture, le tout en coton à carreaux bleus et blancs. La chambre presque nue semble close par une porte coulissante de bois sommée de lucarnes de papier translucide. Tout est calme. Allongé sur le sol de paille de riz odorante et élastique, vous faites l’amour avec votre compagne, dans un sentiment d’absolue sérénité dû en partie au confort fait de simplicité et de raffinement, de fragrance rustique et de douceur qu’on ne trouve qu’au Japon.
Soudain, la porte glisse sans bruit, une soubrette que rien n’a annoncé, qui n’a pas pris la peine de signaler son imminente irruption dans votre intimité, entre pour faire le lit, c’est-à-dire pour prendre dans un des placards dissimulés au bas des lattis de papier et de bois qui tiennent lieu de murs le mince futon qu’elle étalera sur le tatami avant de vous souhaiter une bonne nuit. Naturellement, vous surprenant en pleine action, elle feint la surprise et la confusion, étouffe même un petit cri derrière son poing, s’enfuit sur un rire de gorge qui consonne merveilleusement avec celui que poussèrent, pour la paix des rizières et le bonheur des vivants, les dieux moqueurs du temps d’Amaterasu. Voyeuse ? Certainement, et pas tout à fait innocente (au sens étroitement chrétien du mot), ayant brisé avec tant de naturel les scellés qu’on aurait dû apposer contre le Dehors de cette chambre qui ne se défend pas, cette chambre machinée pour l’intrusion.
Ainsi fonctionnent quand leur sujet est la vie urbaine les emaki-mono, ces dioramas de plusieurs mètres qui racontent une histoire en anticipant de manière si magistrale sur la bande dessinée. Ainsi les milliers d’estampes qui, au XVIIIe siècle, lors de l’apogée de l’ukiyo-e, dépeignent les mœurs des commerçants ou des fonctionnaires délaissant, le soir après cinq heures, leur pénible labeur pour aller jouir des plaisirs érotiques, fantasmés autant que réels, des maisons spécialisées d’Asakusa ou de Gion. Il n’existe alors que très peu d’édifices en dur, ou dont le soubassement au moins soit bâti de pierre – ce sont les châteaux. La ville n’offre qu’un inextricable entremêlement de ruelles. Les riches demeures comme les modestes sont faites de bois et de papier, où sur de faibles dénivelés s’accolent et se superposent des pièces d’apparat remarquablement vides et des enfilades de chambres, le tout souvent sur pilotis et flanquées de longs déambulatoires extérieurs de parquet ciré donnant sur de minuscules jardins. Voir Mizoguchi et le palais de Dame Wakasa dans Ugetsu monogatari (Les Contes de la lune vague après la pluie).
Dans cet univers enchevêtré et surpeuplé, que de portes entrebâillées où se devinent les silhouettes d’une servante curieuse, d’un amant circonspect ou délaissé, d’un témoin plus ou moins opportun de ce qui se passe dans la fausse sécurité des chambres continûment surveillées, épiées, en fait plus caravansérails que coffres-forts ! Big Brother ? Non pas, ou pas seulement. Bien sûr, l’Empire et tous les daimyo locaux et rivaux entretiennent des sbires, des espions qui rapportent en haut lieu frasques et alliances des ennemis et des subalternes. Mais l’essentiel nous semble être ailleurs.
On se claquemure dans la chambre occidentale, on y tire le verrou, on y crève à petit feu. La privacy, conquête non négligeable de l’individualisme de chez nous, se paye d’une bonne dose d’enfermement, de petitesse et de moisissure. Nos chambres : machines à chambrer. Là-bas, au pays du Soleil levant, le besoin de nature est si primordial (sentir la pluie, le goût de la pluie, le vent, le parfum du vent) qu’a été créée par un génie singulier l’anti-chambre, celle qui donne sur le monde, où le monde pénètre, et l’étranger, voyeur potentiel. Civilisation du monde flottant, de l’absence de péché, de la proximité avec ce Rien volontiers rieur qui, en dehors de toute transcendance, se confond avec notre Tout, un Rien néanmoins pourvu de millions d’yeux.
Au fait, aujourd’hui la majorité des citadins japonais ont appris, bien forcés, à vivre dans des clapiers à l’occidentale, s’asseyent à des tables sans plus savoir s’accroupir ni plier les genoux, et ferment la serrure de leur chambre. Ayant cessé d’être voyeurs, ont-ils gardé le plaisir d’être vus ? Nul doute en tout cas que cette forme particulière de la mondialisation galopante a déjà fait ou fera plus pour la perte du charme unique de leur mode de vie que l’invasion de gadgets électroniques déréalisants et isolants dont ils sont, par ailleurs, les consommateurs les plus fous.
Maurice Mourier
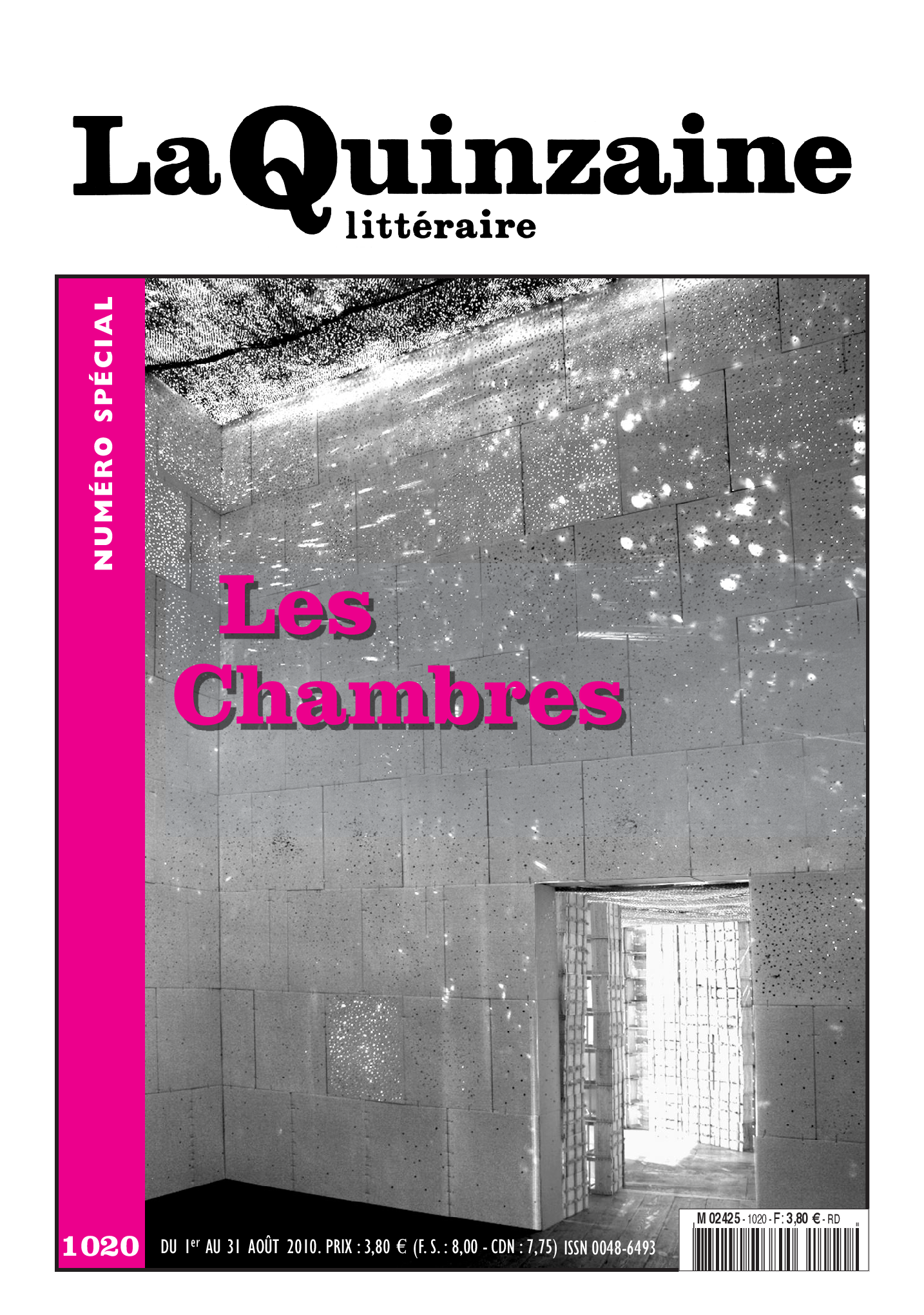

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)