Hugo Pradelle – La chambre semble relever d’une dynamique entre le caché, le tu, le circonscrit, l’intime, et son exhibition, sa diction, et la relation que cet espace entretient avec tous les autres, en tant que centre peut-être.
Michelle Perrot – Je pense qu’il y a là une grande part de rêve, et ma chambre s’y loge, excédant une dimension simplement réelle. Je pense qu’il y a en nous un nœud de secrets que l’on ne livre pas, qui fait peut-être que derrière tout ça, il y a autre chose que nous n’atteignons pas. La totale transparence me paraît insupportable. Réclamer que l’on dise tout me semble nier l’Histoire, et cela m’effraie. Il faut ne pas cesser de découvrir sa chambre. L’entrebâillement sur cet espace n’en finit pas ; c’est la vie, on n’ouvrira jamais en grand, et ce n’est pas mal. Dans la culture occidentale, la chambre s’apparente au lieu de l’individualité qui s’y exprime, s’y réfugie. Lorsque quelqu’un veut être seul, il s’y enferme. Bien que la solitude constitue l’élément le plus central, le désir d’être seul n’est pas purement égoïste, la chambre peut être un lieu de retraite qui permet ensuite de se retrouver dans le monde. La boîte, les quatre murs, l’espace minimum pour le corps, pour soi, ensuite partagé avec d’autres, la conjugalité, l’amour, la lecture, constitue un espace matériel tout entier organisé autour de l’individu. Il y a un lien très fort dans notre culture qui s’établit entre soi, l’espace privé par excellence et l’expression de l’individu pour soi.
H. P. – Pourquoi cela se noue-t-il à partir de la Renaissance et surtout à l’époque moderne, ce que je qualifierais de monde bourgeois ?
M. P. – C’est une des choses relativement claires dans cette histoire compliquée. À partir du moment où l’Église, incarnation de l’autorité absolue, fait, au Moyen Âge, le choix du mariage comme centre de la famille, comme pivot de la féodalité (ce que Georges Duby explique très bien), qu’elle instaure en rendant le couple indissoluble, par le sacrement, au XIIIe siècle, elle règle jusqu’à la vie la plus intime des gens, leur imposant des normes d’une grande rigidité qui se répercutent dans son organisation concrète. La chambre devient alors un autel pour la conjugalité, et le couple a droit, presque devoir, comme Saint Augustin l’écrit dans un beau passage des Confessions, de dissimuler aux autres sa sexualité qui doit demeurer strictement voilée – et pour cela, il faut une chambre. Ce choix social remanie l’espace, et pendant plusieurs siècles, la chambre va s’imposer comme lieu majeur de la maison.
H. P. – La sexualité y contribue donc au premier chef.
M. P. – Progressivement, elle se libère de l’obligation de sexualité conjugale comme seule légitime ; la procréation n’est plus le but unique, le plaisir gagne sa part ; les mœurs se libèrent, des déviances sont peu à peu admises. C’est toute l’histoire du XIXe siècle qui se joue, jusque dans le triomphe du théâtre de boulevard. Nous assistons à un effacement de la conjugalité qui, depuis 1950 surtout, marque notre époque ; le mariage n’est plus un objectif majeur mais un point dans une constellation, peu à peu remplacé par la centralité de l’enfant qui lui a ravi son essentialité.
H. P. – Vous dites que la chambre constitue la « particule élémentaire » d’un ordre du monde, que c’est un lieu propice, essentiel, à la pensée.
M. P. – La cellule me fascine depuis longtemps ; j’admire les scientifiques qui travaillent sur les cellules, l’ADN, le microscopique… Ce modèle du travail scientifique, humble, dans lequel à travers l’étude du minuscule apparaît le fonctionnement d’un tout… Ainsi, considérer la chambre comme lieu élémentaire pour voir le social permet de penser une globalité et ses détails. Une multitude de diagonales s’y entrecroisent – les âges de la vie, l’amour, la maladie, la mort, le sommeil, le repos… C’est une entrée dans la nuit, dans le rêve dont Freud nous dit qu’il nous livre peut-être notre moi profond. Ce n’est donc pas rien que le théâtre de la chambre. J’ai souhaité me replacer au centre de la chambre et en faire un observatoire du monde, de la société. J’ai tenté de transformer ce lieu subjectif en celui d’une analyse du collectif. Comme un plan dans lequel des diagonales s’entrecoupent. Regardant, à partir de ce lieu clos mais néanmoins ouvert, dans une position quelque peu panoptique. Il ne faut cesser de penser ce lieu, de reconsidérer cet espace, de l’envisager sous tous les angles, parce qu’il synthétise beaucoup de choses.
H. P. – La chambre appelle à la fois une étude et une réflexion sur la pratique… La chambre est-elle le lieu de la subjectivité possible ?
M. P. – En écrivant ce livre, je n’ai pas voulu faire une leçon d’histoire, c’est un essai modeste dans lequel j’ai cherché à sortir d’un carcan, d’une identité trop fixe, c’est une certaine libération. La chambre est un espace limite, peut-être ne peut-on pas aller plus loin dans l’exploration de la frontière entre le collectif et l’individuel – et c’est une part centrale de mon travail depuis longtemps. Ainsi, plusieurs lignes traversent ici ma réflexion : le temps, la généalogie, l’espace, la chambre boîte qui pour moi est très importante… Je m’intéresse aux expériences, à savoir comment les groupes sociaux – hommes, femmes, paysans, bourgeois, homosexuels, écrivains, que sais-je… – et les individus, vivent la chambre. Il me semble important de faire de chacun le sujet de sa chambre. Les romanciers, les poètes, me passionnent parce qu’ils en parlent eux-mêmes, parce qu’ils ne sont pas médiatisés par d’autres, ils sont des sujets forts en quelque sorte.
H. P. – L’instauration de cette subjectivité doit aussi se penser dans le champ politique, à l’aune de la démocratie.
M. P. – Tout est politique, et la chambre l’est aussi. Directement, lorsque l’on pense à la chambre du Roi, au centre du Palais comme absolue centralité, pour qu’il puisse hypothétiquement voir tous ses sujets et qu’ils puissent être hypothétiquement toujours vus. On retrouve ici cette question de la transparence dont je parlais : elle était postulée mais impossible, aujourd’hui elle est réalisable. L’évolution politique est presque là en quelque sorte, entre cette transparence rêvée du pouvoir et la transparence réalisée du pouvoir. Un lien existe entre l’instauration de la chambre comme espace privilégié de l’individu et l’évolution vers l’âge démocratique. La chambre se fait alors l’écho d’une certaine modernité.
H. P. – N’est-ce pas à dire que les sujets ont acquis une puissance qu’ils n’avaient pas et qu’ils s’imposent eux-mêmes cette transparence ? Vous ne dites pas cela ouvertement dans le livre mais il semble que c’est ce vers quoi votre réflexion tendrait…
M. P. – Oui, me semble-t-il. Le pouvoir des sujets me frappe beaucoup, cette extraordinaire capacité qu’ont les gens de résister même aux pouvoirs les plus insidieux tout en reconstruisant eux-mêmes leur sphère privée… La chambre était ou est encore un moyen de le faire. C’est un espace démocratique. Lorsque Michael Walzer dit que la chambre d’hôtel est le summum de la démocratie, que l’individu qui ne possède pas un espace peut quand même le louer, obtenir une clé pour le fermer et s’abstraire, et dire : « ce lieu est à moi » ! La chambre devient le lieu en suspens de la démocratie. Elle renvoie à un rapport de pouvoir entre le dominant et le dominé, mais porte un relatif optimisme, puisque les dominés ne le sont pas purement… Encore une fois, ils peuvent s’approprier un lieu, résister aux regards extérieurs et ont, pendant un certain temps, la nuit peut-être, le droit d’être eux-mêmes. Je trouve intéressant que lors de la Révolution française, soit décidé que l’on ne perquisitionnerait pas chez les gens du coucher au lever du soleil. Il y a au moins un lieu et un temps totalement à soi. Il y a cette idée que la nuit appartient aux individus et que même le pouvoir le plus fort n’a pas le droit de franchir leurs seuils. Cette nuit étrange, qui fait peur aux gens, obscure, forme en même temps le lieu de leur liberté. Si vous voulez, l’histoire de la chambre est une contribution à l’histoire de la nuit, la nuit astronomique, et aussi la nuit politique.
H. P. – Il y a donc un lien entre la conquête de la liberté et le triomphe du besoin de « privance ».
M. P. – Oui, obscurément sans doute. Nous vivons dans un espace matériel, et la clôture, le rempart dont Rousseau a fait le signe de la propriété peut être aussi le signe de notre liberté, sa conquête. Ce qui signifie aussi que la chambre est ambivalente. Elle peut être renfermement, oppressante, et en même temps affirmation d’une liberté personnelle profonde, essentielle. Elle est des deux côtés à la fois et l’individu essaie d’en faire sa chose.
H. P. – Comme les mystiques.
M. P. – Oui. Thérèse d’Avila et une prisonnière volontaire, elle pense – et beaucoup de mystiques avec elle, surtout aux XVIe et XVIIe siècles qui constituent un moment essentiel dans la pensée de la solitude qui n’est pas pour soi mais pour Dieu – que le corps, l’esprit, doivent se libérer de tout, pour parvenir à « la fine pointe de l’âme », son centre. Il y a là une pensée topographique ; ils pensent l’âme comme une chambre qui serait l’intérieur de soi. À force de parler d’intérieur, on finit par le représenter sous la forme d’un espace, et Thérèse d’Avila écrit Les Châteaux de l’âme où elle montre l’individu allant de la première à la septième chambre, se purifiant par ces passages pour aboutir devant Dieu. C’est la fin d’un pèlerinage intérieur, de chambre en chambre.
H. P. – Revenant à l’établissement de la subjectivité dans un lieu, la chambre, par ses dynamiques propres et compliquées, comment s’organise à partir de là ce que vous nommez « l’écriture camérale » ?
M. P. – Le lien entre la chambre et l’écriture est une évidence. On peut l’aborder à la manière d’une épopée. Comme l’écriture, elle apparaît liée au lieu clos. Je pense à ce moine représenté sur une enluminure du XIIIe siècle qu’Alberto Manguel a fait reproduire dans son Histoire de la lecture. Il est étendu sur sa couche, recroquevillé, en train de lire avec sur le visage une expression de profond bonheur. L’écriture a quelque chose à voir avec la solitude et par extension avec la chambre. Longtemps, elle a requis la nuit, car elle réclame l’isolement parmi les autres ; il faut, pour elle, se ménager un coin. Kafka est une figure moderne de cette quête, lui qui dormait dans un couloir et aspirait à occuper une chambre d’hôtel ou même une cave. Ne disait-il pas que « la nuit n’est jamais assez la nuit » ? Ainsi, plus la nuit était là, plus il pouvait écrire. Il y a l’aspect matériel et aussi l’idée médiévale que la nuit est propice à l’inspiration, que nous sommes visités la nuit par Dieu, par l’Esprit, par le Diable aussi, avec une appréhension, une crainte particulière, une méfiance. « Je viendrai comme un voleur » dit Dieu. Voici l’idée de la visitation de l’Esprit pour celui qui réfléchit, pense et écrit. Plus près de nous, les écrivains du XIXe, parfois des incroyants, transposent ça dans la nuit. Beaucoup écrivent la nuit ; Proust en est un exemple presque trop évident, Perec aussi… L’écriture du retrait, de l’espace clos, de la nuit qui nous donne accès à un autre espace.
H. P. – Il y a donc tout à voir avec l’imaginaire.
M. P. – L’idée que l’on trouve tout dans sa chambre, que l’on n’a pas besoin d’aller loin, que le voyage peut être au coin du lit, me semble particulièrement liée au XVIIIe siècle. Xavier de Maistre, dans Voyage autour de ma chambre, a été le metteur en scène d’une pensée particulière qui se développera au XIXe siècle selon laquelle on peut tout faire venir dans la chambre. On pensera à la multitude de publications, de journaux de voyages, d’images… Je pense à la « lanterne magique » de Proust au début de La Recherche qui y introduit Geneviève de Brabant… La pensée de l’imaginaire chez Proust s’enracine dans la chambre enfantine, avec ces images projetées et l’angoisse du sommeil… Encore une fois, la nuit n’est pas loin… Mais il ne faudrait pas oublier la mémoire, ce lien particulier au temps, car la chambre est aussi le lieu du souvenir, de la remémoration. C’est un lien fondateur de la littérature, de la psychanalyse aussi.
H. P. – Il semble que nous attribuions un lieu à la conscience qui est passé d’un possible à un droit, cela conforme-t-il des moyens d’expression et de représentations nouveaux ?
M. P. – Je crois que oui, parce qu’à partir du moment où se conçoit l’idée de l’intériorité, de notre espace intérieur comme un monde infini, cela signifie que la littérature, la poésie, peuvent et doivent advenir, adoptant des manières nouvelles. Cette conception métaphorique issue d’une réalité physique et sociale induit un nouveau rapport à la création intimement liée au lieu de son élaboration, à l’avènement d’un lieu de conscience. Il est frappant que l’évolution du roman moderne suive, presque pas à pas, l’évolution de cette histoire de l’espace que j’esquisse : le roman se fait de plus en plus espace de l’intériorité. Pascal est essentiel à ce bouleversement car, plus qu’il ne formule de manière inoubliable cette idée, il est celui qui rentre dans sa chambre, dans son âme, celui qui dit que dans le ciron on trouve les étoiles, qu’il n’y a pas besoin de chercher si loin que ça, que l’espace minuscule dévoile l’univers. Il y a toujours ce jeu entre le je et l’univers. Cette idée nous ouvre des espaces d’écriture, de représentation littéraire, picturale aussi… Tout est là, derrière cette idée que nous n’en finissons pas d’explorer le monde intérieur – que je choisis de représenter par une chambre.
H. P. – Ainsi, comme en écho à la modernité politique que nous abordions, il semble que se fasse jour une certaine modernité intellectuelle et artistique. Pensez-vous alors qu’il y ait une crise de cette spatialisation et, parallèlement, de notre époque ?
M. P. – Sûrement, mais cette crise n’est pas négative. Il est très visible que nous ne savons pas trop quoi faire de la chambre ; ses fondements existentiels s’effritent – nous n’y naissons pas plus que nous y mourrons –, la conjugalité n’est plus nécessairement la forme du couple, les pratiques sexuelles, les rapports à soi et à l’autre changent profondément. Pourtant, cette crise n’augure sans doute pas une disparition, mais de sérieuses modifications. Ainsi, l’individu et le collectif agissent l’un sur l’autre de façon différente, changeante, le groupe et le sujet autant que le pouvoir et la personne, le féminin et le masculin, l’autorité familiale, l’espace public et l’espace privé, adoptent des dispositions redéfinies, perturbantes. Les moyens de communication y sont pour beaucoup je crois, car dès lors la position de l’individu n’est plus la même. Il peut à la fois s’approprier beaucoup plus de choses tout en étant en mesure d’être absolument observé. Il y a donc une certaine ambiguïté dans notre époque, et dans cet espace minuscule se jouent des enjeux de société majeurs. François Bon disait : j’ai l’ordinateur dans ma chambre, je n’ai plus besoin de rien, j’y ai le monde entier. C’est un peu l’entreprise de de Maistre réalisée. C’est impressionnant, un peu effrayant, mais formidable aussi. L’individu moderne possède une capacité à se constituer une solitude parmi les autres. L’exemple de ces gens qui téléphonent n’importe où, soudain seuls, me semble symptomatique de cet étrange possible. Ils reconstituent une cellule virtuelle presque inimaginable. Voilà qui témoigne d’une capacité d’invention formidable et déconcertante. Cette capacité se déplace et les êtres s’inventent une nouvelle individualité politique qui excède la solitude. On n’est jamais seul, mais nous semblons avoir besoin d’un refuge. Les individus ont donc leur mot à dire pour se réappropier leurs espaces. Il me semble que tout ceci est très ouvert. J’ai perdu l’illusion qu’il y a une leçon de l’Histoire, elle aide à penser notre temps à entrevoir les questions majeures. Je suis au seuil de la chambre comme devant un monde inconnu. Je n’ai pas la clef mais ne veux pas m’enfermer, mais au contraire me lancer par l’ouverture…
- Michelle Perrot, Histoire de chambres, Seuil, coll. « La Librairie du XXIe siècle », 462 p., 22 €. Lire également l’article d’Anne-Marie Sohn intitulé « Toutes sortes de chambres » in Q.L. n° 1 005.

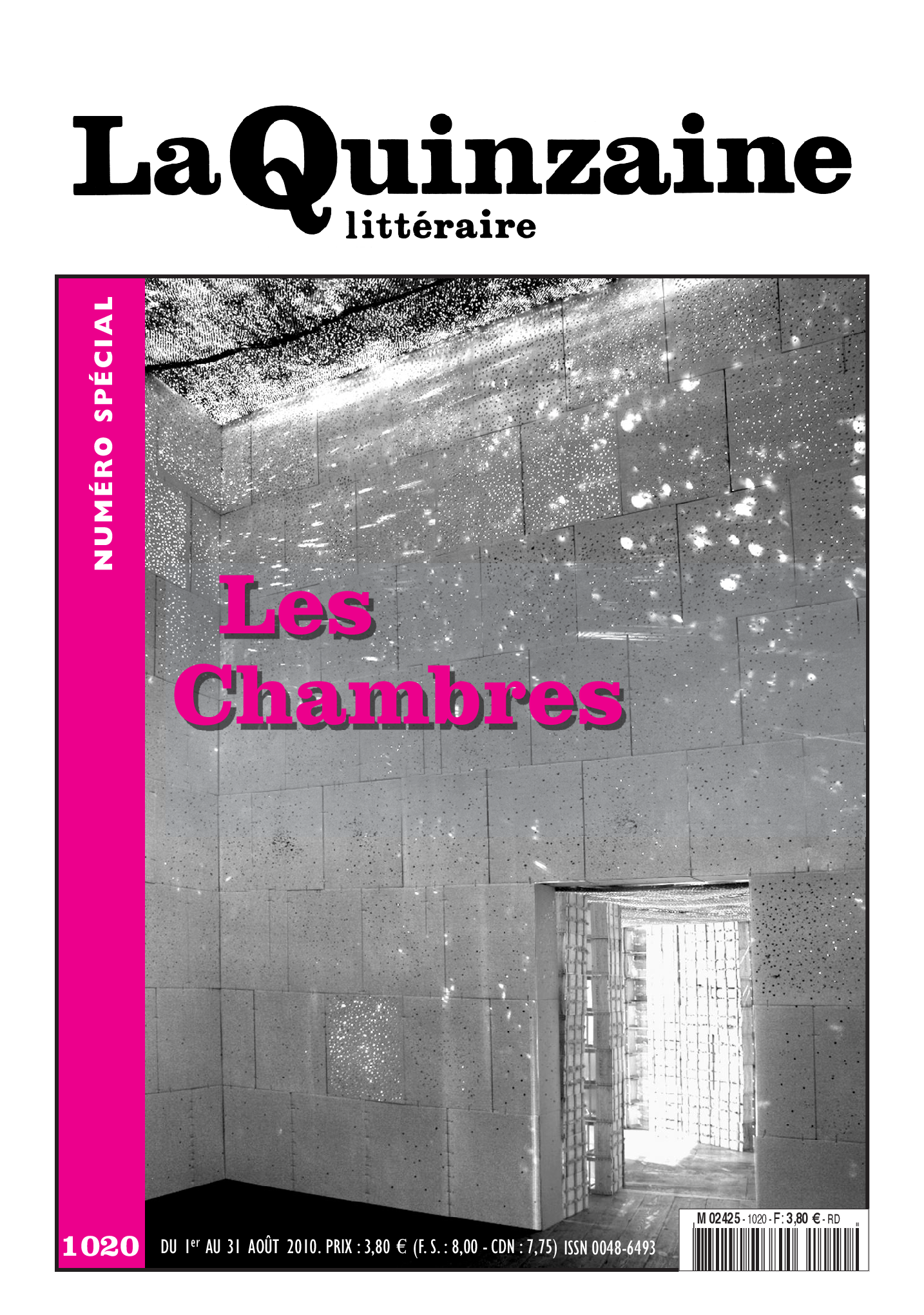

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)