Afin de compenser le sentiment de légère frustration que pourraient ressentir certains lecteurs (la prétention de l’Histoire littéraire à l’objectivité scientifique implique-t-elle le refus de toute réaction personnelle un peu originale devant les « classiques » du patrimoine français ?), la scrupuleuse éditrice joue la carte d’une certaine nouveauté académique : le texte retenu est non celui de l’original mais d’une réédition de 1787, qui a semble-t-il reçu l’aval de Laclos. Mais surtout l’amateur d’iconographie du second rayon trouvera ici de nombreuses illustrations en noir et en couleurs, des gravures de 1785 aux images de films inspirés par l’œuvre jusqu’en 2003, tandis que le curieux de Laclos lira avec intérêt tant ses échanges d’époque avec la bonne Mme Riccoboni, qui lui reprochait son immoralité, que ses propres « Pièces fugitives », une suite de poèmes parfaitement insignifiants, et enfin une sélection chronologique de comptes-rendus ou d’« imitations » critiques, de 1782 (Abbé Royou) à 2005 (Hervé le Tellier). L’ensemble forme un « dossier » excellent en ce genre limité et informatif.
Bien. Maintenant, essayons de lire – de relire bien sûr – ce bien curieux roman par lettres écrit en émulation patente de Jean-Jacques, dont La Nouvelle Héloïse (1761) fut un best-seller du siècle des Lumières, en émulation plus lointaine aussi de Richardson et de sa Clarisse Harlowe (1747-48) qui déjà mettait en scène, par correspondances croisées, les dangers des liaisons hors mariage. Sept ans avant la Révolution à laquelle il participera du côté révolutionnaire avant d’être sauvé in extremis et comme tant d’autres de l’exécution par le 9 Thermidor, un plus si jeune – trente et un ans – artilleur obscur et sans fortune publie en quatre parties un livre dont le succès est immédiat. Succès mérité, pour une fois. S’il fallait aujourd’hui dire pourquoi, on ne serait pas en peine. Il y a là une mécanique, une écriture, des personnages.
La mécanique, celle d’une vengeance à ressorts multiples et raisons futiles d’amour-propre, enchevêtre avec une science de la péripétie jamais mise en défaut les manigances méchantes d’une femme au-dessus de tout soupçon (Mme de Merteuil), les exploits vénériens d’un homme à la mode (le Vicomte de Valmont) et les erreurs en partie excusables de victimes féminines présentées dans toute la gamme des âges (de Cécile, l’oie blanche, quinze ans, à la douairière, Mme de Rosemonde, tante de Valmont).
Au centre de l’intrigue, un très jeune homme (le Chevalier Danceny, vingt ans, amoureux de Cécile, puis séduit par Mme de Merteuil) tient plus ou moins l’office d’électron libre. Quelques très rares comparses (femmes de chambre, valets, une famille villageoise pauvre, un notaire, un religieux) servent de liant occasionnel à un monde autrement clos sur lui-même, en transhumance permanente entre Paris où l’on s’amuse et des châteaux de province où l’on s’ennuie. L’extraordinaire manque de variété et d’intérêt du décor, qu’il s’agisse d’intérieurs ou d’extérieurs, la monomanie des personnages – ils ne s’occupent que d’amour ou de sexe, très rarement mais parfois d’argent –, l’atmosphère de vide oppressant où se meuvent ces existences, tout contribue à rendre efficace la mécanique romanesque, puisqu’en fait on ne voit qu’elle, déployant ses rouages huilés derrière une vitre. Le succès des Liaisons est analogue à celui d’un roman policier usiné au millimètre. Malgré la longueur du livre, on songe aux premières nouvelles, sèches comme un coup de trique, de Dashiell Hammett, ficelées autour de son sceptique « Agent » californien. C’est dire avec quelle solidité se nouent les événements, ne laissant rien à la distraction du lecteur.
Beaucoup de ceux qui écrivent – un tout petit nombre – écrivaient bien au temps de Laclos. Lui-même dans ses poèmes de jeunesse et singulièrement dans cette « Épître à Margot » (on la trouvera page 485) qui fit scandale par ses allusions supposées à Mme du Barry, dernière maîtresse de Louis XV, fait montre d’une agréable virtuosité à trousser le compliment à double entente. Mais Les Liaisons sont un festival de verve et de férocité, qui parvient, en gardant toujours les formes de la politesse des salons, celle que maniaient tous les beaux esprits, et Voltaire au premier chef, à varier les tons en fonction du caractère, de l’âge, de l’intelligence des personnages. Ainsi, et bien que l’on pardonne à la jouvencelle dont l’horizon, jusqu’à ce qu’elle entre dans le monde, s’est limité à l’austérité obtuse des murs du couvent, est-on d’emblée préservé de prendre trop uniment le parti de la pauvre Cécile de Volanges. Elle est certes « bien malheureuse », ce qui l’attend ce ne sont même pas « les crimes de l’amour » et l’on considérerait à juste titre aujourd’hui qu’elle a été violée, qu’elle a fait une fausse couche, qu’elle va s’enterrer à nouveau dans les ténèbres de la vie monastique par la faute sans pardon d’un scélérat.
Mais en même temps sa naïveté, ou pour mieux dire la bêtise incommensurable née pour moitié de sa cervelle de noix et pour l’autre moitié de l’éducation crétinisante qu’elle a subie, explique assez que son sort, sans nous être indifférent, nous semble malheureusement mérité. Or ce diagnostic sans illusion repose sur la perfection dans la nullité de son babil de pensionnaire. Et il en irait ainsi de tous les personnages, y compris du dernier faire-valoir, tel Roux Azolan, le « chasseur » de Valmont, ce grand seigneur méchant homme qui se dévoile si complètement dans la seule lettre de lui que nous ayons (CVII), à la fois obséquieux et arrogant envers son maître, avide d’argent mais aussi de considération, vaniteux et vil : du grand art.
Ce sont du reste en fin de compte les personnages, leur complexité retorse, leur aveuglement sur eux-mêmes, qui font l’essentiel du prix d’un roman qui l’emporte de si loin en finesse psychologique sur tous les livres de son siècle (y compris ceux, si subtils pourtant, de Marivaux), en ce qu’il ne se complaît jamais, même à l’occasion d’un dénouement aussi précipité que tragique – en quelques pages Valmont meurt, Merteuil est déshonorée et défigurée, Danceny et Cécile, les jouvenceaux plus ou moins innocents, se retrouvent dans le cul-de-basse-fosse de la religion –, à quelques espèce que ce soit de bien-pensance édifiante.
Complexes ? Oui, même la pauvre bécasse Cécile, qui trouve refuge, par un sursaut de dignité ou d’inconscience, dans une décision – à quinze ans et demi ! – la ramenant au sein de l’Église, sinon à la foi, solution qu’adoptèrent en effet, sous l’Ancien Régime, tant de pécheresses ou assimilées, mais au terme d’une bien plus longue carrière. Même sa mère, Mme de Volanges, dont on prend d’abord le souci d’établir sa fille dans la prison d’une richesse sans amour pour le couronnement de son conformisme mortifère, et qui se révèle brusquement (lettre XCVIII) capable de véritable amour maternel en acceptant de renoncer au mariage arrangé par elle entre Cécile et le pâle Gercourt, pour favoriser enfin une union d’inclination entre les deux « enfants » dont l’intrigue cachée fait depuis le début le sujet du livre. Il faudra toute la perversité argumentative de Merteuil pour empêcher cette issue heureuse.
Aveugles ? Oui, et sur la passion amoureuse elle-même qui, au fil de ces destins tristement oisifs, occupe pourtant tout l’espace dévolu non seulement au sentiment, mais à la totalité de la pensée. Ils croient pourtant être fort lucides, la pratique obligée du confessionnal, au moins au cours de l’enfance et de l’adolescence, les ayant contraints à aller chercher en eux la petite bête qui grouille dans les recoins de leur cerveau étroit, autrement vide comme un caveau. C’est Valmont qui ne reconnaît pas en lui d’autre fureur que génésique, alors qu’il est tombé amoureux de la Présidente de Tourvel. C’est Mme de Merteuil surtout, qu’il faut des mois d’entretien épistolaire quasi quotidien pour oser s’avouer à elle-même, en le déguisant par un rejet douloureusement faux dans le passé, que Valmont est l’homme de sa vie, qu’elle n’a jamais aimé que lui : « Dans le temps où nous nous aimions, car je crois que c’était de l’amour, j’étais heureuse ; et vous, Vicomte ? » (lettre CXXXI).
Car naturellement c’est elle, la démoniaque, la dynamiteuse du bonheur des couples rivaux, qui incarne le mieux le génie d’analyse de Laclos. Rien n’égale, en ce siècle ou l’on fut si intelligent, la lettre LXXXI où elle confie à Valmont, aux fins de l’humilier par l’image d’une supériorité évidente, l’histoire de ses apprentissages. Ce labeur sur soi, qui semble d’abord ne concerner que la genèse des relations entre deux individus monstrueux, s’élargit très vite en étude de la condition féminine, et des raisons pour lesquelles une femme brillante l’emportera toujours sur le mâle le plus avantagé par la nature, fût-il doué de l’esprit d’entreprise, du charme et de l’esprit tout court qui distinguent le Vicomte. La démonstration serrée et impeccable de Mme de Merteuil dans cette lettre et d’autres qui la complètent ultérieurement plaide très fort pour qu’on lise Les Liaisons comme un formidable plaidoyer féministe. Celui-ci ne reposerait pas seulement sur la figure écrasante et réprouvée de la Marquise, qui parvint à échapper aux horreurs d’un mariage sans amour auquel elle fut livrée vierge, grâce à la Providence (mort rapide du mari) mais surtout à la conquête d’une autonomie entière dans les domaines fondamentaux (amours, affaires) où la monarchie absolue et la dévotion confite enchaînaient ses compagnes à la toute-puissance prétendue de la barbe.
Dans ce roman de femmes, ce sont elles toutes qui sont intéressantes, l’omniprésence de Valmont à la manœuvre intrigante met un voile de fumée sur la vérité du livre. Percé à jour par Merteuil en maintes pages, dépeint à suffisance par sa propre logorrhée quand il s’agit de narrer ses triomphes, le Vicomte se dégonfle. Tout en lui est soumis à la dictature de la vanité. Avançant flamberge au vent en brandissant son phallus dont la rigidité le dispense, croit-il, de faire la preuve de qualités moins ostensibles, il épuise la Marquise et nous agace par un désintérêt presque total pour ce qui dépasse le cercle restreint de ses compétences sexuelles et, plutôt que d’admettre qu’il aime enfin, pour la première fois, la Tourvel qu’il divinise – peut-être à tort –, il la sacrifie à sa fatuité de conquérant insensible et s’empêtre dans des complications qui le conduiront à un suicide même pas assumé comme tel au bout de l’épée d’un Chevalier de Malte. Pauvre type ! Une lecture approfondie met toutes les femmes au-dessus de lui, et Cécile la « petite fille » elle-même au-dessus de son Danceny, car elle fait à l’amour partagé (que le Chevalier a compromis entre les bras de Merteuil) le don d’un renoncement au monde et aux plaisirs de sa jeunesse. C’est idiot certes, et la (relative) émancipation des filles, au moins sous nos climats, préserve, on veut le croire, nos contemporaines de ces extrémités. Mais c’est au moins respectable et Laclos l’entend bien ainsi.
Ce livre profond et grave demeure, au vrai, inépuisable. On en développerait aisément – les critiques marxistes l’ont fait – une lecture en forme de lutte des classes. Le mépris du petit officier Laclos pour ce ramassis d’aristocrates qui passent leur trop longs loisirs à jouer aux cartes, à défaut à se jouer des cœurs, ceux des autres et les leurs, on le sent partout, violent, palpable. Mais ne trouverait-on pas ici, dans une autre voie d’exégèse, un antidote singulier au déchirement libératoire des conventions prôné par le Marquis de Sade, exact contemporain de Laclos ? Dans le dossier copieux préparé par l’éditrice sous le titre « La fortune des Liaisons dangereuses », beaucoup de commentaires s’attachent à la noirceur indiscutable du livre, et ne sont pas loin, trop souvent, d’y voir un texte subversif d’abord parce qu’il attenterait sciemment aux bonnes mœurs. Seul André Maurois, bien oublié aujourd’hui mais qui fut un lecteur de qualité, détonne et cite (pages 701 et suivantes) une lettre à Solange Duperré, amie de Laclos depuis la fin de 1782 – année de la première publication des Liaisons –, mère hors mariage (1784) du premier enfant de l’écrivain, et bientôt épouse (1786) pour la vie de l’auteur d’un livre unique et sulfureux : « Il y a près de douze ans, lui écrit-il, que je te dois mon bonheur. Le passé est caution de l’avenir. »
À l’évidence, Laclos n’est pas Valmont, Solange n’est pas Merteuil, ou bien en se trouvant ils ont cessé de l’être. Danceny a-t-il épousé Cécile ? Cela ferait une morale assez jolie, toutes frasques passées, comme il se doit, par profits et pertes.
Maurice Mourier
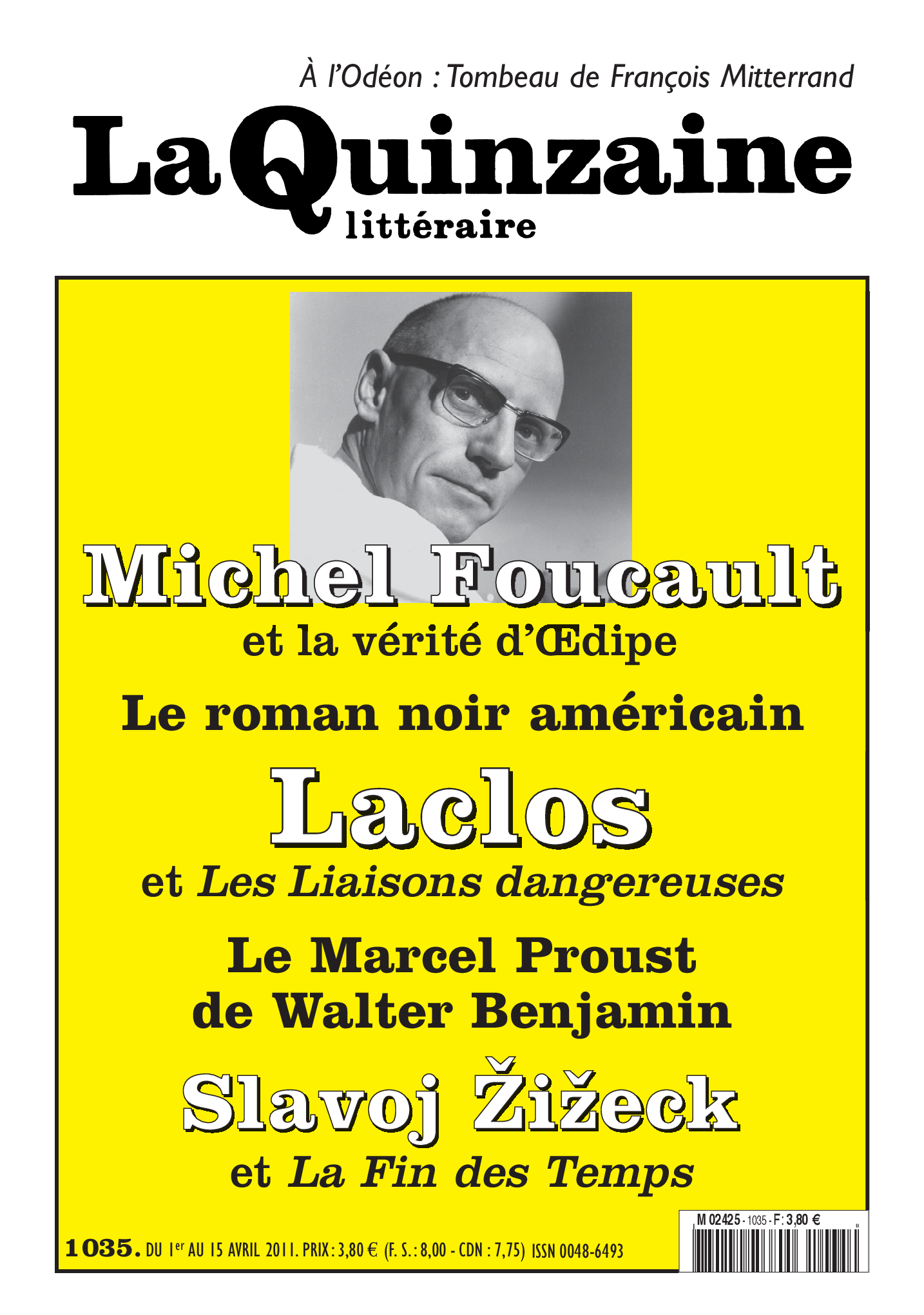

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)