C’est un moment, peut-être un de ces dimanches qui nous mettent dans tous nos états ou plutôt dans le sale état de ne pas pouvoir, et ce moment Gilles Ortlieb le subit dans l’immobilité. Laquelle n’est pas son état naturel. Est-ce parce qu’il a traduit du grec, et par exemple les Six nuits sur l’Acropole de Séféris, ou qu’il a écrit un très beau Noël à Ithaque, on trouve, dans tous ses livres un goût du voyage et surtout du lieu, qui fait sa singularité. Les textes de cet écrivain sont courts et modestes, au sens où il ne cherche pas la lumière, la place au premier rang. Il leur préfère la grisaille de la Lorraine ou de Luxembourg, ville où il a longtemps vécu, la discrétion du Portugal ou de la Grèce, et il n’y a aucune chance, aucun risque plutôt, qu’on le voie plastronner dans des salons.
C’est un homme des trains, un amoureux des gares, quelqu’un qui déambule dans des bourgades en lisière, à l’instar d’André Dhôtel ou d’Henri Thomas, deux de ses maîtres. Vraquier rassemble ce qu’il appelle en sous-titre des « notes et légendes ». Ce livre est le troisième d’une série entamée avec Sous le crible, et poursuivie avec Le Train des jours. C’est donc une « marchandise en vrac » qui est livrée au lecteur, des notes plus ou moins longues, des instantanés, autant d’incitations à la rêverie, à la promenade et à l’écriture.
Lisant Ortlieb, en effet, on a envie, sur ses traces, de traîner dans quelque compartiment désuet, d’écouter les conversations au hasard, de flâner et de glaner. Les noms bien sûr sont des portes qui ouvrent à la rêverie : « La Civanne, Rossignol, Termes, Les Bulles, Jamoigne village, Jamoigne gare ». On irait bien voir, muni du précieux ticket, comme on se prendrait bien à descendre telle rue de Luxembourg pour faire la liste des enseignes, témoignage d’un moment. Dans un sonnet de Jacques Roubaud, « Sunday mein Oberkampf », c’était la mémoire de cette rue du onzième arrondissement de Paris qui apparaissait ainsi, de vitrine en vitrine. Plus loin dans Vraquier, une photo accompagne le souvenir d’une maison disparue, à Luxembourg encore. Liquidation totale, qui avait paru en même temps que Le Tombeau des anges, procédait de même : les photos disaient l’absence, la fin, la disparition. Ce sentiment de vide, on le ressent dans ces pages, un vide synonyme à la fois de mélancolie et d’attente : « Inoccupations premières : demeure ce sentiment dominical, indéracinable, de traverser un envers de décor, d’avoir affaire à des figurants, d’en être réduit à chercher – avec une insistance butée et résignée à la fois – un « répondant » qui se refuse, se cache, se dérobe. »
Un air du temps se donne aussi à entendre : « Le sens de l’hospitalité : Accès interdit, Chien méchant, Pièges, Poisons. Les trois cœurs ajourant en quinconce la porte d’une grange visible derrière la grille (comme on en voyait sur la porte des toilettes de campagne, ou dans les westerns) paraissaient du coup pour le moins incongrus, déplacés. » Et, par contraste, le sentiment d’être « poétiquement davantage chez soi dans le dernier versant du XIXe siècle ».
Ce « poétiquement » qu’il vit au quotidien traverse ces pages, par le jeu des images, par les comparaisons et associations. Le monde prend forme partout, dans le bus 350 qui ramène le voyageur à Paris, et à Corfou où les cyprès ont « forme de menhirs effilés plantés à flanc de coteaux ». Il est dans les reflets sur la Seine, dans une flaque d’eau photographiée, dans le propos relevé de tel roman de Genazino comme dans la parole anonyme d’un vieillard qui voit dans la mort une sieste prolongée, dans ce qu’Ortlieb regarde ou écoute passionnément. On se laisse prendre, on feuillette. En poésie, pour le paraphraser, on prend tout.
Norbert Czarny
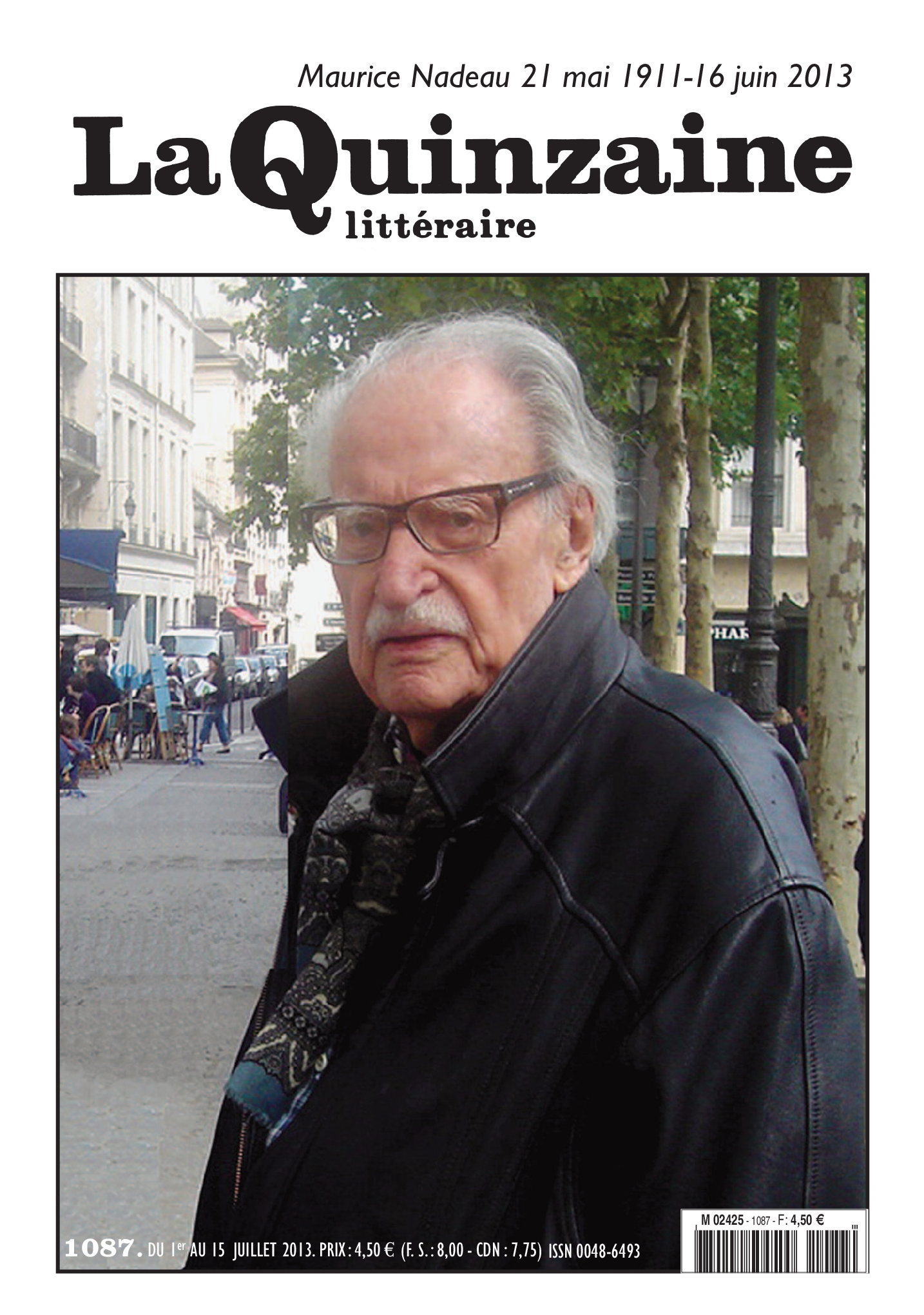

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)