Le même mythe raconte qu’Orphée fut déchiqueté par les jalouses Ménades et que sa tête, roulant dans le fleuve Euros, chantait encore le nom d’Eurydice.
Les voix qui nous hantent sont-elles si fortes qu’elles nous lient à elles ? Quelle nécessité pousse tant de poètes à porter dans leurs poèmes la voix des êtres qu’ils ont aimés ou lus ? Pouvons-nous rendre un peu de vie aux fantômes qui nous peuplent (et nous gardent peut-être) ?
Le titre du livre d’Isabelle Baladine Howald, Hantômes, semble un mot diminué, entaillé vivant. Changeant de consonne initiale, il int...

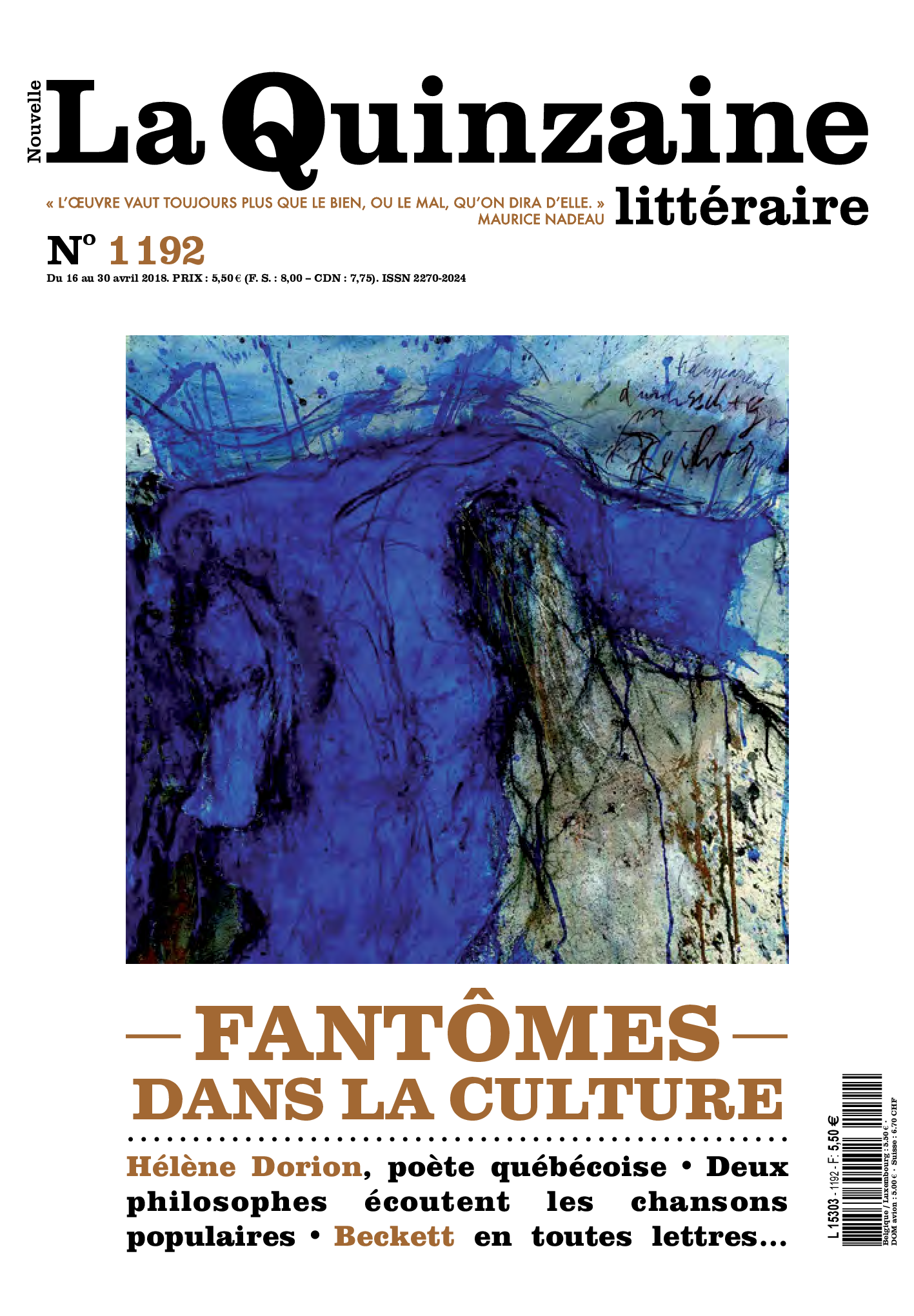

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)