La méthode présidant à l’agencement des trente-quatre pièces du Dépaysement semble de prime abord celle, flottante, d’un écrivain dilettante qui n’aurait pour but, dans ses incursions ponctuelles, souvent brèves, à travers la France, que de suivre son désir ou d’obéir à l’occasion (un hébergement amical ici, une vieille envie de suivre le cours d’une rivière, le souvenir d’un peintre : Courbet, le besoin de vérifier ce que signifient encore, aujourd’hui, les utopies monumentales mises en pratique, de 1775 à 1779, par Claude-Nicolas Ledoux (saline royale de Chaux à Arc-et-Senans), ou celles de Jean-Baptiste André Godin en son Familistère de Guise, dans l’Oise, démarqué et profondément éloigné du Phalanstère de Fourier).
Mais cette lecture privilégiant la fantaisie de l’amateur – ne disons pas du touriste, mot que l’auteur abhorre –, un amateur intelligent et qui a tout lu, qui sait tout du pont du Gard et de l’ingénierie romaine, tout des foires aux bestiaux, des beautés de l’art pariétal affleurant aux Eyzies-de-Tayac, des mystères de la résurgence de la Loue à Ornans, d’un millier d’autres curiosités enfouies dont l’abondance donne véritablement le vertige, cette lecture se révèle très vite inopérante et réductrice.
Jean-Christophe Bailly est tout assurément, sauf un fantaisiste. S’il n’a pas – heureusement ! – trop l’esprit de sérieux, il n’en demeure pas moins que le saut et la gambade, le sourire narquois ou l’explosion de franche rigolade, parfois, qui rendent Montaigne si séduisant, rien de cela n’est son fort. Deux raisons peut-être à ce refus délibéré de la futilité ou, simplement, de la détente. Un tempérament, selon toute apparence : le dossier, bien fait mais un peu dépourvu d’éclat, que le n° 123 (mai 2011) du Matricule des Anges, revue littéraire très recommandable, consacre à l’auteur, trace le portrait d’un homme encore plus savant, en philosophie notamment, que son livre-somme ne le laisse deviner, mais remarquablement réservé et austère, qu’on imagine bien, puisque c’est un grand voyageur, en moine-soldat du temps jadis pénétré du sens de sa mission et prêchant l’Évangile, bien que le Jean-Christophe Bailly actuel soit clairement agnostique et se méfie à juste titre de tous monothéismes rédempteurs.
La seconde raison a des chances d’être plus « sérieuse » que les folâtreries qui précèdent. Le Dépaysement possède une tonalité sombre – non point mélancolique ni surtout nostalgique, puisque ce livre demeure tourné vers l’avenir – parce que l’heure est grave. Ce qui sous-tend l’enquête en vérité fragmentée, en apparence fragmentaire, de Jean-Claude Bailly sur le « cher et vieux pays », c’est l’inquiétude politique. Les constats fondamentaux ont été faits depuis longtemps : les utopies politiques sont mortes et, même si cela est bien triste, les lendemains ne chanteront plus depuis que l’on sait que le rêve majuscule, celui du communisme universel, qui en a fait courir et même galoper plus d’un, nous incidemment, s’est dissous en dictatures à forte criminalité ajoutée.
Quant aux utopies religieuses, dont nous croyions avoir coupé les têtes d’hydre, elles menacent de ressurgir, fondées qu’elles sont, de toute éternité, sur l’ignorance abyssale et le mépris pour la pensée libre. Il s’agit bien sûr, rappelons-le, d’un tsunami boueux de bêtise crasse dont l’Orient compliqué n’a pas le privilège, bien qu’il fasse ici figure de pionnier, mais quand une candidate possible à la présidence des États-Unis croit et proclame que l’homme a cohabité avec les dinosaures, afin de rester dans les bornes de la chronologie biblique, quand on béatifie (quel mot !) un pape dont le principal titre de gloire est d’avoir répandu le sida comme une bonne parole en interdisant le préservatif aux Africains, eh bien ! il est temps de se poser quelques questions non triviales.
Parmi elles, celle-ci : y a-t-il encore de ce côté-ci de l’Occident, pourri comme les autres côtés et jusqu’aux moelles par le capitalisme au groin frémissant, une chose qui ressemblerait à certain modèle du vivre ensemble sans se détester à mort ? Pourquoi diable de ce côté-ci ? Peut-être parce que la France, lentement et laborieusement, avait quand même élaboré et porté un tel modèle né avec la Révolution et complété par cette disposition unique – en ce que les autres démocraties n’en gèrent que de pâles copies –, essentielle à la paix des ménages et des peuples, qu’est la laïcité militante. N’a-t-elle pas essayé de faire de la France, cette laïcité de 1905, ce qu’elle devrait être : un pays de l’Harmonie (selon le vocabulaire de Fourier), toujours menacé par la Civilisation (encore Fourier), qu’il faut traduire aujourd’hui par « libéralisme » (mot scandaleusement détourné de son sens) consumériste et mercantile ?
En somme, quand on est « de gauche » mais sans arrogance comme Jean-Christophe Bailly, effrayé par « le retour du religieux » mais sans virulence à son égard – confessons que, pour notre part cette forme héroïque de tolérance nous est difficile –, peut-on toujours compter sur une « France la douce que mon cœur amer doit » qui ne soit pas le bunker hautement sécurisé, philosophiquement crétinisé et économiquement non viable, du populisme aux dents d’hyène qui entame lui aussi un retour repoussant ?
Contrairement à certaines apparences, qui laisseraient dériver Le Dépaysement vers une enquête sur la spécificité française, par exemple paysagère, ou historique, Jean-Christophe Bailly n’est préoccupé que par la réponse à cette question, même lorsque son texte divague, tel un ruisseau capricieux du Limousin, dont la fraîcheur abrite l’écrevisse et les bords granitiques la vipère – bien qu’aucune de ces deux espèces ne figure nommément ici, l’intérêt pour la présence et le sort des bêtes, domestiques ou sauvages, constitue une des lignes les plus originales de l’essai.
Ce dessein politique primordial, qui finit par se révéler dans le chapitre pénultième consacré à « l’hypothèse du bariol », on le voit en fait s’esquisser dès le début du livre, à l’occasion de la balade faussement nonchalante qui conduit l’auteur du côté de la porte de Gentilly, à Paris, à la recherche du secret de la convivialité portugaise.
Car si l’on ne veut pas de la prison communautaire des coutumes enkystées, qui finit immanquablement par « dresser comme des boucs », ainsi que l’écrivait Michaux dans Ecce homo pendant la guerre, les idées puis les hommes les uns contre les autres, mais si l’on rejette avec la même horreur une « identité nationale » qui pue à plein nez la bouse vichyssoise, alors il faut s’efforcer de retrouver dans des métissages nouveaux le parfum vrai de « pays » que l’auteur hume avec tant de volupté lorsqu’à New York il revoit en sa version originale restaurée La Règle du jeu de Jean Renoir, dont l’entrée des Allemands sur le territoire interrompit en 1940 la carrière.
Or cette France-là, celle de 89, de 48, de la République enfin installée après la Commune massacrée, cette France de 1905, de 1936 et des jardins ouvriers, étonnamment vivante et populaire encore de 1945 à 1968, qu’en reste-t-il aujourd’hui et qu’en est-il de sa capacité à accueillir l’étranger, même de culture très différente, le maghrébin, le Pakistanais, comme furent accueillis, absorbés mais pas complètement dévorés, le Polonais, le Portugais, l’Espagnol, l’Italien ? Le ressort de l’accueil est-il cassé et si oui quelle est la cause de ce désastre ?
À cette grave interrogation, le livre répond sans dogmatisme aucun, et sans dissimuler ce que son hypothèse idyllique du bariol a de hasardeux. Nous avons nous-même la chance de vivre quotidiennement dans un tel environnement mêlé et sans heurt, à Malakoff où l’action de la municipalité – communiste, est-ce un hasard ? – est inlassable dès qu’il est besoin de créer du lien social. Mais comment ne pas être conscient de l’extrême fragilité de cet équilibre ? Il suffirait d’un rien peut-être, d’un incident un peu vif, et qu’adviendrait-il de la camaraderie réelle qui s’établit en ces lieux privilégiés entre les kabyles et tous les autres ?
Surtout, et là est le plus troublant, Jean-Christophe Bailly le souligne avec pertinence, le bariol est un phénomène urbain, exclusivement, tandis que, veuve d’une paysannerie qui constituait, en 1945 encore, une bonne part de son « âme », la France, pas seulement celle de Diderot et de Balzac, mais celle de Péguy, de Marcel Aymé, de Bernanos, n’est plus. Bistrots, écoles, postes disparaissant, jamais, dans les « campagnes » qui paraissent toujours vides, les places de villages vacantes, en dépit ou à cause du vacillement bleu des télés par les rues nettoyées de leurs passants, « le pays dans ses profondeurs » n’a ressemblé plus fréquemment à un désert quand on le parcourt en voiture sur des départementales d’importance moyenne.
France où es-tu, qui es-tu ? Le voyageur vacille devant ce vide, dépaysé, déboussolé, se demandant comment on peut bien fabriquer de la convivialité quand il n’y a plus de convives. Je vous suggérais que ce livre magistral, d’une écriture constamment inventive, belle et forte, n’était pas un livre gai, vous comprenez pourquoi.
Maurice Mourier
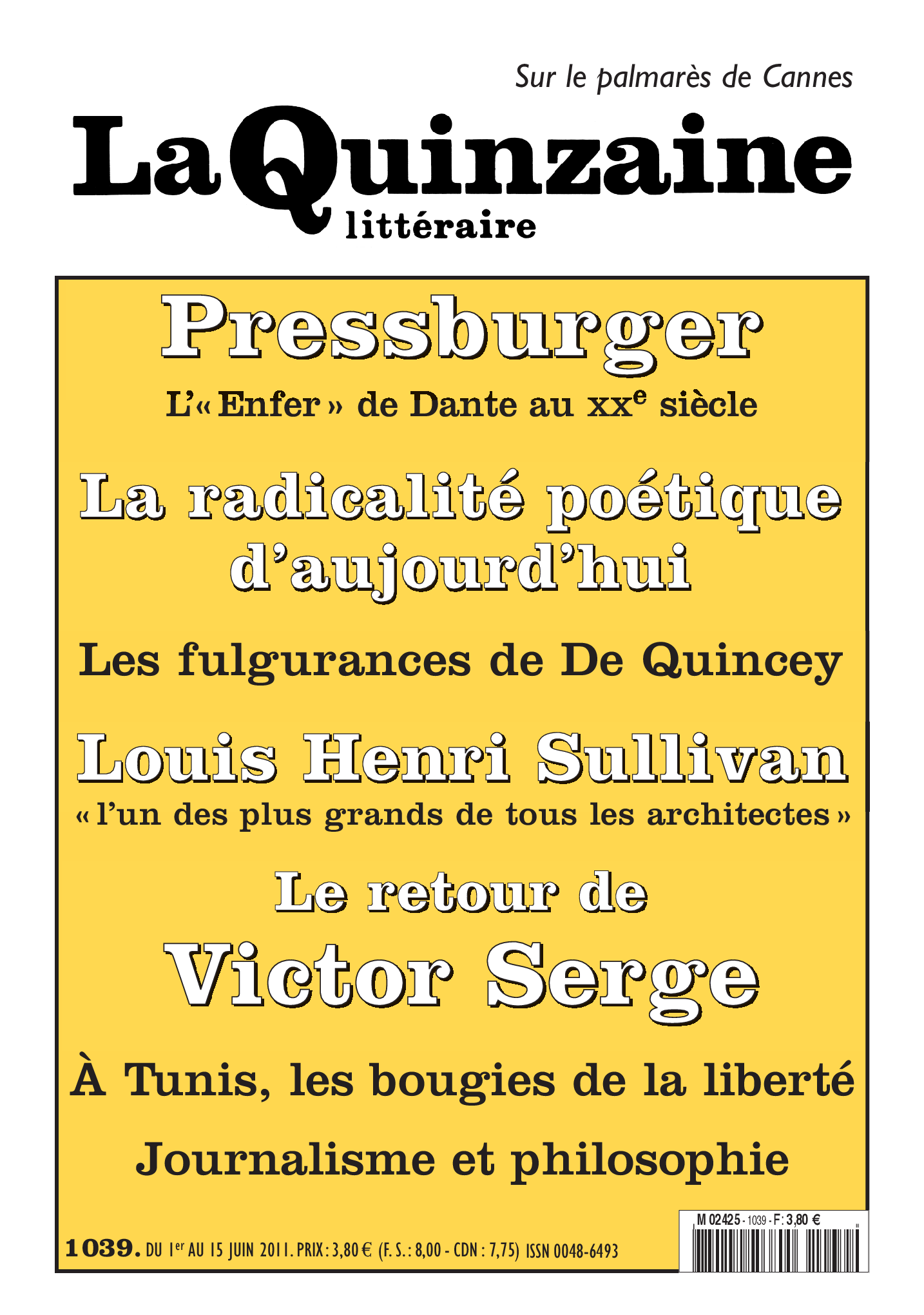

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)