La célèbre paronomase « traduttore, traditore » se trouve employée pour la première fois dans la Défense et illustration de la langue française de Joachim du Bellay, qui écrit, au chapitre VI de son traité publié en 1549 : « Mais que dirai-je d'aucuns, vraiment mieux dignes d'être appelés traditeurs que traducteurs ? vu qu'ils trahissent ceux qu'ils entreprennent exposer, les frustrant de leur gloire, et par même moyen séduisent les lecteurs ignorants, leur montrant le blanc pour le noir ». Notons, par ailleurs, que le mot « traducer », en anglais, désigne un diffamateur, parce qu'il vient du latin « traducere » (déshonorer).
Traduire, c'est trahir ? déshonner ?
Dès lors, le traducteur est-il un diffamateur ? La question peut se poser si l’on se rappelle que certains théoriciens de la traduction à la Renaissance ont été torturés et condamnés à mort par des autorités italiennes et françaises qui considéraient comme « hérétique » leur quête du mot juste. Or, au-delà de l’euphonique « traduttore-traditore », la traduction n’est-elle pas un renversement, une miraculeuse transfiguration des mots que pratique un « traducteur-réécrivain » pour reprendre le terme rapporté par Jean-René Ladmiral (Traduire : Théorèmes pour la traduction, Gallimard, coll. « Tel », 1994, p. 112) ? En outre, dans la conclusion de son ouvrage Les Problèmes théoriques de la traduction, Georges Mounin (1910-1993) relève que « la linguistique contemporaine aboutit à définir la traduction comme une opération, relative dans son succès, variable dans les niveaux de la communication qu’elle atteint » (Gallimard, coll. « Tel », 1963, p. 278) : il ne saurait y avoir de théorie universelle de la traduction en dehors de ses propres conditions de production, c’est-à-dire de publication. Dans quelle mesure le traducteur trahit-il le texte dont il a la responsabilité ? La traduction littérale libère-t-elle des affres de la trahison ? Certains considèrent qu’elle est le degré zéro de la traduction, qu’elle ne témoigne d’aucun talent.
Yves Bonnefoy et Shakespeare
Toutes ces considérations trouvent un écho particulièrement frappant quand il s’agit des traductions de William Shakespeare (1564-1616), dont on commémore cette année les quatre cents ans de la disparition, et dont « chaque mot écrit, précise le comédien Michel Bouquet, a un sens métaphysique et universel ». Le dialogue traductif entre le poète, critique et traducteur Yves Bonnefoy et Shakespeare, dont il a assidûment traduit les pièces, s’avère des plus éclairants sur la question de la traduction/trahison. La traduction est avant tout pour Bonnefoy « un acte de poésie » et, en tant qu’acte poétique, elle ne peut qu’être « un questionnement, et une expérience » qui relèvent de sa recherche poétique. Or, pour Bonnefoy, l’expérience poétique peut être comparée au rêve : la traduction est donc d’abord pour lui une expérience onirique. La traduction en tant que rêve exige ainsi en même temps d’être revécue par le poète-traducteur et de s’enraciner dans son expérience poétique. Le traducteur se doit alors de faire « l’épreuve de l’Étranger », à savoir l’« expérience d’outre-langage » d’une altérité qui est non seulement linguistique et culturelle mais également poétique et existentielle. Le résultat de cette confrontation dialogique est la naissance d’un nouvel original dans lequel on a le droit d’être soi-même et de formuler sa réponse critique au texte de départ.
Ajoutons à cela que Jean-Michel Déprats, qui dirige l’édition française de Shakespeare dans la Pléiade, conçoit la traduction comme une première mise en scène, celle des mots, ayant pour but de présenter aux comédiens un texte déjà maîtrisé. Et cette maîtrise du texte passe par une langue mise en corps, en bouche, en voix. Il est, en effet, déjà arrivé à Jean-Michel Déprats de travailler au magnétophone, comme Flaubert disant ses textes dans son « gueuloir ». Flaubert qui comprenait si bien celui qu’il appelait « le prodigieux bonhomme Shakespeare », parce qu’il savait que l’écriture c’est aussi une affaire d’air dans les poumons. Homme de théâtre en même temps qu’universitaire (il est maître de conférences à l’université Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense), Déprats parvient à faire en sorte que ses traductions soient écrites pour la voix, qu’elles combinent la rigueur et la vigueur. L’essentiel, selon lui, c’est la musique, le mouvement de la phrase. Un texte doit respirer, bouger : c’est un être vivant.
Franck Colotte
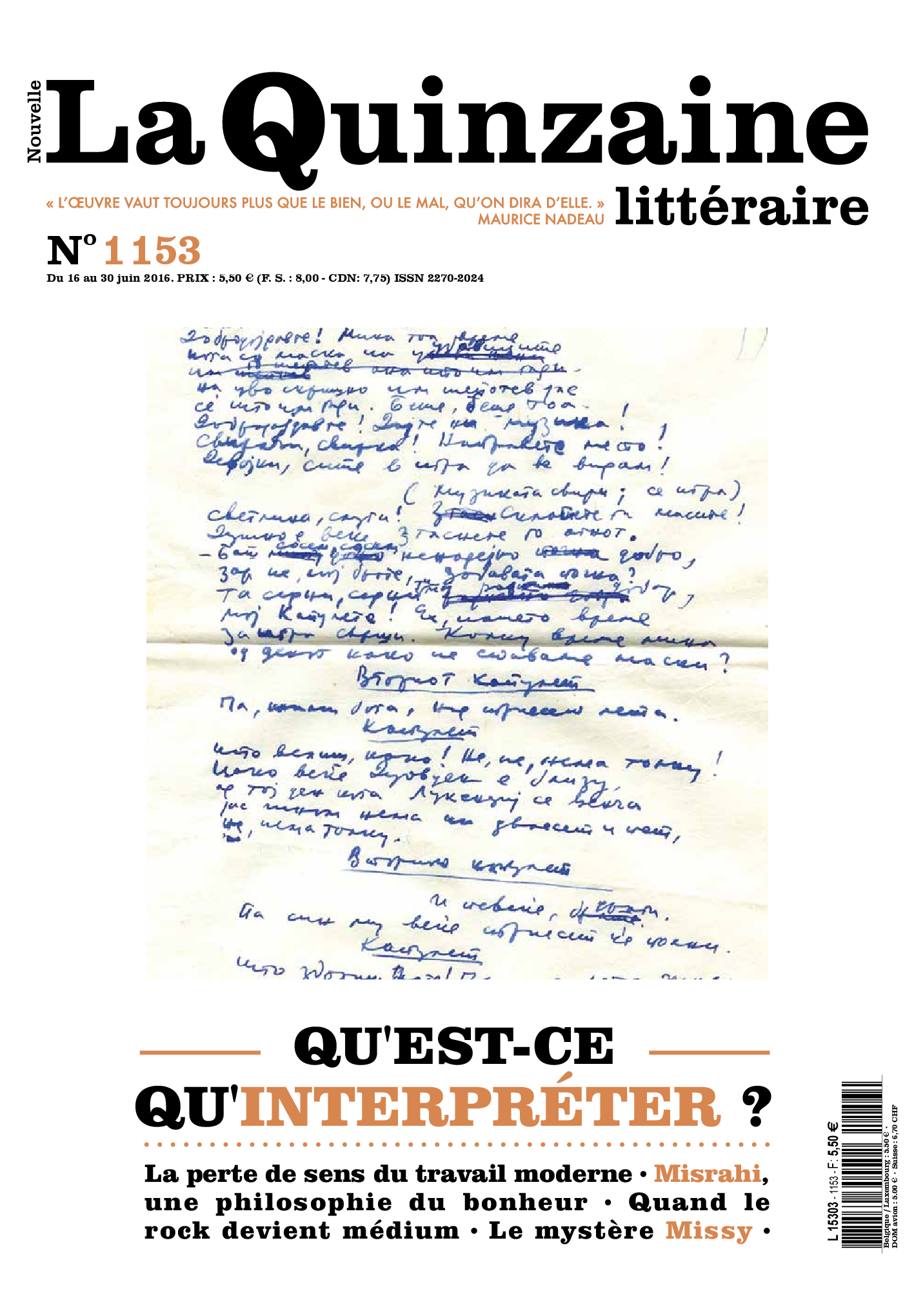

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)