En octobre 1996, l’auteur du Journal d’un manœuvre (Gallimard, 1990) et de Lettres à la bien-aimée (Gallimard, 1995) entre volontairement, pour deux mois, à l’hôpital psychiatrique de Cadillac, près de Bordeaux, avec la volonté de se débarrasser de sa dépendance à l’alcool : « Je dois tuer quelqu’un en moi, même si je ne sais pas trop comment m’y prendre. »
Cette quête, en soi-même, de cet autre à éliminer est accompagnée par la lecture d’un seul livre : Douzième Poésie verticale, de Roberto Juarroz. Si le poème est un « temple vide » ...

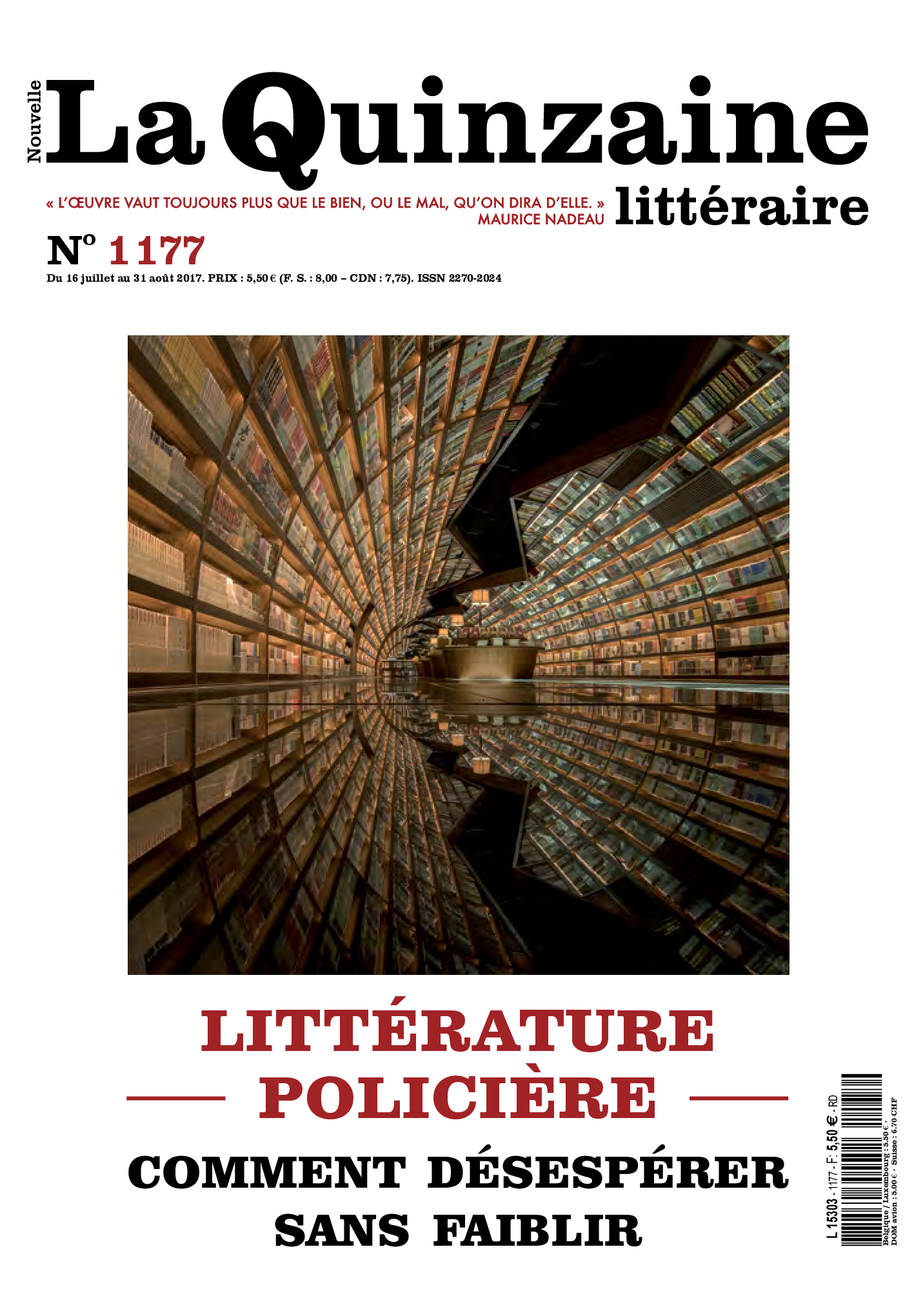

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)