La participation de Mireille Battut, dont le point d’orgue est constitué par son témoignage de mère avec son fils Louis, donne d’emblée un socle relationnel et expérientiel au texte de Patrick Landman. D’abord, parce qu’ils ont travaillé ensemble, ensuite parce qu’elle est fondatrice et présidente de l’association « Ambition école inclusive », enfin parce qu’elle est cette mère d’un enfant autiste, et qu’il en va de l’inclusion des deux ! L’entrée en matière en devient d’autant plus saisissante, dès lors qu’elle nous met en situation – un parent est à l’écoute de son enfant autiste, révélant ses possibilités comme ses limites à l’œuvre – mais fonctionne également comme un rappel de l’objectif latent du livre : qu’il puisse s’adresser à toute personne concernée de près ou de loin par l’attention que l’on porte à l’autre.
Les trois termes qui viennent structurer le pari et le parti pris du livre sont annoncés d’emblée : autisme, inclusion et perspective psychanalytique.
Pourquoi est-il important de reproblématiser aujourd’hui la prise en charge de l’autisme ? Parce que l’autisme constitue un marqueur de l’entrée massive du discours de la science dans le champ de la pédopsychiatrie, de la psychiatrie et du handicap mental, en particulier celui des neurosciences, des sciences cognitives et de la génétique.
L’autisme est une notion qui implique une réflexion nosologique et sémiologique ardue, qui continue d’exposer les failles de l’épistémologie même de la psychiatrie. Elle demande du dimensionnel, plutôt que du catégoriel ou du spectral – de l’inclusion, justement. De fait, la conception de l’autisme a considérablement évolué entre sa description par Léo Kanner, en 1943, et celle réalisée par Hans Asperger du syndrome qui porte son nom, l’année d’après : deux extrémités cliniques du spectre autistique. À présent, et le remarque Patrick Landman, l’autisme a quitté le champ de la psychiatrie pour devenir un handicap qui recouvre des tableaux cliniques très variés, allant de l’autisme dit de Kanner jusqu’à l’autisme de haut niveau.
Pourquoi l’inclusion ? C’est un terme à la mode, reconnaît Patrick Landman, correspondant à une évolution des mentalités. De telle sorte qu’aujourd’hui, l’inclusion dans la société des personnes porteuses d’un handicap psychique ou mental est un projet qui peut représenter, sans le moindre doute, un progrès social, démocratique et éthique. Entré dans les mœurs seulement quelques décennies auparavant, le terme « inclusion » est venu remplacer ce que l’on ambitionnait jusque-là d’une « insertion » ou espérait d’une « adaptation », voire d’une « réhabilitation ». Se fait ainsi jour un signifiant nouveau, appartenant à un nouveau discours, qui met l’accent sur plusieurs points qui étaient invisibles précédemment, lorsqu’on parlait d’insertion. Notamment parce qu’il renverse la charge des responsabilités : les personnes susceptibles de comporter un handicap devaient autrefois s’insérer dans la société, c’est aujourd’hui à la société de rendre possible leur inclusion. De même, si les déficiences ou les particularités appartiennent aux personnes handicapées, il est maintenant acquis que le handicap lui-même est lié « aux obstacles que la société oppose » à ces personnes. Qui plus est, l’inclusion de tous épouse la tendance structurelle des démocraties à garantir l’égalité des conditions et des droits.
Pour Landman et Battut, la question majeure de l’inclusion du handicap des enfants autistes est leur insertion dans le milieu scolaire. Patrick Landman questionne les différentes évolutions législatives concernant l’autisme et insiste sur le statut juridique qui s’est trouvé modifié, « éloigné de la conception médicale et clairement orientée vers une conception sociale » : ainsi, la Convention internationale de 2006 souligne « l’égalité des droits dans tous les domaines ». Pour en venir, enfin, à évoquer les propositions de l’association « Ambition école inclusive ».
Dans cette équation, l’enjeu d’une approche psychanalytique est crucial : d’une part, réhabiliter ce que la psychanalyse avait perdu de sa légitimité dans le champ de l’autisme en émettant, dans un premier temps, des hypothèses étiologiques erronées ; offrir, d’autre part, avec l’apport d’un Lacan, une vue critique sur l’avancée du discours de la science et ses possibles dérives scientistes, ainsi que sur ses conséquences en termes de ségrégation. S’il considère que la psychanalyse est en mesure de proposer des alternatives opératoires et pertinentes qui contrebalancent la pensée unique cognitiviste et comportementale dominant actuellement les politiques et les pratiques d’inclusion des enfants autistes, il attache également une grande importance aux écrits des autistes qui nous aident, par ce savoir propre, à « entrer dans la différence du sujet autistique ».
La notion d’inclusion est liée à un autre concept, celui de « neurodiversité », introduit par la sociologue australienne Judy Singer. Nous traversons, en effet, une époque à la fois scientifique et culturelle, qui met le cerveau au premier plan des préoccupations scientifiques, anthropologiques et étiologiques. Les études, en particulier celles de l’imagerie cérébrale, nourrissent l’espoir de trouver enfin les marqueurs biologiques des principales pathologies mentales, la schizophrénie, les troubles bipolaires ou la dépression. Le cerveau seul livrerait le secret du fonctionnement humain, c’est l’hypothèse naturaliste forte partagée aujourd’hui – inégalement, il est vrai – par de nombreux chercheurs. Dans ce contexte, la psychiatrie est devenue quasiment indistinguable de la neurologie, tendant à être abordée comme une médecine d’organe, une médecine du cerveau ; sa dimension anthropologique s’en trouve effacée.
Jusqu’aux années 1980 du siècle dernier, les études portant sur le langage jouaient un rôle prépondérant dans les sciences humaines, et tout particulièrement dans la psychanalyse. Cette prépondérance de la linguistique et de la psychanalyse a diminué progressivement pour laisser la place aux neurosciences, donc aux recherches sur le cerveau.
La neurodiversité a comme effet de rendre inopérante une certaine conception du diagnostic médical, qui détermine en général un trouble considéré comme sortant des variations de la normale. Réfractaire à la norme comme critère décisif, la neurodiversité est ainsi porteuse d’un fort courant de démédicalisation, déjà à l’œuvre dans la conception sociale du handicap. Sa radicalité exige une égalité clinique, donc une disparition des repères cliniques, un peu dans la postérité des antipsychiatries du siècle dernier.
Se passer d’une clinique enfermante, discriminatoire – bien sûr ! Mais pas d’une clinique du sujet et de la prise en compte de sa souffrance. C’est là que réside le pari ambitieux de Patrick Landman, au risque de diviser : dans cette tentative de conjuguer « inclusion », avec l’économie qui lui est propre, et « subjectivation » des autistes – de telle sorte que, selon la formule de Tristan Garcia-Fons, « c’est de l’inclusion d’un sujet autiste » qu’il s’agit.
Suivant Landman, la subjectivation et l’intersubjectivité intéressent l’inclusion des enfants autistes, et d’abord négativement ; preuve en est l’identification de l’autisme comme un échec parfois complet ou comme l’échec le plus grave du processus de subjectivation et de l’échange intersubjectif – l’intersubjectivité n’étant autre que la faculté d’interagir en tant que sujet avec d’autres êtres parlants que l’on reconnaît eux-mêmes comme sujets.
Opérant la différence entre l’individu et le sujet, pour ensuite insister sur la spécificité du sujet lacanien structuré par l’aliénation et la séparation, le psychiatre et psychanalyste finit par affirmer l’importance de la trajectoire pulsionnelle : les trois temps de la pulsion et la grille PREAUT. Une place de choix est donnée à la méthode dite des « 3i » – intensif, individuel, interactif – fondée sur le jeu et l’échange, et à l’utilisation du miroir. De l’imitation à l’identification imaginaire, que présuppose le stade du miroir, se rejouent implicitement la position du clinicien, celle des parents et celle des différents acteurs participant à la dynamique du dispositif de subjectivation, qui est d’emblée intersubjectif.
C’est ce processus de métaphorisation qui amène Patrick Landman à affirmer, dans l’ultime page du livre, que « l’inclusion vise au-delà d’un nouveau vivre ensemble, une modification du rapport entre la responsabilité du sujet et celle du collectif ». Phrase qui trouve son complément dans celle affirmant le positionnement inclusif de la psychanalyse : « ne pas désirer que l’enfant autiste devienne mon semblable dans tous les domaines, mais plutôt un prochain qui reste différent ».


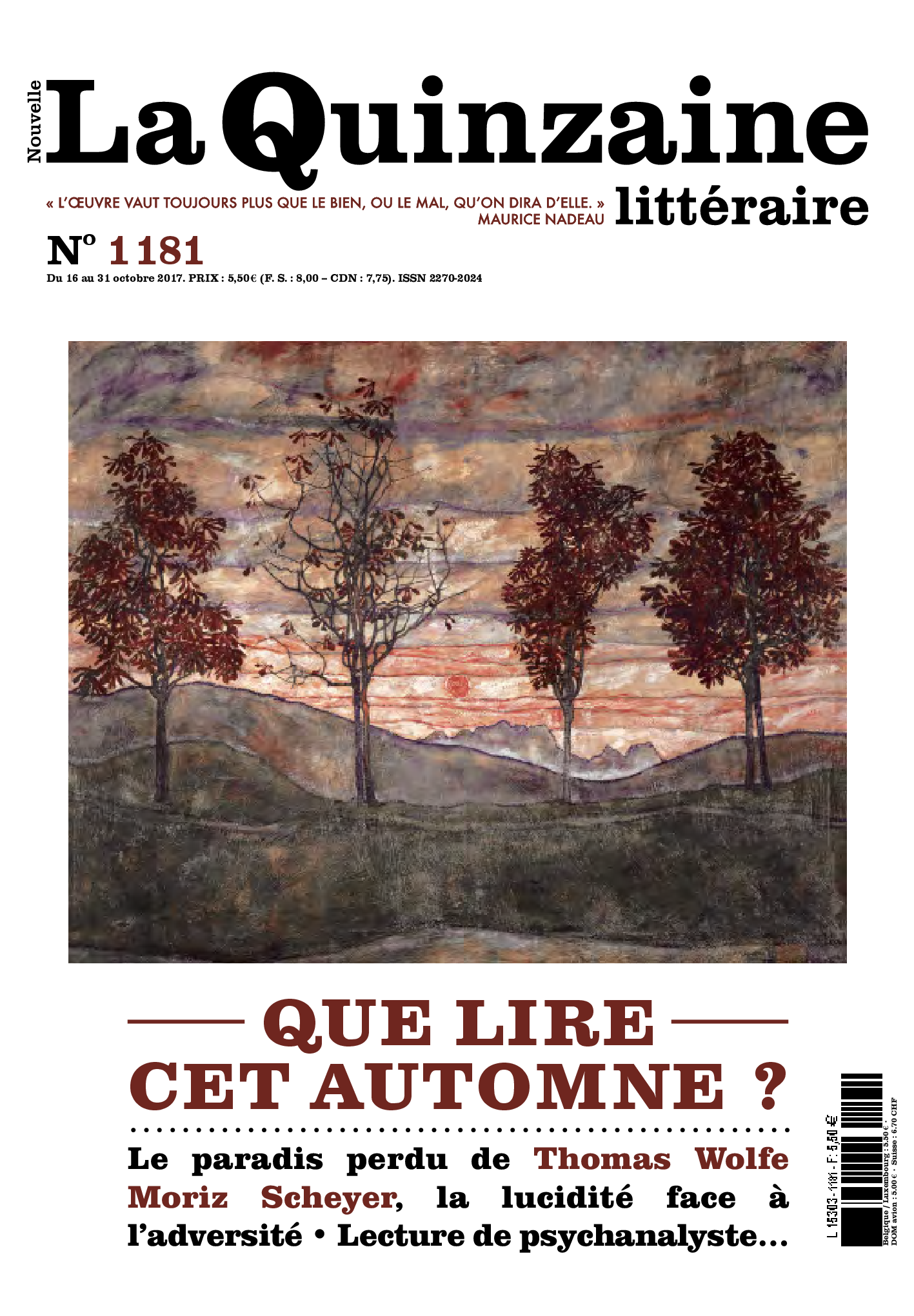
Commentaires (identifiez-vous pour commenter)