Les souvenirs d’enfance lient le réalisateur brésilien Marcelo Gomes à la contrée où son père, qui y fut inspecteur des impôts, l’emmenait parfois avec lui. Il y revient à présent avec une équipe de tournage pour filmer le village de Toritama. Que reste-t-il du village de ses souvenirs ? Il se fait narrateur pour témoigner du changement inouï qui s’y est produit quand l’industrie textile spécialisée en jeans a poussé les paysans à abandonner l’élevage du bétail et la culture des terres pour gagner plus d’argent par le travail sur la chaîne de production. À l’ombre des grandes usines, un autre mode de production intéresse (cependant) le réalisateur. Soit après une fermeture d’usine, soit de leur propre chef, de nombreuses personnes ont fondé (de manière indépendante) leurs propres entreprises textiles, transformant leurs domiciles en manufactures. D’innombrables maisons de Toritama sont alors devenues des « factions » où leurs habitants travaillent sous leur propre enseigne. C’est beaucoup mieux, être « son propre maître », ne devoir répondre à personne, travailler autant et de la façon qu'on l’entend, disent-ils à la caméra.
C’est toutefois le travail de 6 heures à 22 heures qui semble, selon plusieurs témoignages, être la norme. Difficile, donc, de rencontrer les villageois autrement que dans leurs ateliers. Même pendant les interviews, ils ne cessent de travailler et les sons des machines à coudre accompagnent une bonne part des paroles prononcées dans le film. Ici, tout se passe sur un fond bleu, et même les rebelles sont de bons travailleurs : « ils n’ont pas l’air comme ça, mais ce sont des professionnels », dit le manageur d’une « faction » où la caméra s’attarde sur un groupe de jeunes qui ont l’air de passer une après-midi agréable. Dans une autre « faction », des garçons travaillent en écoutant du rap. L’un d’eux, visiblement doué pour bien se saisir du rythme, esquisse quelques figures de danse. Quand il s’arrête pour regarder son portable, la caméra détaille sa casquette de style « gangsta » et jeunesse révoltée. Il y est écrit en grandes lettres : « HARD WORK ».
Ces signes contradictoires, le réalisateur semble consciemment les solliciter, raison pour laquelle sans doute il s’est concentré sur les « factions » plutôt que sur les grandes usines. Le mérite du film est de construire ce paysage humain avec ses habitants, à partir de leurs dires et de leurs gestes, sans s’efforcer de reconstruire leur réalité selon un schéma interprétatif qui ne manque pas de surgir de lui-même, de se confirmer, à savoir que le village est dévasté par le capitalisme (« ce capitalisme dont tout le monde parle », relève un des personnages), si bien asservi au libre marché que rien n’y subsiste qui n’obéisse à sa logique maximaliste.
Pourtant, on ne peut éluder l’autre partie de la réalité, que la caméra nous fait voir, celle des regards visiblement fiers des gens de cette communauté, qui vit là et affirme s’épanouir dans ce qui ressemble à un horrible esclavage. Ainsi, même si la dualité des interviews et des plans-séquences sur les machines et sur les « circuits » qu’elles forment avec les travailleurs, produit une tension, cette tension ne va jamais jusqu’à démentir directement les paroles des personnages. Sans crier à l’aliénation, le narrateur ne cache toutefois pas son point de vue. Au cours d’un long plan fixe sur des mains cousant des poches à la machine, l’une après l’autre, une centaine, dont on apprend à un autre moment du film qu’elle rapporte à la travailleuse deux dollars cinquante centimes, dans un bruit assourdissant, il coupe le son et explique qu’il n’en peut plus de ce vacarme, qui l’angoisse. Maintenant, c’est le mouvement répétitif qui ne laisse d’augmenter le sentiment oppressant et il n’est pas besoin de dire que ces mains font comme partie de la machine, avec elles tout le corps jusqu’à la personne et celle-ci jusque dans son sommeil, dans ses rêves et dans sa tombe. Alors le narrateur remet la musique qui accompagnait notre approche du village au début du film, le « largo » du Concerto pour piano en fa mineur de Bach.
Qu’en est-il du carnaval que le titre nous avait promis ? Il surgit à la fin du film, précipitant un finale prodigieusement ambigu et non dépourvu d’un certain tragique. Quand le carnaval approche, la logique d’accumulation folle semble tout à coup suspendue, tout le monde étant prêt à revendre à perte ses appareils électroniques les plus précieux afin de pouvoir aller huit jours à la plage (la vente des biens au « marché du carnaval » est l’épisode qui achève de dire le mot magique, qu’aucun personnage ni le narrateur ne prononcent : pauvreté). Une transgression faite à la discipline capitaliste frugale qui afflige les villageois toute l’année durant ? On aimerait le croire. Mais la dépense exorbitante facilite le retour au rythme effréné de travail ; car au retour de la plage, n’y a-t-il pas urgence à racheter le réfrigérateur, le téléviseur, le portable que l’on vient de vendre ? Un signe donc, assez faible, si signe il y a, que la vie tout entière n’est pas encore conditionnée au flux d’argent. L’insistance remarquable avec laquelle le documentariste demande aux gens à quoi ils rêvent semble poser en sous-texte la question : à quoi faut-il rêver pour « vouloir » travailler chaque jour de 6 heures à 22 heures ? Pour toute réponse : un plan fixe sur une pluie de jeans.
Adam Pašek
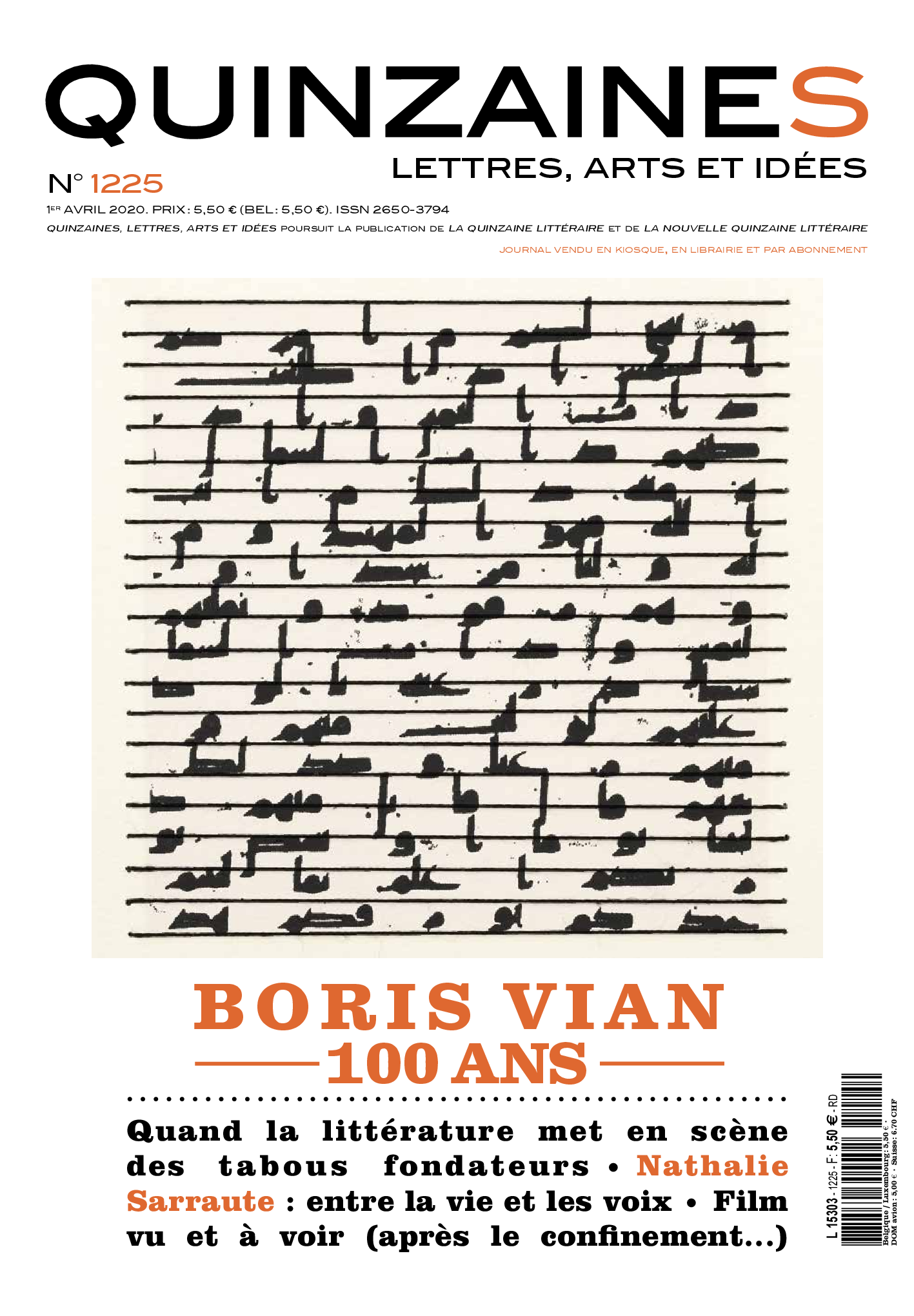

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)