Chez Yves di Manno, avant même les photos qui accompagnent le texte, la ponctuation joue sa partie, en s’interposant à l’intérieur du titre à une place inusitée : entre l’article et le substantif. La virgule interrompt une action. La traversée aura-t-elle lieu ? C’est une première lecture. La seconde pourrait être : une (femme) est traversée. Autant dire que chez lui la ponctuation raconte, contribue au récit sous-jacent. Le deux-points semble ouvrir un vers (au lieu de l’achever et d’annoncer une suite, explicative) comme on ouvre une porte :
« son torse
enroulé dans
la bâche oscille
du chambranle
à l’angle du
sommier
: danse immobile
: stance bougée »
Surtout, dans Une, traversée, la poésie fait corps avec l’image, celle de photographies dont l’auteur, Anne Calas, est aussi le sujet.
Se regarder soi-même par le moyen de l’objectif, par conséquent s’objectiver, pour se donner à voir à l’autre, tel semble être le projet d’Anne Calas. Manière de se parler et d’échanger de soi à soi comme on tient son journal, et de faire part, de partager, de chercher le regard et la parole de l’autre.
Une gageure, puisqu’il s’agit de se présenter nue, d’abord à l’interlocuteur et ensuite au lecteur.
Les photos sont tremblées (mais est-ce bien le mot juste, « troublées » ne conviendrait-il pas mieux ?), le visage et le corps pas tout à fait identifiables.
Le texte avance en équilibre sur cette crête,
« : signe tremblant, furtif
d’une femme inscrivant
une impensable geste »
sur ce dévoilement (ou ce dévoiement ?) d’un corps, d’une relation qui, dans un premier temps, peut sembler impudique. Le lecteur est charmé, attiré (et frustré ?), car en dépit des apparences, qui elles aussi sont traversées, ce qui est proposé demeure en marge, comme en lisière :
« d’une page
que nul d’ici
là ne lira »
C’est un récit, un chant, où les signes, les traits, sont immobilisés afin d’être scrutés. C’est intime, retenu, et presque détaché, le flou de la photo est semblable à l’aura et les mots du poème à un vêtement fluide qui propose et habille.
Anne Malaprade, dont c’est ici le premier livre, écrit de courtes proses qui ressemblent à des lettres ; elles assemblent des mots qui sont au-dessous ou à côté des poètes qu’elle admire mais qu’elle ne nomme pas, qu’elle désire, semble-t-il, protéger, comme on protège ses enfants, comme on dresse des remparts contre l’effondrement.
Elle prend prétexte d’autres textes pour qu’existe le sien, mais avec modestie et sans prétendre à rien qu’à se glisser entre leurs fentes, à l’intérieur des blancs, à s’allonger le long des mots et à louer, à louanger « le flash qui désaveugle » et « les entorses de toute béance ».
Elle écrit au poète, qu’elle imagine à son bureau, sans vraiment lui écrire, plutôt en le rêvant, d’un voyage, d’une chambre d’hôtel : « J’ai tellement aimé les écrivains que vous écrivez qu’il me semble pouvoir tout abandonner. »
Il y a beaucoup de sensualité dans ces pages : lire, écrire, est un acte amoureux : « Vous dont la langue caresse les pages et les femmes », « Je consacre l’encre de vos déliés, le papier choisi pour enveloppe : on y dort, on y fait l’amour, on y compose des enfants, on y jouit jusqu’à la perte. »
Et il y a aussi de la témérité, une passion lucide et un engagement sans remords, sans retour, dans ce qui est peut-être « un don de Dieu ».
Doina Ioanid s’étonne et nous étonne au moyen d’un langage familier. Ce qu’elle exprime, ce qu’elle raconte, paraît indubitable, pourtant ses textes en prose brève proviennent d’un monde à elle, d’une vision à elle, unique et décalée.
« Dans la chambre à coucher où les murs se sont imprégnés de l’odeur de nos corps, tu recueilles soigneusement les araignées dans le creux de ta main et me les apportes. Pour me faire des amies, as-tu dit. Ce sont des araignées domestiques, laborieuses et gracieuses comme toi. Vas-y, c’est bien de commencer par les petites bêtes. »
De Doina Ioanid, Roumaine traduite par un Belge, on aime l’humour, la cruauté, une absence d’indulgence vis-à-vis d’elle-même qui inspire en retour l’amitié, et beaucoup de tendresse. Ses poèmes en prose finissent par donner, mis bout à bout, page après page, l’impression d’un roman dont il manque les raccords, mais on s’en passe allègrement. On y trouve l’amoureux (qui est miraculeux), le grand-père bien-aimé, les voisins, les passants, les magasins en ville. On y trouve le passé et l’avenir sans illusion. Et enfin le présent dont on ne sait que faire quand le cœur n’y est plus.
« Hiver brumeux dans lequel les gens passent sans bruit, traînés par d’énormes roues de feu. Les merles sautillent dans la neige recouverte de mégots, un jour je serai aussi insoucieuse qu’eux. C’est peut-être la seule annonciation. »
Chez elle, la chute est importante. Elle conclut sans conclure, tire un trait. « La violence fait partie de ma vie. Le tout c’est de me le rappeler. » Nous courons après elle, désireux de savoir, de connaître la suite et, impatients, sautons les blancs, les parenthèses et les silences, rassurés chaque fois d’apercevoir sa silhouette, loin devant, qui se moque, qui joue, malgré sa peur, à la parade.
Marie Etienne
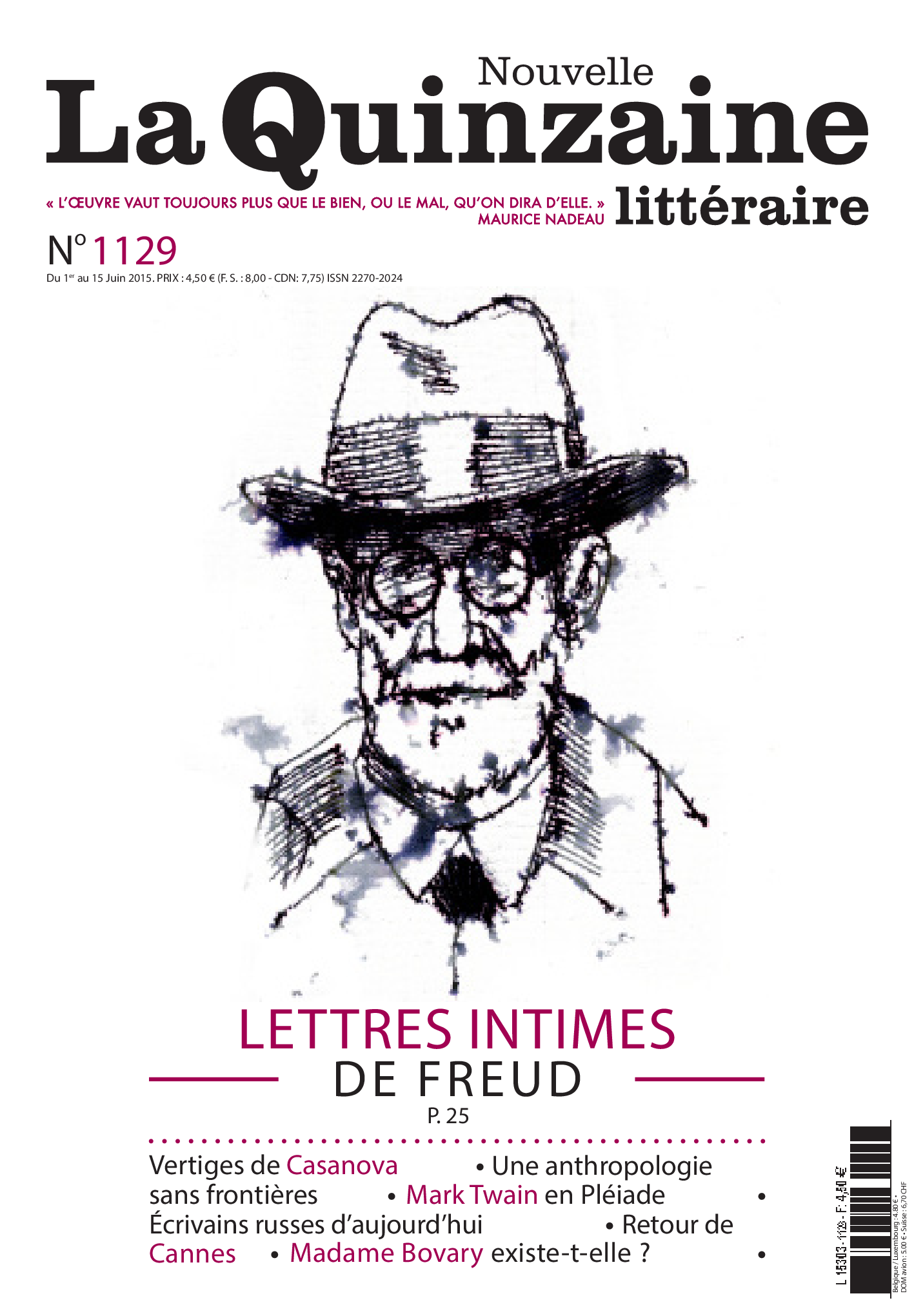

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)