Car rien n’est plus pénible à supporter, comme nous l’écrivions il y a peu à propos d’Hitchcock, que l’iconolâtrie, ce besoin de communion devant une statue, quelle qu’elle soit – et surtout quand elle a été fondue, de son vivant, par l’intéressé. Le génie, quoi qu’on en dise, est la chose du monde la moins partagée, particulièrement au cinéma, et lorsque l’on nous aura démontré quelles formes précises il prend chez un cinéaste, nous nous tiendrons prêt à battre notre coulpe et à processionner vers son effigie. En attendant, nous nous contenterons de revoir les films, hors de toute injonction à l’admiration aveuglée.
Non que Kubrick ne soit un réalisateur considérable, qui a souvent atteint des sommets (le finale de Dr. Strangelove, le début de 2001, une bonne partie d’Orange mécanique, presque tout Shining). Ce qui nous gêne, c’est la construction de son autoportrait en démiurge, cette posture de génie retiré du monde, fignolant dans la solitude la plus paranoïaque des films cent fois remis sur le métier et labellisés chefs-d’œuvre historiques avant même que d’être vus. L’attitude, celle de l’artiste replié dans sa tour et dispensant au monde une parole rendue essentielle par sa rareté, n’a rien de condamnable, si elle se traduit positivement – mais douze années de gestation dans un bruissant secret pour accoucher d’Eyes Wide Shut… Et cette manière de purger sa filmographie des éléments qui ne contribueraient pas à l’établisement de la légende, tel Saint-John Perse écrivant de fausses correspondances pour l’édition de sa « Pléiade », ou Aragon récusant Le Con d’Irène (tout en interdisant sa réédition), est peu pardonnable. Un auteur, une fois son œuvre publiée, n’en est plus responsable : celle-ci appartient au public, sans recours. Fear and Desire, son premier film, jugé indigne de figurer dans son œuvre complète, est ainsi passé à la trappe (malgré le qualificatif « intégrale », la rétrospective fait l’impasse sur ce titre). Surtout pas d’accroc dans le mythe…
Et lire, dans la présentation de la Cinémathèque, des lignes telles que « chacun de ses films semble avoir constitué le moment ultime, indépassable, d’un genre dont il aurait désormais clos l’évolution », est renversant, même si le signataire est connu pour n’être pas avare d’approximations définitives. Ainsi, le cinéma, comme le monde selon Fukuyama, a connu, avec Kubrick, la fin de son Histoire : le polar, le péplum, le film de science-fiction, le thriller, le film de guerre, sont morts après L’Ultime Razzia, Spartacus, 2001, Shining, Full Metal Jacket et tout ce qui a été fait depuis n’est qu’agitation posthume de genres qui vivent dans l’illusion qu’ils bougent encore.
À défaut de Fear and Desire, la rétrospective nous offre la découverte de trois courts métrages de jeunesse, réalisés par Kubrick entre 23 et 25 ans. Et au moins allons-nous pouvoir juger de nouveau sur pièces des films vus et, malgré ce que l’on vient d’écrire, revus – comme tous ceux qui nous démangent et dont on vérifie régulièrement si le prurit qu’ils déclenchent est toujours d’actualité. Pour les connaître, à force de visions, dans le détail, on est certain que Le Baiser du tueur et L’Ultime Razzia, plus anciens titres autorisés, ont conservé toute leur fraîcheur – le premier, surtout, qui, en 67 minutes, propose une admirable anthologie du film noir (aurait-il raccroché la caméra ensuite que Kubrick demeurerait inoubliable). Il n’y a aucune raison pour que Docteur Folamour ait perdu son caractère de terrible farce grandiose et que le collage de l’explosion atomique finale et de la chanson de Vera Lynn We’ll Meet Again ne compose plus un assemblage percutant. Aucune raison non plus pour que 2001 ne soit plus ce pensum métaphysique, science-fiction lourdement pensante, à décourager les amateurs du genre (c’est à John Brunner, Robert Heinlein ou Philip K. Dick qu’il fallait faire appel, pas au pompeux sir Arthur C. Clarke). Quant à Sue Lyon, malgré la patine du temps, les presque cinquante années écoulées depuis son apparition ne sont sans doute pas suffisantes pour qu’elle parvienne à nous faire croire qu’elle était une Lolita à la hauteur du rêve des lecteurs de Nabokov. Mais pour retrouver l’ambiguïté dérangeante d’Orange mécanique – comment se situer devant cette violence spectaculaire, entre dénonciation (douteuse) et voyeurisme (assumé) –, il faudra attendre quelques mois, le film étant en restauration et pour l’instant réservé à sa présentation à Cannes.
L’exposition, montée en 2004 par le Filmmuseum de Frankfort, a voyagé à travers la planète avant de s’installer ici. Elle est remarquable, ce qui n’a pas toujours été le cas à Bercy depuis l’exposition Renoir d’ouverture. Remarquable, car conçue avec la veuve du cinéaste, à partir des archives par lui constituées ; et comme il semble avoir absolument tout conservé, tant du côté personnel, enveloppes, brouillons, manuscrits, bouts de papier, que professionnel, plans de travail, maquettes, objets (le fauteuil roulant pour tourner sans fin dans les couloirs de l’hôtel de Shining), costumes, caméras (tous les objectifs employés sur ses appareils), photographies (superbe échantillonnage de son activité entre 1945 et 1950), nous sommes là devant un étalage d’une richesse sans égale. Sagement chronologique, l’exposition nous permet de suivre l’itinéraire de Kubrick, depuis Day of the Fight, premier court métrage de 1951, jusque Eyes Wide Shut, sorti trois mois après sa mort en 1999 : si la combinaison de spationaute de 2001, guère plus extraordinaire qu’une autre, n’éveille que peu de souvenirs, la bombe que chevauche Slim Pickens dans Docteur Folamour est là, comme la toge de Charles Laughton dans Spartacus, la tenue avec slip renforcé du droug Alex d’Orange mécanique, la robe de Marisa Berenson dans Barry Lyndon, la hache et le couteau de Jack Nicholson dans Shining – et surtout les croquis et maquettes construites par Ken Adam, décorateur inspiré, dont l’immense QG de Dr. Strangelove reste le chef-d’œuvre. Une scénographie sans chichis, avec un cheminement clair (aucun souci de devoir revenir sur ses pas) permet de goûter pleinement chaque recoin, recélant vitrine discrète ou mini-salle de projection, du labyrinthe. Une exposition qui ne se réduit pas à l’intérêt de ses accrochages, mais dont on parcourt l’espace avec plaisir, le fait est assez notable pour être relevé (1).
Puisque Kubrick gardait tout, on comprend qu’il ait également gardé tout le matériel préparatoire de ses films restés en projet. Le produit de ses cinq années de travail (1968-1973) sur Napoléon doit occuper plusieurs mètres cubes : on n’en voit ici que quelques épaves, une bibliothèque de plusieurs centaines d’ouvrages, quelques milliers de fiches sur tous ceux qui ont croisé l’Empereur, un plan de tournage d’une minutie effarante, qui découpe la vie de son héros en soixante-douze carrés de cinq minutes de film chacun, etc. Idem pour Aryan Papers, prêt à être tourné, mais annulé lorsque Spielberg a lancé La Liste de Schindler. L’ossuaire des films rêvés est aussi significatif que le panthéon des films réalisés – avec l’avantage de ne pas avoir affronté l’épreuve du réel et d’avoir conservé toutes leurs vertus imaginaires.
Comme prévu, la cavalerie éditoriale déferle : outre un coffret « prestigieux » de 19 DVD, une dizaine d’ouvrages accompagnent l’événement – pour 300 euros, les amateurs pourront ajouter tout un rayon à leur bibliothèque kubrickienne. On peut recommander, parmi ceux que l’on connaît, le Kubrick, de Michel Ciment (édition augmentée), et Une vie en instantanés, de Christiane Kubrick, lecture éclairante (le premier), documents étonnants (le second), l’un et l’autre essentiels pour une approche du cinéaste. Et revoir, avec un œil dégagé, les films du maître, en attendant juin et la rétrospective Ritwik Ghatak (enfin !) que la Cinémathèque nous annonce.
- À noter également, sur le chapitre de l’intérêt de la scénographie, l’exposition actuelle du musée d’Orsay sur la photographie préraphaélite anglaise.

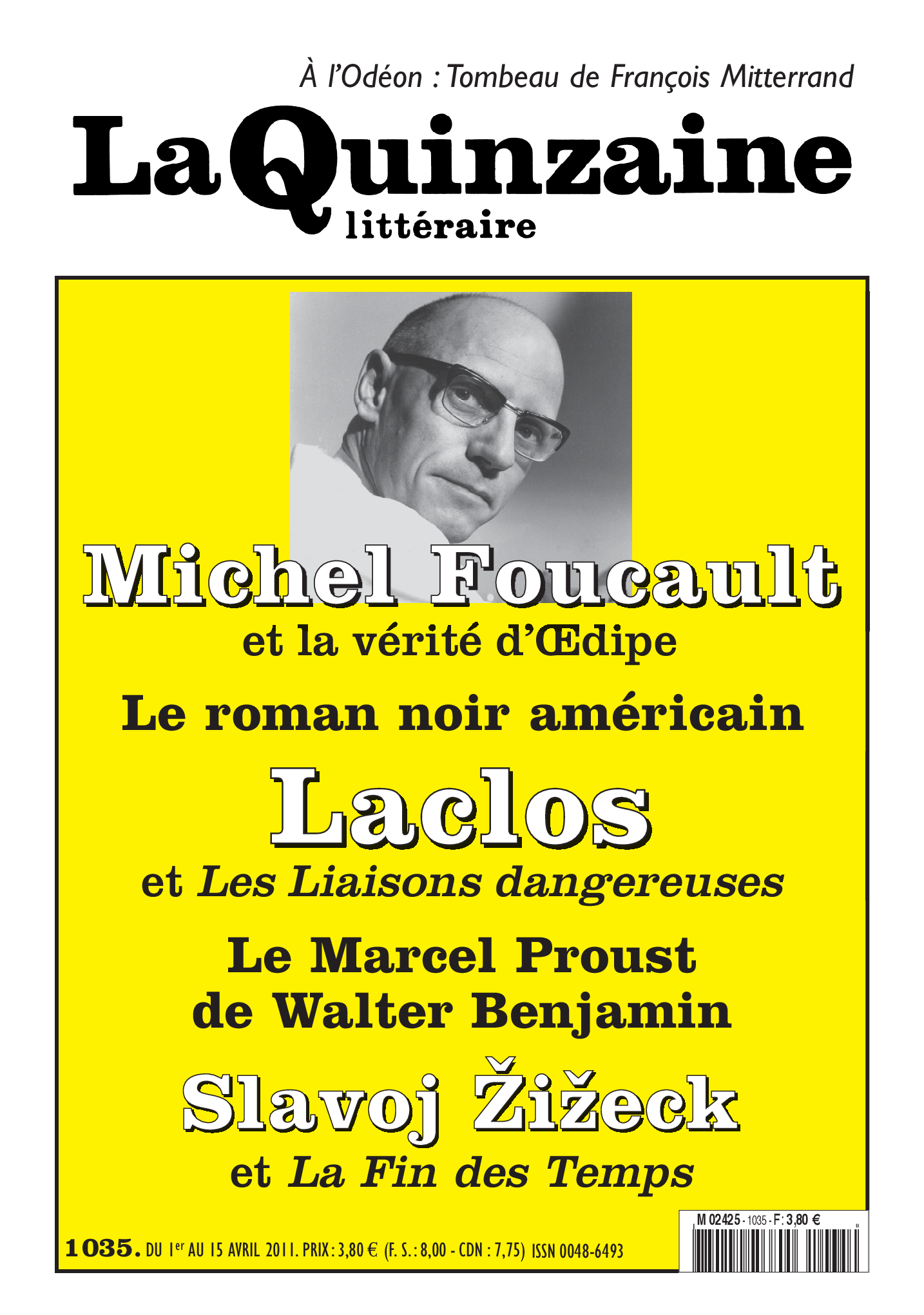

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)