Le dialogue avec Jean-Baptiste Para qui clôt le livre permet d’envisager plus clairement les intentions d’Hélène Sanguinetti dans Domaine des englués comme dans ses livres précédents. Sur le terrain mouvant de l’aventure des mots, de la phrase et du récit, où sont les repères ? Récit, journal, lettre, poème, quelle identité pour ce texte ?… Qui dit « je » ? Qui est « tu » ? Où nous trouvons-nous ? Des indices apparaissent, qui parfois se contredisent. Le narrateur est-il un homme ou une femme rêvant d’être un homme ?
Je voudrais être maçon, avoir du plâtre sur mes c...

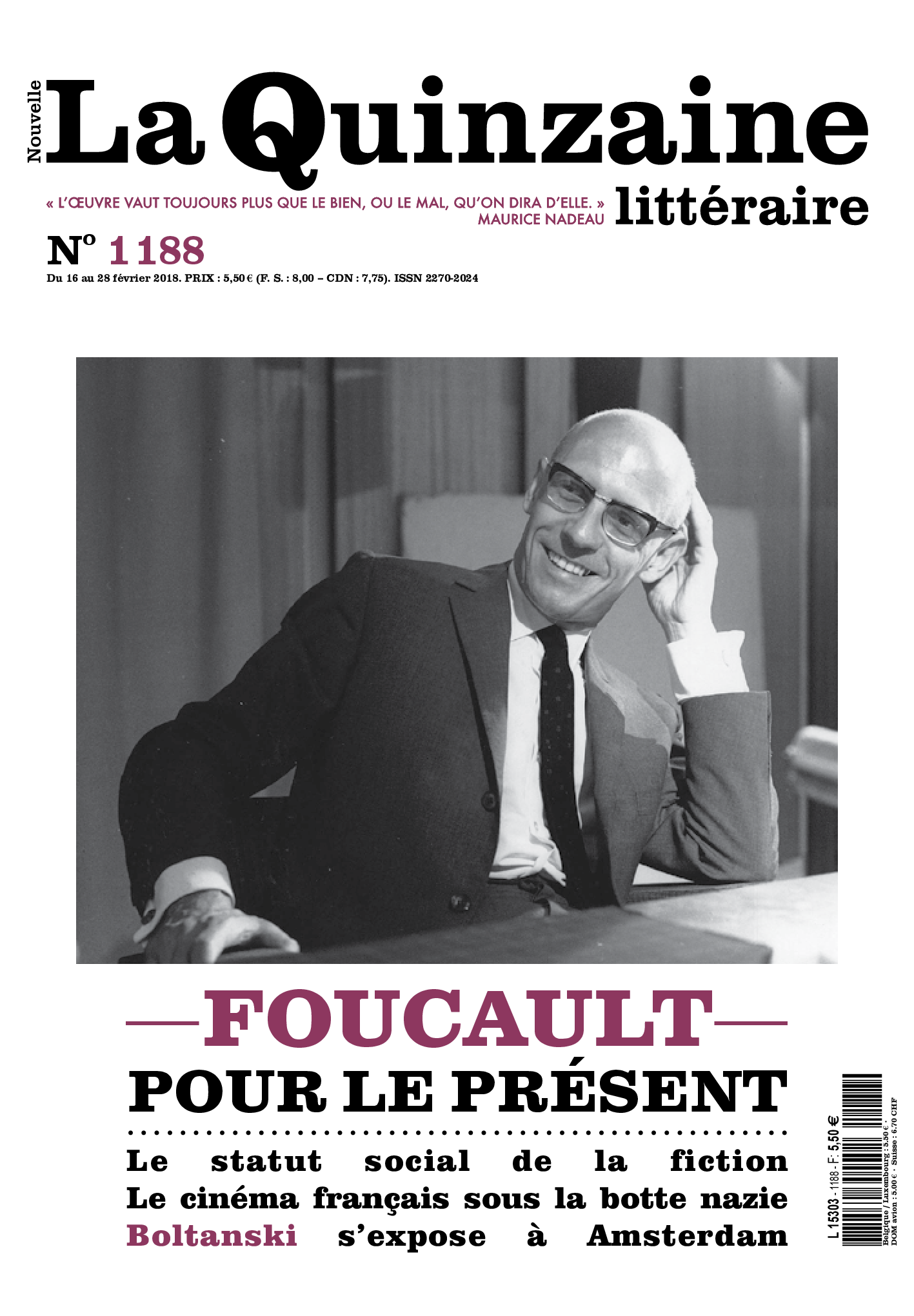

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)