J'ai lu Nietzsche contre Foucault. Sur la vérité, la connaissance et le pouvoir, après avoir moi-même écrit et publié Nietzsche lecteur de Heidegger[1]. Si je le mentionne, c'est parce que j'ai jubilé à la lecture de Bouveresse, qui s'en prend à Foucault mauvais lecteur de Nietzsche, de même que Heidegger a fabriqué un Nietzsche à sa main, le caricaturant fortement afin de se faire passer pour son meilleur et ultime successeur.
Cette correspondance m'a autorisé à prendre une liberté que j'évite habituellement lorsque je parle d'un livre : ajouter ma voix [entre crochets] à celles de Bouveresse, de Nietzsche et des auteurs qui ont « maltraité » celui-ci, à commencer par Foucault.
Foucault détourne Nietzsche
Quelle est la thèse de Bouveresse ?
Lui-même lecteur assidu de Nietzsche, il montre à quel point Foucault a caricaturé Nietzsche pour lui faire dire ce qu'il n'a jamais écrit, à savoir que la « vérité » est une construction, un produit, un effet, etc., donc ni plus ni moins qu'un discours. Un discours en vue de quoi ? Établir un pouvoir, ou même « le » pouvoir. Si bien que Foucault revient sans cesse sur les régimes de discours, d'énonciation, [et met en exergue le biopouvoir, c'est-à-dire le pouvoir qui s'attaque directement au vivant, modèle les corps, asservit les sexes, etc.]
Or la lecture de Nietzsche, à tous les stades de son existence philologique et philosophique, montre que la plus grande partie de ce qu'il écrit sur la vérité est liée au combat de sa vie : la séparation voire l'opposition néfaste que tous les dualistes, à commencer par Platon, ont établie entre le corps (muable, périssable) et l'âme (immuable, impérissable), et l'ont portée au rang d'un dogme indiscutable, ensuite façonné et propagé par les chrétiens. D'où le « monde vrai » (peu accessible) et le monde des « apparences » (dont il faut s'extirper). En réalité – une réalité qui est celle de la survie, de l'existence des vivants – certaines choses sont « tenues pour vraies », sans être « vraies ». C'est là que Foucault commence à travestir Nietzsche, affirme Bouveresse, car celui-ci n'a jamais nié qu'il existe une vérité, même si - bien sûr - elle ne peut être celle de ce « monde vrai » qu'il fustige sans répit. Ce qui est vrai, dit Nietzsche, est l'exercice de la volonté tendant à la puissance, car cette vérité s'impose à tous nos actes. Le vrai est d'abord ce qui s'oppose à l'erreur et au mensonge, [et - par dérivation - au faux ; le faux est le fautif].
Bouveresse, au-delà de Foucault, critique poliment mais fermement, cette école française qui privilégie le pathos, l'intensité, la qualité, et tient la précision, la logique et un exercice mesuré de la raison comme un intellectualisme déplacé et superflu. Ainsi Bouveresse cite Daniel Defert, qui explique que Foucault était aux antipodes de Vuillemin, traité de « logicien », alors que - dit Bouveresse - celui-ci (qui aida Foucault en 1970, puis Bouveresse en 1995, à entrer au Collège de France, où il détenait la chaire de philosophie de la connaissance depuis 1962) se prenait pour un historien de la philosophie.
Ce ne sont pas pourtant les explications des « rationalistes » qui manquent. Ainsi Frege distingue-il « être vrai » et « proposition considérée comme vraie », et Canguilhem disait-il « savoir contient valoir ». « Tenir pour vrai » répète Bouveresse n'est pas « être dans le vrai », comme dans un lieu où l'on s'installe ou un objet qu'on maîtrise. Cette prétention à la maîtrise montre, au contraire, qu'on est dans le croire et non dans le savoir. Car savoir c'est accroître sa puissance.
C'est ici que Nietzsche et Spinoza sont proches. Bouveresse cite Nietzsche, écrivant en 1881 qu'il a un prédécesseur : Spinoza. « Faire de la connaissance un affect puissant », lui attribue-t-il. [En fait c'est plus que cela : la puissance d'agir cherche à augmenter (s'efforce, désire, veut - selon les termes de Spinoza), afin de conduire à une extra-temporalité qui nous rend heureux. Ainsi connaître c'est se rendre capable d'agir pour notre mieux. Spinoza écrit : « la volonté et l'entendement sont une seule et même chose ». Si Nietzsche admit Spinoza comme prédécesseur au début des années 1880, plus tard, comme le révèlent ses écrits posthumes, il le désigne comme « frère ».]
Revenons à Foucault. La distinction entre ce qui est vrai et ce qui est cru vrai - que maintient Nietzsche - est pour lui inexistante. La vérité, à ses yeux, n'est qu'une arme du pouvoir. Il existe donc autant de vérités que de camps en présence. [Ce qu'on appelle depuis peu « post-vérité » et « vérité alternative » est de ce registre]. Bref, conclut Bouveresse, ne confondons pas « preuve de vérité » et « preuve de force ». Et regrettons, ajoute-t-il, que Foucault se soit conduit plus en rhéteur qu'en philosophe.
Nietzsche, aristocrate de la pensée
Bouveresse n'en est pas resté là avec Nietzsche, et s'il en parle dans divers ouvrages, dans le dernier, publié peu après sa mort, il en traite avec la connaissance qu'il a accumulée depuis des décennies[2]. Je commencerai par le dernier paragraphe car il conclut aussi la diatribe de Bouveresse sur Foucault :
« L'habileté suprême de Foucault a été, à mon sens, de réussir à convaincre, sans avoir besoin pour cela de fournir un effort considérable, un nombre significatif de lecteurs qu'il avait résolu de façon plus ou moins définitive un certain nombre de questions dont un regard un peu plus attentif sur ce qu'il a réellement fait montre qu'il a cherché avant tout à faire comme s'il n'avait aucun besoin et aucune obligation d'en tenir compte. Pour dire les choses autrement, aussi inconfortable, ardue, compliquée et apparemment décourageante que puisse être la question proprement philosophique, et non pas simplement historique, sociologique ou autre, de la vérité, on ne peut pas à la fois décider de l'ignorer et laisser croire qu'on a apporté une contribution significative à sa résolution. »
Cette question de la vérité, centrale et permanente chez Bouveresse, est à nouveau mise sur le tapis, une fois de plus avec Nietzsche, auquel il veut épargner deux sortes d'infamies : la relativisation de la vérité (Foucault) ; l'engagement dans une démocratie subversive (Deleuze). Ayant déjà rendu compte du point de vue de Bouveresse sur « la vérité chez Nietzsche » je vais me concentrer sur les chapitres VII : Qui sont les « forts » et les « faibles » et à quoi les reconnaît-on ? et XII : Nietzsche penseur « apolitique » ou « totus politicus ».
[Je passe sur le fait que certains en ont fait un précurseur du nazisme, sous prétexte de son amour pour Wagner, de son exaltation du Surhomme, du « renversement de toutes les valeurs », de la « volonté de puissance » et de « l'éternel retour du même ». En réalité ces quatre concepts clefs de Nietzsche ont été mis en avant par Heidegger, qui, en matière de falsification, l'emporte de loin sur les philosophes français de la deuxième moitié du XXe siècle.]
Le chapitre VII traite des hommes supérieurs, ceux qui pratiquent l'ascétisme, la dureté envers soi-même : « Ils règnent non par ce qu'ils veulent, mais par ce qu'ils sont : ils ne sont pas libres d'être les seconds. » (L'antéchrist, § 57, 1896)
Bouveresse insiste sur ce non-choix de la supériorité et en profite, au passage, pour fustiger « une espèce de (petits) Césars philosophiques » qui estime que créer est plus important que connaître, autrement dit cherchent à plaire plus qu'à savoir. Cette espèce est vouée au « progrès » et à la « démocratie » parce qu'elle ne sait pas ce qu'est la grandeur, celle qui possède [dirai-je] les hommes supérieurs.
Dans le chapitre XII, Bouveresse montre que pour Nietzsche les hommes ordinaires n'ont pas mieux à faire que de servir les hommes supérieurs, dont ils sont les instruments. Mais attention : les dirigeants politiques ne sont pas ces êtres supérieurs. Ceux-ci conçoivent les valeurs que les dirigeants mettent en œuvre. Ces valeurs sont celles de la vie elle-même : une lutte continuelle pour s'étendre, se renforcer, s'augmenter. Ici Bouveresse critique Deleuze (comme il le fait dans tout ce chapitre), lequel considère que la lutte est étrangère à Nietzsche, alors que celui-ci se dit disciple d'Héraclite.
Lorsqu'il se prononce contre l'égalité des droits [un avatar du christianisme], c'est pour éviter que l'humanité tende vers le bas. Idem pour la liberté. Il vise une perfection de l'humanité, qu'il croit impossible en son temps, et qu'il énonce ainsi : « De la souveraineté de la vertu. Comment on aide la vertu à obtenir la souveraineté. Un Tractatus politicus de Friedrich Nietzsche ». Ce traité s'adresse à « l'homme synthétique ». Pour Nietzsche l'élévation de tous serait en réalité l'abaissement de tous. [Nous sommes donc loin du Tractatus Politicus de Spinoza, qui exalte la démocratie. Et pourtant Nietzsche reprend le même titre […]
Que cherche à montrer Bouveresse en dénonçant « l'aveuglement des disciples » ? Et pourquoi parle-t-il des « foudres » de Nietzsche ?
Nietzsche est le philosophe au marteau : il doit marteler des vérités qui sont constamment mises en question, par ceux-là mêmes qui se réclament d'une pseudo-vérité : celle des théologiens, même sous ses formes laïcisées. [Les « foudres » jouent, selon moi, le même rôle que le marteau : elles sculptent, elles brisent.]
L'aveuglement des disciples, c'est celui des adorateurs de Nietzsche qui – bien que celui-ci les ait par avance avertis – en font le héraut de telle ou telle cause, à commencer par la démocratie. [Ou par le nihilisme, alors que Nietzsche y voit le dernier avatar du platonisme et cherche à le dépasser, précisément en mettant l'accent sur la volonté de (vers la) puissance.]
Je crois comprendre pourquoi Bouveresse place au centre de sa réflexion la vérité et les manières dont elle est mise à mal par les prétendus postmodernistes. [Cependant, il existe aussi un Nietzsche psychologue, celui de la primauté des sentiments, de la multiplicité des moi, du perspectivisme et d'une conception très subtile de l'histoire.] La recherche de la vérité – loin d’être une posture – est un combat, dont l’issue n’est jamais assurée.
[1] L'Élan des mots, 2020.
[2] Les foudres de Nietzsche et l'aveuglement des disciples, Hors d'atteinte, 2021. La postface de Jean-Jacques Rosat, Bouveresse, Nietzsche et le nietzschéisme à la française, est une bonne introduction à l'évolution des rapports de Bouveresse à Nietzsche et aux motifs de sa prédilection pour ce dernier.


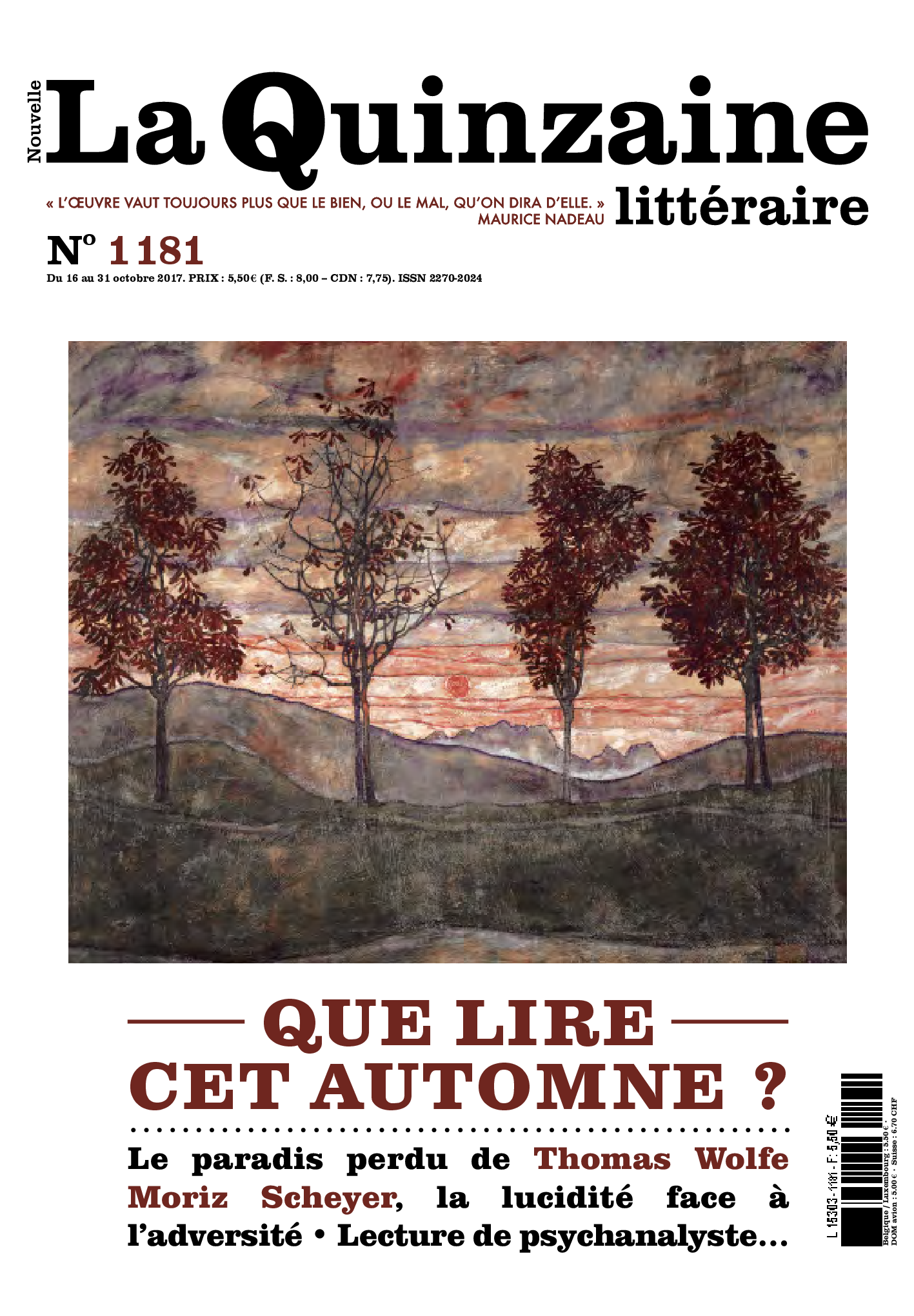
Commentaires (identifiez-vous pour commenter)