Contempler les portraits de Pompidou, Chirac tout jeune ou Yves Montand, la cigarette au coin des lèvres ou entre les doigts est une des façons d’entrer dans cet album qui parle d’abord à la mémoire. Perlstein entre tout jeune à L’Express, après sept ans passés à l’armée. On est au seuil des années 70 et cet hebdomadaire, créé en 1953 par Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroud est LE magazine de l’après-guerre. Il incarne une gauche moderne, proche de Pierre Mendès-France, mais aussi et surtout des classes moyennes et des cadres qui veulent consommer, de l’électro-ménager à la culture en passant par les voyages comme le font les héros des Choses, de Georges Perec, roman emblématique de l’époque. La silhouette de Perec rue du Renard rappellera des souvenirs à bien des lecteurs. Sans doute sortait-il alors de quelque bureau de la rue du Temple…
Souvenirs, oui, inévitablement. La France que montre Perlstein est d’abord celle des personnalités de la culture, de la politique et de l’économie qui dominent en ce temps. C’est le pays de Pompidou dont Jeambar dresse un portrait assez contrasté, quand on se rappelle plutôt l’homme qui n’avait pas vécu les combats de la Résistance, qui aimait les bagnoles à en détruire Paris, avait pour ministre un Raymond Marcelin toujours prompt à faire brandir la matraque, et discutait avec Nixon et Brejnev, deux références. L’auteur de ces lignes ignorait que le Président avait tenu à Chicago un grand discours que les écologistes d’aujourd’hui ne renieraient pas, discours dans lequel il annonçait la fin des ressources naturelles les plus précieuses. Il ignorait aussi que Pompidou n’était pas si éloigné du projet de son Premier ministre Chaban-Delmas sur la Nouvelle société (projet initié par Delors et Simon Nora). Nul n’ignorait, en revanche, quel amateur d’art contemporain il était, quelle place il donnait à la culture. On aurait aimé que son actuel héritier en fît autant, et avec autant d’intelligence…
Ce que le texte de Denis Jeambar met en effet bien en relief, c’est le passage d’une époque à l’autre, l’entrée dans le monde que nous connaissons, sans frontières sur le plan des échanges économiques, techniques, culturels et parfois humains. L’Europe est coupée en deux mais on ne s’affronte plus en politique comme des ennemis. L’élection de Mitterrand en 81 montre que la peur du communiste au couteau entre les dents est passée, que les alternances seront possibles, parce que les projets politiques ne sont pas si éloignés les uns des autres. En ces années 70 s’achève aussi un siècle marqué par les guerres, par le gaullisme comme épopée, par les déchirements liés aux totalitarismes. Avec la crise économique de 73, la hausse soudaine du prix du pétrole et surtout la montée du chômage, un autre pays naît. Les photos de Perlstein ne le montrent pas vraiment puisqu’elles fixent des visages, des couples, plus rarement des groupes. Une seule photo montre les immigrés maghrébins descendant du bateau à Marseille : ils constituent cette main-d’œuvre dont on a tant besoin. Mais on trouvera dans Libération, dans des journaux ou revues désormais disparus, dans des reportages aussi de Depardon ou d’autres, la France qui change, celle des périphéries, des usines, des campagnes ; une France invisible dans les organes de presse qui ne veulent pas démoraliser les beaux quartiers de Paris ou les pavillons et résidences des Yvelines.
Alors regardons sans nous lasser la France de Perlstein. Sur la couverture, François Truffaut le cinéaste qui incarne la « Nouvelle Vague » (une expression inventée par L’Express) et Coluche, celui qui ose tout (avec tant d’intelligence) pour faire rire. Avec les journalistes d’Hara-Kiri, Coluche est celui qui franchit toutes les limites, en un temps où on ne craint pas les censeurs, le politiquement correct et la bêtise qui leur font cortège. En première page, Isabelle Adjani. Perlstein est un photographe de l’instant. Il capte très vite ce qu’il faut, à la fois celle qui pose devant lui et celle qu’elle sera dans les années qui suivront : une star. On tourne les pages, on se rappelle le bonheur de Roman Polanski auprès de Sharon Tate, quelques semaines avant que la folie meurtrière ne détruise tout. Melville et ses acteurs du Cercle rouge, en contreplongée : Périer, Bourvil, Montand et Delon autour du metteur en scène portant son éternel Stetson et ses Ray-Ban qu’un jour de rage Belmondo voulut arracher. Miles Davis, toujours félin, élégant, tournant le dos à son public, la trompette dressée comme s’il menaçait quelque Jéricho moderne. Rubinstein, malicieux, qui demande à Perlstein de le faire rire, Planchon, Miró, Chaplin, Catherine Hepburn riant aux éclats parce que son pantalon vient de craquer. Perlstein prend les plus grands mais il cerne aussi les moments cruciaux. Toute en verticalité, une image de Chirac, jeune secrétaire d’État avec Bergeron, le patron de FO qui cherchait toujours « du grain à moudre ». Où l’on apprend qu’une longue amitié les a unit. Ce n’est pas l’amitié qui réunit au congrès de Metz en 79 les deux hommes forts du PS : Rocard est assis à la tribune, Mitterrand passe derrière lui et l’on se dit que si ses yeux étaient des mitraillettes… D’autres duos sont plus pacifiques : Béjart et John Cage, Sartre et Beauvoir, Thérond, Ténot et Filipacchi qui réinvente la presse et lance le jazz ou les idoles des jeunes à la radio. Mais aussi Jacques Dutronc et Sonia Delaunay réunis le temps d’une émission de télévision.
En voyant le portrait de Maurice Clavel, on garde le souvenir d’une sortie furieuse, on se rappelle des chaînes encore cadenassées, avant que Chaban-Delmas ne supprime l’ORTF et ne nomme le génial Desgraupes à la présidence de la télévision. Un courant d’air souffle, les projets abondent, les nouvelles têtes apportent beaucoup. Pour qui essaie aujourd’hui de regarder la télévision (à part Arte), le souvenir de Santelli, de Pivot et de quelques autres est comme remuer un couteau dans la plaie. On croyait encore que le petit écran pouvait éclairer, éduquer…
Mais il serait vain d’éprouver de la nostalgie pour cette époque ou pour d’autres. Une vague mode nous y incite, qu’elle soit vestimentaire ou portée par des films, des expositions. Les années 70 ne sont pas un âge d’or. La guerre du Viet-nam s’achève à peine, et les Khmers rouges provoquent l’un des pires génocides qui soient. À « l’Est », la camisole chimique ou l’exil vers la Sibérie n’ont pas disparu ; bientôt les Soviétiques entreront en Afghanistan. Cela, Jeambar l’évoque, comme il rappelle la stupidité d’un Georges Marchais et son « bilan globalement positif en URSS », l’incurie d’un Chirac qui ne raisonne qu’en homme avide de pouvoir. On pourrait poursuivre la liste des fléaux, des calamités, des instants ou périodes de bêtise de ces années. La différence, et elle est de taille, c’est que nous étions plus jeunes, les poumons moins encrassés, et l’espoir que les progrès de la médecine seraient tels qu’on pourrait fumer des sans-filtres jusqu’à la fin de nos jours.
Norbert Czarny
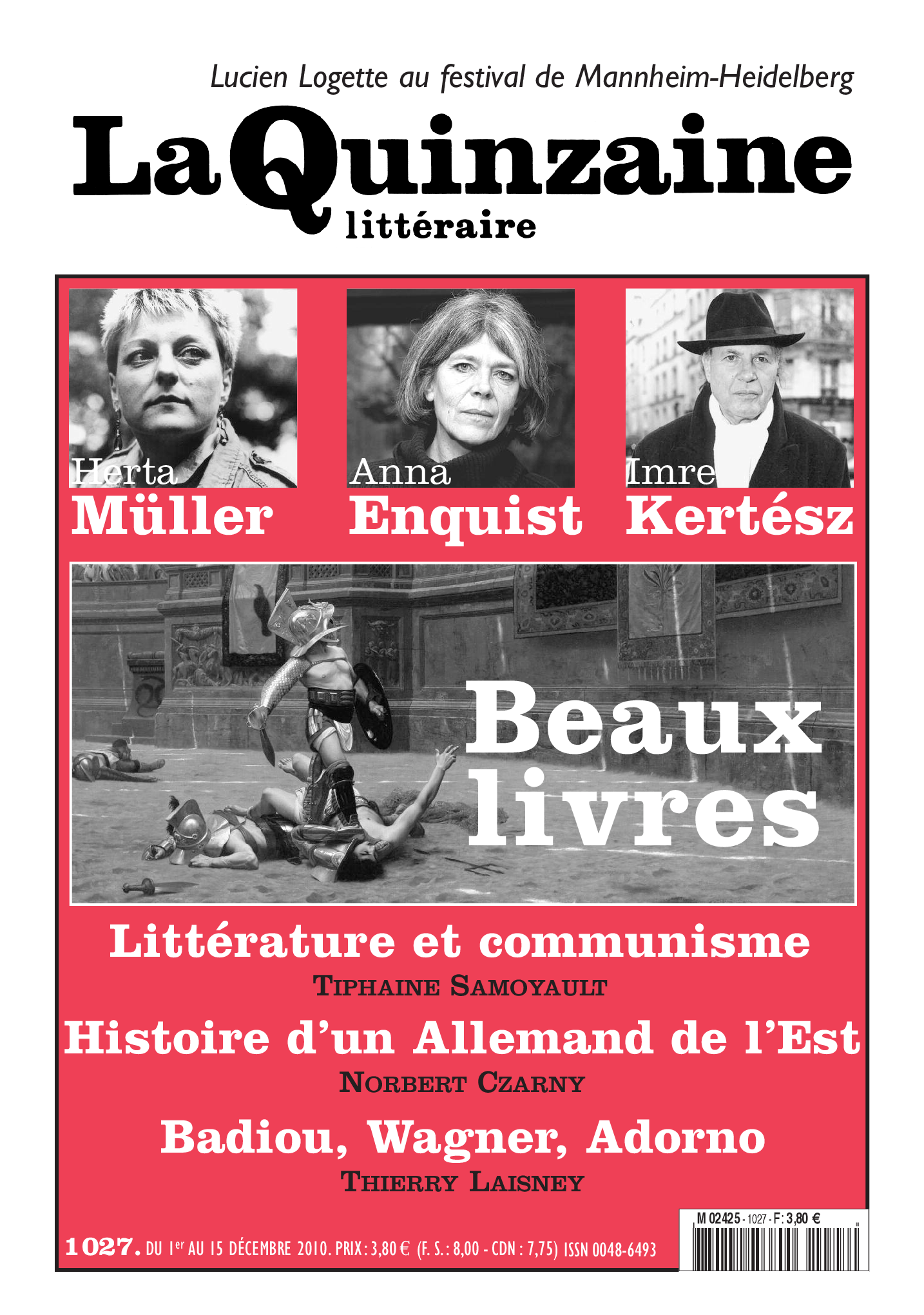

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)