Quand en finit-on avec son enfance lorsque celle-ci n’a pas été la période fondatrice sur laquelle construire son avenir mais un moment de perpétuelle incertitude où la claque pouvait venir n’importe quand ? Quand devient-on un homme, un père, quelqu’un capable de donner la vie et d’aider à grandir ? Dans son précédent recueil, Verger (2019), deux ans après Joachim, l’auteur semblait s’apaiser dans les travaux des champs et la perspective de la pousse lente des arbres par lui plantés. Mais dans Un sol trop fertile, l’enfant répétant « en boucle qu’il a trois ans et demi », ce sont les mauvaises herbes du doute qui envahissent la vie de l’auteur. Dès les toutes premières pages, le ton est ainsi donné quand il confie : « les larmes aux yeux quand tu songes au fils qui te réinvente ».
Pourquoi l’enfant qu’a été l’auteur était-il battu par son père, nous ne le saurons pas, Cédric Le Penven se montre tout le temps d’une grande pudeur. C’est probablement la pudeur qui explique une métonymie courant dans tout le livre, à propos des mains : celles du père qui volent autour de sa tête ou de son corps recroquevillé au sol. Celles de l’enfant qu’il a été, également : « les mains parfois griffées et sanglantes, tu prenais le chemin du collège / et les autres ne voyaient que tes mains ». D’autres fois en revanche, ces mains servent à planter des arbres, à construire des ruches. Elles s’activent alors dans l’oubli du passé, de la colère subie, et renouent avec les plaisirs et les jours que le Verger permettait d’entrevoir.
Parcourant l’ouvrage, nous serions tentés de nous demander si ce qui est imprimé là, sur la page, est finalement toujours de la poésie tant les notations formant le texte sont relatées avec simplicité. Certes, entourés de blanc, des groupes de mots se signalent de temps à autre à notre attention, mais nous distinguons à peine ici ou là de rares euphonies, une ébauche de rythme. Le vers, si vers il y a, tend à la prose mais à une prose non poétique, une prose neutre, sobre, volontairement sans lyrisme. Comme dans beaucoup d’autres ouvrages de l’auteur de surcroît, le lecteur a autant l’impression d’entrer dans un journal intime, impression renforcée ici par la mention d’une date au bout de la première ligne du premier texte, en haut, à droite. Hasard typographique ou effet calculé ? La date se lit en tout cas à l’endroit exact où un diariste placerait le quantième, le mois, l’année, en l’occurrence, « ce matin 11 février 2018 ». D’autres indications temporelles permettront par la suite de constater que le texte suit l’ordre chronologique d’une année, la fin de l’ouvrage renouant avec l’hiver, saison chère à l’auteur où la feuille encore intacte, immaculée tel le paysage à la fenêtre, est noircie par les mauvaises pensées. Comme n’importe quel autre journal intime, celui-ci évoque quelques tracas de la vie quotidienne, l’hostilité d’un collègue, les démêlés avec un voisin, un retour sur les lieux de son enfance, la maison d’autrefois, l’école où il allait. Mais ce sont ses doutes, ses craintes, ses insomnies, ses impasses qui occupent l’essentiel de l’ouvrage : « j’écris ce qui a eu lieu et a lieu toutes les nuits encore », déclare-t-il ainsi, après on ne sait combien de nuits où il est parti dormir dans la chambre d’ami, de peur de réveiller « l’aimée ». Car il note avec reconnaissance l’aide que lui sont son fils et sa femme qui « va avoir quarante ans cette année ». Il consigne leurs mots, leurs regards, leurs gestes, ce qui pourrait le soutenir mais qui n’est pas d’un grand secours quand il reste allongé, prostré. Nos vies étant faites de mouvements contradictoires, le lecteur y lit aussi les élans qui le poussent vers eux, sa culpabilité fréquente, lancinante, d’agacer, de lasser sa femme, l’angoisse de ressembler au père honni… L’ensemble, malgré l’attention réconfortante de son entourage, forme une suite de nuits blanches et de jours sombres. Le lecteur se dit parfois qu’il va s’en sortir avant de le voir plonger à nouveau plus profondément en lui, arpenter ces terres décidément trop fertiles, « où les fougères étaient arborescentes, comme la mémoire »… Finalement, peu importe qu’il s’agisse d’un recueil poétique ou d’un journal intime. Ce qui compte, ce sont ces mots alignés et isolés sur le papier, dont le laconisme amplifie la vibration, le trouble dans l’esprit du lecteur.
Parfois le texte tend à la formule, à la maxime dans le goût des philosophes latins ou des moralistes français du Grand Siècle. Là encore, il ne s’agit pas de faire le poète, comme il le dénonce à la fin d’un texte. Il s’agit de condenser en quelques mots une idée qui aide à vivre ou en tout cas à ne pas sombrer : « mieux vaut les rétines brûlées que de ne fixer que les ombres » ou bien : « grandir, c’est peut-être cesser de croire qu’une douleur nous ressemble plus qu’un sourire ». Quelques préceptes aussi comme celui-ci : « exténuer les muscles pour être un peu tranquille », participent également de cet effort pour vivre, pour être un père.
Un sol trop fertile est à considérer en ce sens d’une élucidation de soi où ne cessent de pousser et de repousser les anciennes mauvaises graines, les graines de peur et de douleur que l’âge adulte manifestement n’est pas parvenu à arracher. Les pages où le poète évoque l’un de ses emportements sont particulièrement impressionnantes : « tu ne sors plus de cette colère. Cela fait plusieurs semaines que tu rumines les paroles humiliantes qu’un collègue a adressées à tes élèves / tu te vois l’attraper au col. Le projeter au sol. Lui écraser la glotte / dans ton miroir, tu surprends le visage de ton père, tordu par un cri silencieux, traits écrasés, salive amère ». La position du corps à terre, les sons qui ne sortent plus de la bouche et jusqu’à l’absence assez étonnante de la mère qui n’existe plus qu’à l’état résiduel d’une humeur dans la bouche rappellent immédiatement au lecteur ce qu’a subi l’auteur enfant. C’est tout cela qui forme ce sol bien trop fertile du titre. Mais sourd également une révolte contre la complaisance dans le malheur : « non. Je refuse de me laisser contaminer par le venin de cet enfant blessé amoureux de sa blessure / […] une blessure est un sol trop fertile ». L’impudeur, nous l’avons dit, n’est pas le fort de Cédric Le Penven, ni la complaisance. Et quand il estimera, avoir trouvé « la formule » qui lui permettra de s’en sortir (« comment celui qui fut battu par son père a-t-il pu battre son fils », s’interroge-t-il), de sortir de soi et de son enfance, à la dernière page, il ouvre « grand la fenêtre » et accueille « l’infinie variation du monde », preuve, s’il en était besoin, que sa souffrance n’était pas complaisance impudique, délectation narcissique. Rares sont les œuvres poétiques donnant autant le sentiment d’engager l’être dans une telle recherche vraie de soi-même, sans tricher, sans viser quelque effet esthétique, et parvenant quand même à nous laisser une évidente impression de réussite littéraire. Un sol trop fertile est de celles-ci.
Thierry Romagné
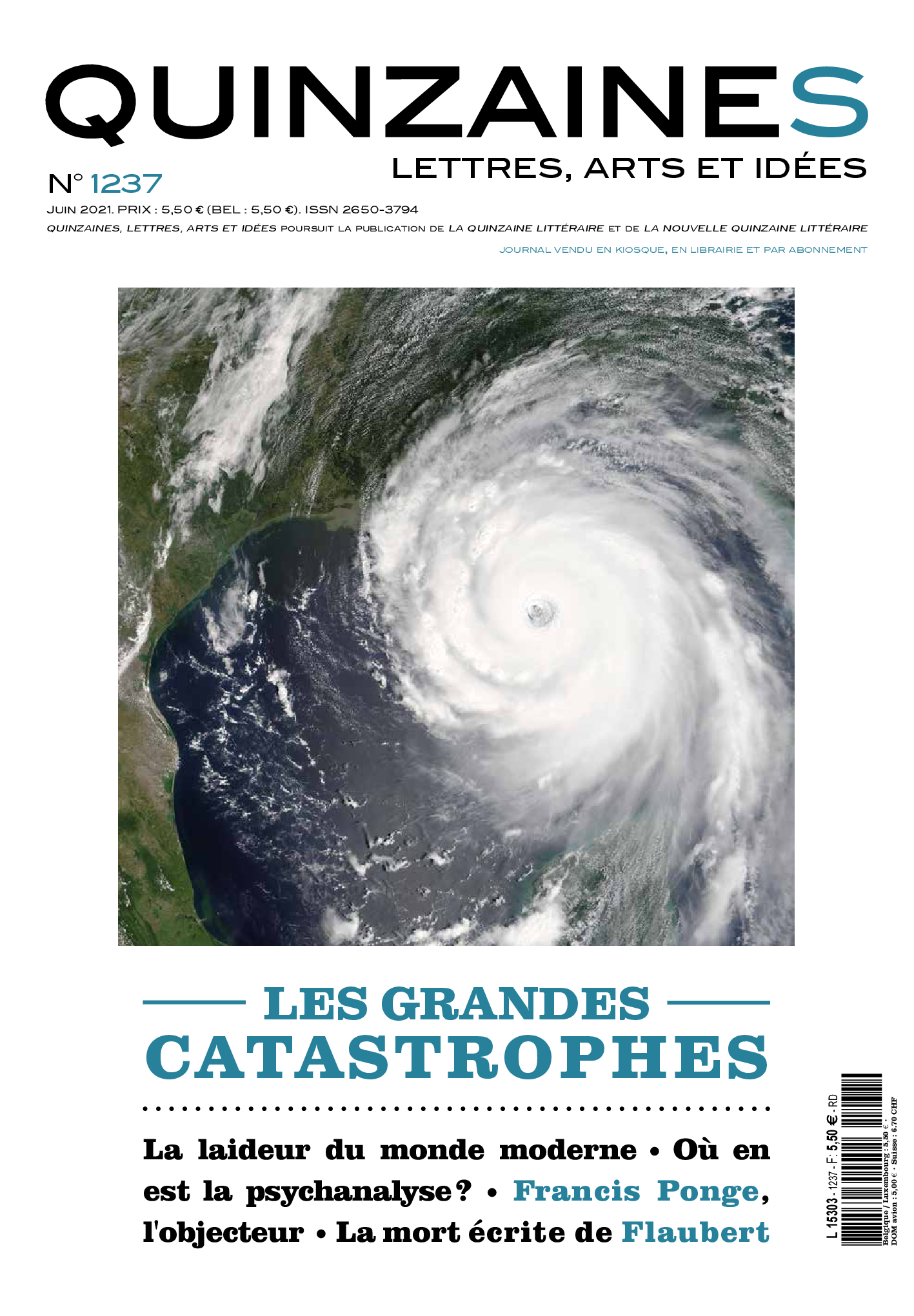

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)