La « philosophie naturelle », jusqu’au XVIIe siècle, désignait tout ce qui concernait le monde sensible, la matière, les êtres vivants, en dehors de la « philosophie morale », les deux succédant à la « physique » et à la « métaphysique » des Grecs. Ainsi étaient nettement délimités deux mondes, dont la connaissance exigeait des méthodes différentes, voire discordantes. Avec Galilée, Descartes et leurs proches successeurs, tels Hobbes, Spinoza ou Locke, l’opposition ne disparaît pas, mais elle commence à être combattue, voire jugée absurde (c’est le cas de Spinoza et, cent ans plus tard, de Hume).
L’essentiel, pour eux, est que la compréhension de la Nature est le fruit de l’observation, de l’expérience et de la formalisation que permettent, d’une part les mathématiques, d’autre part, les concepts philosophiques. Il devient possible de trouver des lois de la Nature, qui ne dérivent d’aucune révélation, ne manifestent aucune volonté divine. Il est admis que ces lois naturelles s’appliquent à tout ce qui existe, organique et inorganique, humain et non-humain. Elles ne s’appliquent pas aux esprits et autres chimères… mais ceux-ci n’existent pas, ce sont des êtres de fiction.
Pour Spinoza : « Cet Être éternel et infini que nous appelons Dieu ou Nature, agit avec la même nécessité qu’il existe. […] N’existant donc pour aucune fin, il n’agit pas non plus en vue d’une fin, et, comme son existence, son action ne comporte aucun principe ni aucune finalité » (Éthique, partie IV, préface).
Pourtant, pendant les trois siècles qui ont suivi – et pour beaucoup encore aujourd’hui –, les activités et les sociétés humaines continuent à donner lieu à des doctrines philosophiques spéciales, traitant du langage, de la culture, des institutions politiques, etc., comme si tout cela était étranger à la Nature. Bien que rien d’autre ne les rassemble, c’est le cas de Kant, de Hegel, de Husserl ou de Heidegger, pour ne mentionner que des philosophes allemands.
C’est pourtant aussi d’Allemagne que vient la première formulation de ce que seront ensuite les principes de l’écologie. Pour moi, elle commence avec Alexander von Humboldt, lorsqu’il écrit à Caroline von Wolzogen, le 14 mai 1806 : « Dans les forêts de l’Amazonie et sur les hauts sommets des Andes, j’ai toujours eu conscience que le même souffle anime la même vie, d’un pôle à l’autre de la planète, dans les plantes, dans les animaux et dans la poitrine dilatée de l’homme. » Le même souffle.
Quarante ans après, Humboldt publie Cosmos, selon le terme grec qu’il réintroduit comme « l’assemblage de toutes choses dans le ciel et sur la terre, l’universalité des choses créées constituant le monde perceptible ». Son intention est décrite dans l’introduction du premier volume : « Le but le plus important de toute science physique est de reconnaître l’unité dans la diversité, de comprendre tous les aspects uniques révélés par les découvertes des dernières époques, de juger séparément les phénomènes uniques sans abandonner leur ampleur et de saisir l’essence de la Nature sous le couvert des apparences extérieures » (publié en quatre tomes chez C.W. Froment, 1851-1853).
Ce n’est sans doute pas un hasard si le terme d’« écologie » fut inventé par Ernst Haeckel, zoologue, et l’un des premiers propagateurs de la théorie de Charles Darwin. Strictement moniste, il croyait aussi, à tort, que l’ontogenèse récapitule la phylogenèse, l’embryon parcourant toutes les formes de vie depuis l’origine jusqu’à sa forme propre.
Depuis, les écologues – scientifiques – sont résolument monistes et darwiniens. Mais il est beaucoup plus difficile d’admettre, y compris chez les biologistes, que la Nature n’a pas de fin et que tout s’y déroule, suivant la formule de Jacques Monod, selon « le hasard et la nécessité ». Car parler de « même souffle » peut encore laisser place à une « animation » surnaturelle ou à une Nature bien ou mal intentionnée.
Or l’apport réciproque de la philosophie naturelle moniste (pour laquelle rien n’est hors nature) et de l’écologie scientifique (que je distingue soigneusement de l’écologie « profonde », une approche mystique et mystifiante, parmi d’autres, puisqu’elle prête un dessein à la nature) est que l’une fonde rigoureusement la compréhension de la « nature des choses » (pour parler comme Lucrèce) et que l’autre prouve ce fondement. Lorsque Spinoza écrit que la Nature est faite « d’individus d’individus à l’infini », il trouve écho dans le constat que les systèmes vivants s’emboîtent les uns dans les autres, des cellules à l’ensemble de la biosphère. Et lorsqu’il écrit que tous les corps se nourrissent d’autres corps pour subsister et, du coup, sont affectés par eux, il postule l’interdépendance complète de tous les êtres – physiques et vivants – que constatent physiciens et biologistes, lorsqu’ils étudient n’importe quel système, à n’importe quelle échelle. Ce qui fait de l’écologie une approche du monde réel similaire à la philosophie de la nature, c’est qu’elle ne sépare pas les êtres vivants du monde inorganique : elle aborde les écosystèmes en tant qu’entités physico-chimiques, biologiques et sociologiques (au sens le plus large du terme : les modes d’association, de cohabitation, de coexistence).
Cette philosophie naturelle moniste est aussi celle de Diderot, de Nietzsche et, plus près de nous, de Canguilhem, de Merleau-Ponty (qui finit par y arriver après son engouement pour la phénoménologie) et de Simondon. Lesquels, ce n’est pas non plus un hasard, se réfèrent à des biologistes monistes, comme Jakob von Uexküll et Kurt Goldstein, qui affirment, pour l’un, l’unité du monde vivant sous sa diversité et, pour l’autre, l’unité de chaque organisme malgré la spécialisation de ses organes et fonctions.
Cela ne signifie pas que l’écologie est « contenue » dans la philosophie naturelle moniste, mais qu’elles se conviennent mutuellement. L’écologie précise les intuitions des philosophes, et les complète.
Par exemple, les équilibres métastables ou les états « loin de l’équilibre » caractérisent les êtres vivants, la concorde et le désordre allant ensemble, au lieu d’être opposés. C’est ainsi que l’écologie contemporaine intègre mieux le devenir des vivants qu’elle ne le faisait il y a quelques décennies. Du coup, certains débats autour de l’extinction des espèces peuvent prendre une autre allure, sans que l’on se retrouve taxé soit de défenseur des animaux contre l’homme, soit d’humanistes bornés restant attachés à l’« exception humaine ».
Du point de vue de notre agrément, de notre utilité, de nos préférences pour les mammifères et pour les vertébrés, la situation est catastrophique. Parler de « sixième extinction massive », essentiellement due aux activités humaines, reste pourtant fort discutable, car, même si c’était le cas, pourrait-elle avoir lieu en quelques dizaines ou centaines d’années ? Personne n’en sait rien. Et n’a-t-on pas assisté (façon de parler) à des créations aussi massives d’espèces après chaque extinction catastrophique ? Est-il possible ou souhaitable de protéger toutes les espèces ou de protéger celles qui nous ressemblent le plus ? Ou le moins ? Qui va décider de ce qui importe ? L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui distribue les bons et les mauvais points ? L’UICN, forte de son réseau de 16 000 scientifiques, se soucie d’une meilleure utilisation de la nature, d’un plus intense emploi des ressources biologiques, mais ne se mobilise pas pour mettre fin à la souffrance animale d’espèces et de variétés qui sont surabondantes uniquement parce qu’on consomme plus de viande, de poisson et autres vertébrés…
Une saine réflexion écologique, qui n’oublie pas que la nature n’a aucune fin, s’en tiendra à des préconisations à la fois fermes et modérées. Protéger des espèces menacées oui, mais à tous égards : d’extinction, de prolifération (qui finit par l’autodestruction), d’usage intensif et excessif (comme cette vache américaine qui produit, 365 jours par an, près de 100 kg de lait par jour, et fait la fierté de ses propriétaires), de cruauté organisée (chasse à courre, corridas, combats d’animaux), de confinement dans des espaces plus que réduits (début 2017, 68 % des 47 millions de poules pondeuses françaises étaient élevées en batterie). Mettre en valeur les êtres vivants, oui, mais selon leurs propres penchants, et non dans des concours sportifs, esthétiques ou commerciaux qui sont du même ordre que l’esclavage des humains.
L’évolution des espèces, nous ont appris Darwin et ses successeurs, tels que Stephen Jay Gould, est imprévisible, non orientée, non hiérarchisée. Ce que nous orientons et hiérarchisons est à notre profit, que ce soit financier, esthétique ou moral (rien n’est aussi déplaisant que les productions d’animaux « éthiques et responsables »).
D’autres notions issues principalement de l’écologie peuvent nous conduire à mieux comprendre nos propres sociétés, notre propre devenir. Telles que : l’interdépendance des êtres vivants entre eux et avec toute autre « chose » dans la nature (selon l’idée de biosphère, liée à l’atmosphère, à la lithosphère et aux océans) ; l’intégration des divers niveaux (de la cellule au biome et à la biosphère). On ne peut plus calquer la compréhension de la nature sur la physique galiléenne (comme le fait Spinoza) ou newtonienne (comme Kant). Ce que nous apportent la biologie et l’écologie est une vision synthétique, ouverte, évolutive, unitaire (un seul code génétique pour tous les vivants, un seul arbre de l’évolution) et diversifiée (il n’y a aucune limite aux possibilités d’évolution) – qui s’applique aussi bien aux êtres humains qu’à tous les autres vivants.
Ainsi, nous finirons peut-être par arriver à une vision de notre propre histoire en tant que partie de l’histoire naturelle, et respectant les mêmes lois que le reste de la nature, sans résidu spiritualiste ou métaphysique. Car nous naissons, croissons, nous différencions, nous recréons et créons, en tant que sociétés, de la même manière que tous les autres êtres vivants.
Quant à l’évolution favorable des espèces, elle est bien plus due à leur hybridation (plantes), métissage (animaux) et symbiose (entre organismes uni- et pluricellulaires, plantes et champignons) qu’à la préservation de leur identité, à leur isolement entre frontières étanches et à la glorification de leur pureté de « souche ». Pour avoir oublié ou nié cela, l’espèce humaine s’est dénaturée. La devise de l’écologie pourrait être : Un seul monde. Un monde-Un.
[Michel Juffé est l’auteur d’À la recherche d’une humanité durable (L’Harmattan, 2018), où il explore les méfaits de la « volonté de puissance » et indique des remèdes possibles, dans la lignée d’un monisme qui part d’Épicure pour aboutir à l’écologie contemporaine.]
Michel Juffé
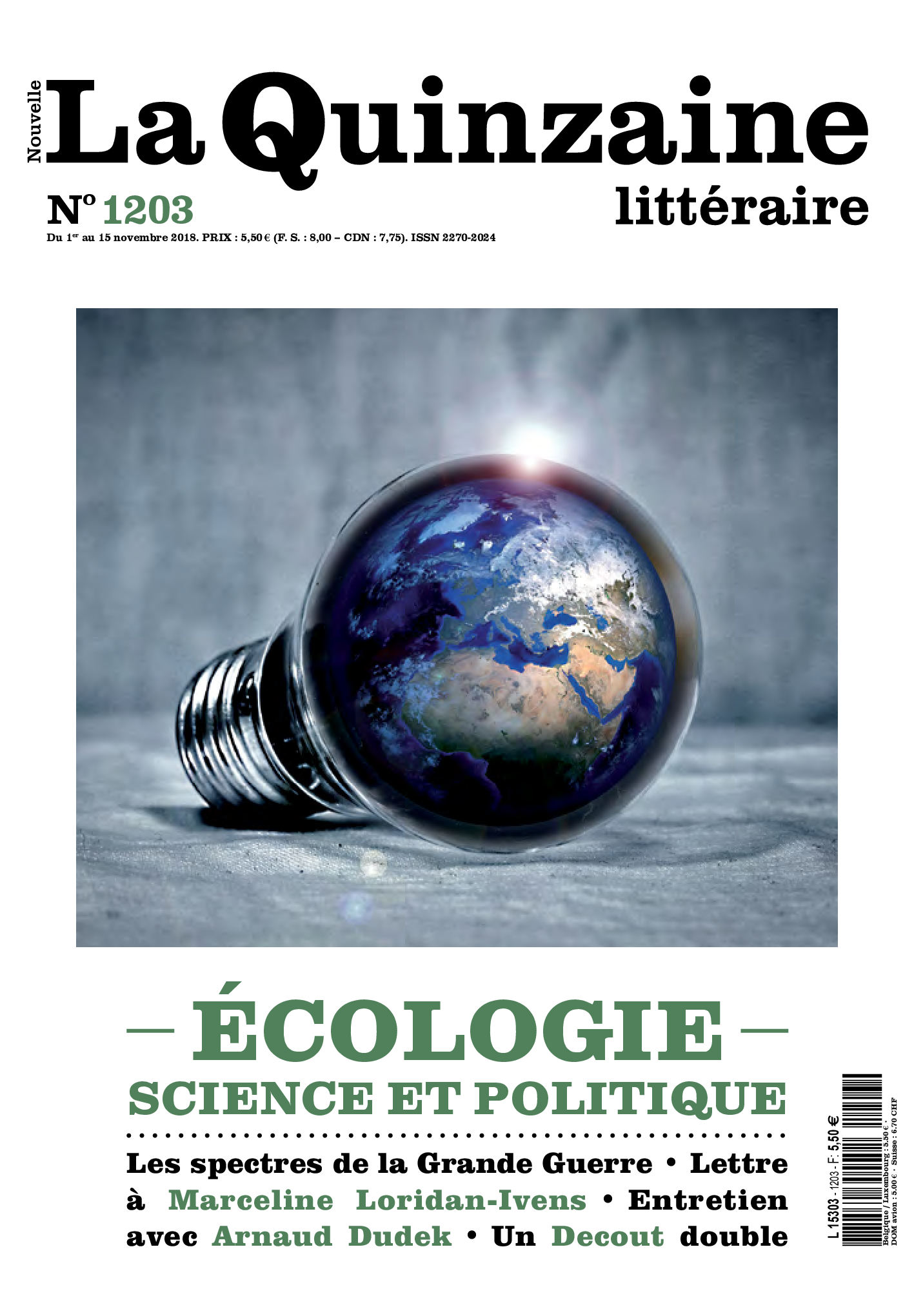

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)