Le narrateur est un homme à la dérive. Il a rompu les amarres, quitté un emploi, une compagne, au terme d’un repas aussi étrange qu’effrayant, sorte de fête monstrueuse. Il rencontre dans un café de Lyon Victorien Salagnon. Il devient le scribe de ce vieux soldat qui a vécu les principales guerres françaises, celles qu’on faisait encore à « l’ancienne ». Tout a commencé pour ce narrateur jamais nommé quand il a vu les spahis s’en aller pour la guerre du Golfe, la première, celle qu’on voyait sur des écrans de télévision comme un jeu vidéo. Les guerres que lui raconte Salagnon n’ont rien à voir, et on n’a pas fini d’en payer le prix. C’est celui de la « pourriture coloniale ».
Le roman d’Alexis Jenni fait alterner le « roman » et ses « commentaires ». Les lecteurs d’histoire romaine ne seront pas étonnés. C’est aussi de cette façon que Salagnon, lycéen de dix-sept ans, a découvert les textes latins lorsqu’il les traduisait, dans une institution religieuse de Lyon. Le roman raconte les guerres, le commentaire en montre les effets dans un quotidien inquiétant, celui des émeutes de banlieue, dans une périphérie lyonnaise appelée Voracieux-les-Bredins où vivent Salagnon et son épouse Eurydice, et Mariani, compagnon de tous les combats, qui en est revenu plus qu’amer, prêt à tuer quiconque ne lui ressemble pas. Le commentaire est aussi la partie réflexive du roman, celle qui met à distance la grande narration, et qui montre aussi comment le narrateur évolue entre déchéance et une forme de rédemption liée à l’amour. La femme aimée est un écho d’Eurydice, la salvatrice.
L’Art français de la guerre est un roman à la fois dense et limpide. On y entre comme dans la forêt tonkinoise, pris par la moiteur, étouffé par ce qu’on découvre, impressionné par l’écriture foisonnante et classique à la fois marquée par le rythme des phrases latines. Jamais cependant, on ne perd le fil de ce récit d’aventures qui emprunte au genre épique. Les références à l’Iliade et à l’Odyssée, principale lecture de l’oncle de Victorien, ne sont pas là pour rien.
La sueur, les odeurs, la poisse et le noir imprègnent les pages de ce roman. Toute cette matière, et bien d’autres, sont là d’emblée, colorant les épisodes – parfois des morceaux de bravoure qu’on voudrait garder en mémoire – rappelant qu’avant d’être un art, la guerre est un déferlement du pire. Parmi ces moments exceptionnels du roman, on n’oubliera pas le récit du départ des soldats français d’Algérie. Débâcle serait le mot juste. Derrière les dernières bombes qui explosent, les assassinats de collaborateurs supposés, on devine le martyre des harkis. Ce n’est que la suite et fin d’un massacre qui se poursuivait en tous lieux, dans les cafés comme dans les hôpitaux, dans les rues comme dans le moindre village.
La terreur comme technique revient à de nombreuses reprises dans le roman et n’est pas l’apanage des Français. Salagnon la découvre dans un village du Mâconnais, dont les habitants ont été massacrés par des nazis. Leur chef, prisonnier des maquisards, répond de ses actes sans haine ni passion. Une même froideur passera dans les propos d’un officier français en Indochine, quand Salagnon verra ce qu’il en est du renseignement. Et cette technique du renseignement appliquée par Josselin de Trambassac, colonel de parachutistes qui pratique la « question médiévale », est poussée à son comble dans la villa mauresque lors de la bataille d’Alger. Le narrateur mène son lecteur dans les caves puantes, il montre les paras qui se salissent les mains (Trambassac leur demande de se les laver mais est-ce possible ?), les victimes qui se liquéfient. On entend dans la bouche du colonel les explications et justifications évidentes, devenues banales, sur les attentats ainsi évités. L’épisode de la bataille d’Alger est l’un de ces morceaux de bravoure du roman dont les sources sont multiples (on devine qu’Alexis Jenni s’est documenté). Mais par une sorte d’effet de miroir, un jeu ironique, on en trouve l’écho quand Salagnon va voir le film de Pontecorvo au cinéma, et relève les erreurs et les oublis : les pieds noirs sont singulièrement absents de l’Histoire… L’art de la guerre repose sur l’obéissance et ce n’est pas, non plus, une vertu propre aux parachutistes français. Les combattants vietminh savent mettre à l’épreuve leurs recrues, les motiver au combat ; le sacrifice ne leur fait pas peur. Ce qui frappe aussi est leur capacité à faire de la guerre révolutionnaire une guerre des signes. Traverser la forêt en vélo Manufrance ou massacrer les prostituées d’un BMC et leurs accompagnateurs sénégalais sont leur façon de montrer à l’ennemi colonial ce qu’est une guerre totale. Quant aux Français, ils utilisent l’arme de la faim pour vaincre : on empêche le riz de circuler dans le Tonkin, on tue les ânes qui transportent blé et olives dans la campagne d’Algérie. La leçon nazie n’a jamais été perdue : on brûle des villages et on massacre les habitants.
On pourrait craindre le pire d’un tel roman. Qu’il adopte le point de vue du guerrier, qu’il banalise ses faits et gestes. On se rappelle les débats engendrés par Les Bienveillantes auquel, par une certaine démesure, ce roman ressemble. Le narrateur imaginé par Littell était seul à raconter et surtout on n’entendait guère d’autre voix que la sienne. L’Art français de la guerre met en scène des hommes brisés, dont les fêlures ne sont pas les mêmes. Au colonel Trambassac qui se prend pour Gilles de Rais s’oppose la figure réelle de Paul Teitgen, commissaire en Algérie qui faisait un décompte précis des morts, exigeait des traces de chaque victime de la villa mauresque. L’opposition qui court dans le roman, entre Ben Tobbal et Salomon Kaloyannis, le père d’Eurydice, fait partie de ces tensions qui mettent en valeur la dimension tragique, au sens propre du mot de la guerre d’Algérie. Infirmier en 1944, Ben Tobbal assiste le docteur Kaloyannis quand il soigne les blessés. En 1945, lors des massacres de Sétif, où, « à cause de l’incompréhension », l’on meurt « de terreur », il choisit son camp et le déclare à son compagnon et patron. Il croisera la route de Salagnon dans la campagne algérienne, et surtout celle de Mariani.
Et puis il y a Brioude, ami de Salagnon au lycée, devenu prêtre en Algérie et militant de l’indépendance, l’oncle de Salagnon qui sera fusillé en 1962 après avoir été le véritable père de Victorien, lui avoir appris l’essentiel. Il y a les soldats perdus, les légionnaires passés de la SS à l’Indochine, le vieil aristocrate annamite qui enseigne son art à Salagnon… En somme tous les personnages de ce roman s’inscrivent dans la fresque. Certains prennent place tout au fond comme des ombres : c’est le cas du père de Salagnon, un lâche opportuniste qui a toujours été du bon côté, sans rien faire. La description de la province sous Vichy sent le rance, le renfermé : « la France de 43 est close comme une maison de campagne en hiver […] le vent de l’histoire ne rentrait que par les fentes, en courants d’air qui ne gonfleraient pas une voile ».
Au-delà de ce que raconte le narrateur, on sent la présence du grand récit français, celui qui gonfle les voiles. Il a été composé par celui qu’il appelle « le romancier », le général de Gaulle qui a mis en scène l’Histoire de ce XXe siècle, en a fait ce qu’il jugeait bon et nécessaire, l’envers de l’Histoire contemporaine que nous lisons dans ces pages.
Norbert Czarny
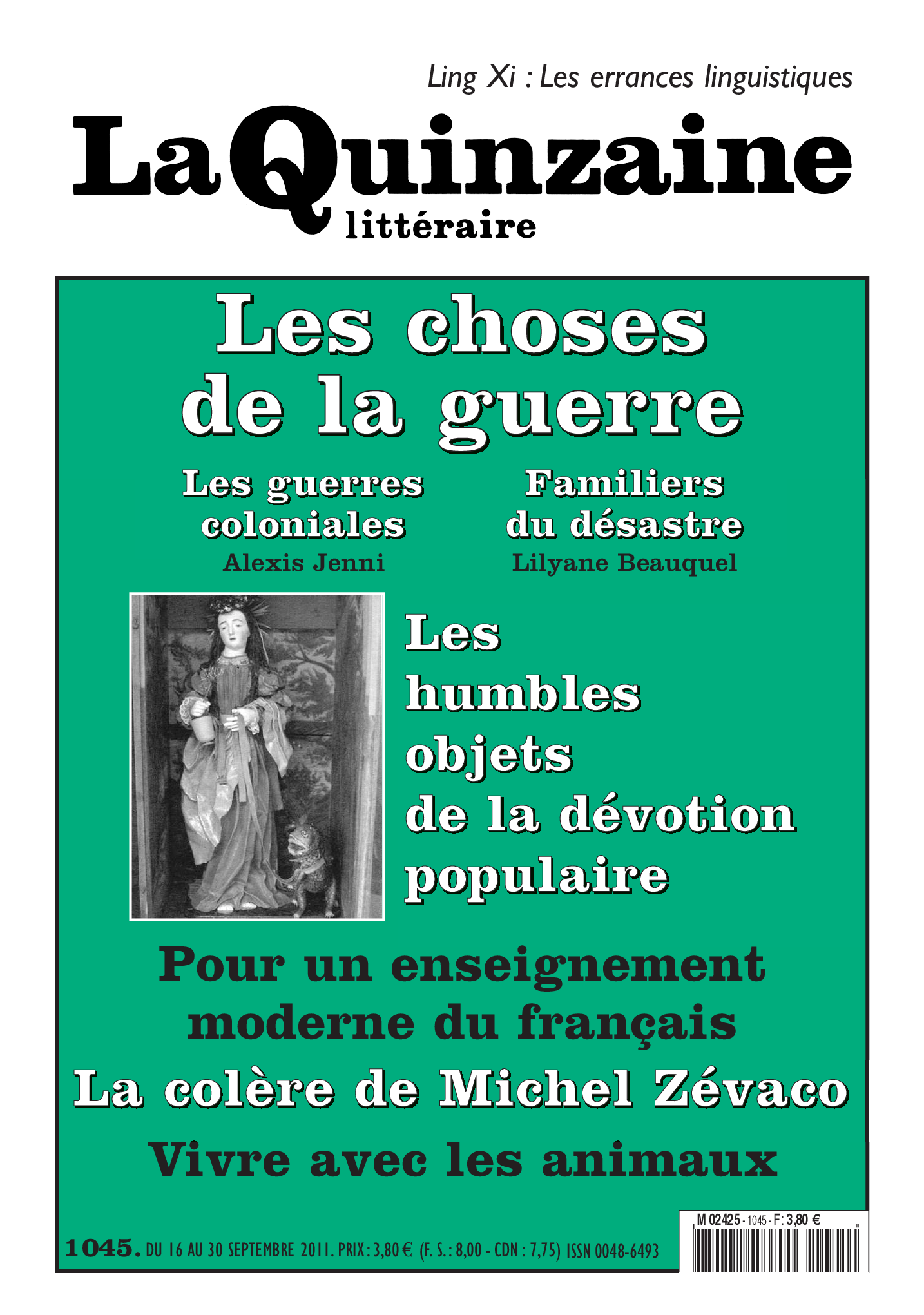

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)