Qu’ils s’égarent dans le grand vide de l’oubli ou qu’ils demeurent comme les traces de saisons anciennes, les mots sont les moyens de la survie, ils augurent des raisons de l’homme et de ses questionnements profonds, nous font nous saisir de la réalité tout en nous en déprenant, à double tranchant, faisant durer des manières de sursauts éphémères. Et lorsque l’être perd tout, broyé, déjeté sur les franges fangeuses du monde, vacillant aux bords d’une sorte de gouffre, fragile et désorienté, il demeure des gestes, des sons, des visions et des espoirs que rien n’effacera, jusqu’à la fin. Le livre de Lilyane Beauquel met en scène ce basculement, ce sentiment de chute, de destruction, d’un énorme gâchis que rien ne répare, de la jeunesse fracassée sur l’autel de la réalité et de la violence, absurdement. C’est une fausse aventure, brisée, le grand retour des choses minuscules qui s’y jouent, les manières de l’affection et ses incarnations, ses déjouements et leur durée étrangement bouleversée.
La voix de Simon porte le tohu-bohu de la guerre et tout ce qu’elle brise, opérant un saisissement sublimé de la violence la plus sordide et la plus injuste, constituant en ses devers précis et poétiques une manière de communauté dans laquelle les sentiments humains ne se tarissent pas et où la beauté signifie encore quelque chose. Ce sont les détails tantôt très doux tantôt terribles que le narrateur saisit sans cesse et transfigure, des « ancolies des champs sous les ramures des bois de l’été », les « bons coups de museau » d’un âne, ses camarades, « hippocampes aux têtes déformées », les rats qui grignotent tout, l’avancée des gaz, la forme d’une pierre arrachée par une déflagration fracassante… Il y a ce que nous perdons et ce que nous imaginons gagner, les voix que nous n’entendrons plus et les corps qui nous hantent, la grandeur de la nature et la petitesse des choses humaines. C’est œuvre de destruction et de résistance. Simon, l’un des ces quatre garçons bavarois d’à peine vingt ans – Nathan, Heinrich et Otto – qui partent pour une guerre qu’on leur a promise brève et glorieuse comme pour une aventure charmante, façon de découvrir le monde comme des enfants joueraient. Ils découvrent sa grandeur en Lorraine, face à une « sauvagerie primitive », un vallon entrevu comme « un champ d’autel splendide dans le rosé du levant » à peine bouleversé par « la rectitude des hêtres », enjoués de quitter ce qui leur était promis et de devenir des hommes.
L’ivresse de vivre, de voir et de sentir ne durera pas. Bientôt, c’est la boue et la fange, l’horreur de la guerre et les odeurs de massacres, la brutalité, les gestes minimaux et sordides qui président à une survie presque inhumaine. Le froid, la vermine, la cruauté quotidienne sont presque des berceuses pour des hommes abêtis et brisés à qui seuls quelques gestes conservant une sorte de candeur ou de douceur viennent donner, parfois, le courage de vivre. Ils connaîtront la violence effarante de la guerre, « familiers du désastre » s’éteignant, après quelques beaux gestes exemplaires, les uns après les autres, faisant se retisser ensemble les bribes d’un passé conformé par son inachèvement. Ils survivent, « noués et faibles, maladroits et cassés », s’accrochant à des instants comme suspendus – le temps d’un chantonnement, de quelques notes de musique, d’une farce théâtrale, de jeux puérils ou de quelques rencontres magnifiques (Lorenz surtout) –, formant une étrange communauté désarticulée que seuls maintiennent les mots que Simon s’obstine à tracer dans ses carnets salis. L’écriture devient outil de la beauté au centre de l’horreur, le moyen de la survie, de la résistance et d’une pacification. Il saisit les bribes de ces vies en train de se défaire, les minuscules appétits de beauté, les faiblesses et les lâchetés inévitables, les odeurs et les couleurs d’un monde détruit et fragile dans lequel des hommes égarés se débattent, chacun raccroché à des détails qui illuminent le grand rien de la mort et de la guerre. Le grand « silence », la « grande brume » où lentement ils disparaissent et leur conjuration par la célébration de la confraternité.
Lilyane Beauquel raconte une guerre que l’on oublie dans son omniprésence, ses scènes emblématiques, mais surtout elle en fait se décanter des principes poétiques, illuminant en quelque sorte les faits par leur diction éclatante. Voici l’énergie paradoxale d’un premier roman superbe et pacifié : cette qualification de la guerre par des moyens esthétiques puisqu’elle n’est que « l’indifférence à la beauté ». C’est énergique et désespéré à la fois, grand et minuscule, général et détaillé. Elle s’apparente à une sorte de phénoménologue poète. Ou plutôt, elle rend les idées poétiques, plaçant sa langue à une sorte d’équilibre précaire entre des formes abstraites, manières de pure idéalité, et leurs incarnations fugitives et épiphaniques. Les mots des sentiments rencontrent ceux des choses, le concept ressort des objets par un mouvement qui semble naturel, évident. La langue nous berce comme elle berce Simon dans le chaos qui le submerge et dont il se débat avec une lucidité bouleversante. Comme il le dit, dans ce maelström surnagent des gestes qui l’ont « ramené à ce qui est », à proférer le réel, à le contenir dans une forme pour en célébrer l’illimitation. Jusqu’à une forme de morale. « Je suis là, les bras ouverts à mon passé proche et enfoui, un pas en avant, le cœur au commencement d’une parole, avec l’or des notes, l’art de vertu qui invente pour la beauté du monde. » La prose nous place alors ici dans l’ordre du saisissement, d’une nomination, d’un effet du langage sur les choses, d’une opération de retour de la parole, du signe, sur ce qu’ils figurent, singeant par là même le retour impossible des êtres à ce qu’ils ont perdu et à ce qu’ils ne pourront jamais connaître. Ce que Simon qualifie de « traque », comme si, somme toute, ne comptait que « le bonheur quand tout se perd ». Le langage opère des déplacements qui font se réordonner les souvenirs et les projections de la conscience sur un avenir qui échappe, faisant comme briller les choses qui entourent les hommes jusqu’à leurs limites, gagnant quelque chose sur le néant, illuminant l’horreur de fragments de beauté, comme « des restes d’étoiles ».
Hugo Pradelle
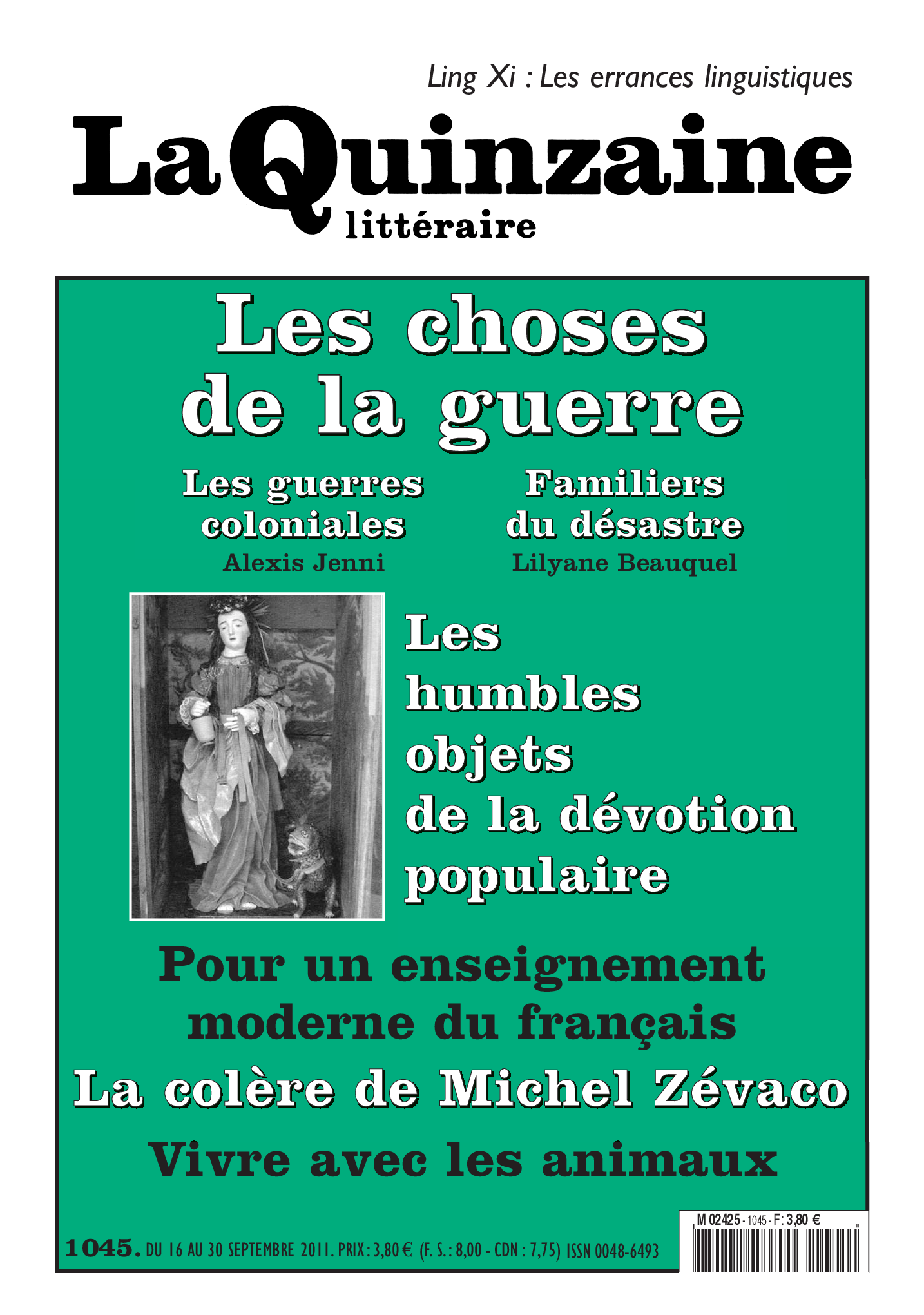

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)