Louise Dupré est poète, romancière, essayiste. Elle enseigne à l’université de Montréal. Québécoise, elle parle sa langue, la nôtre, le français, d’une voix douce, un peu chantante. Et elle écrit de même, avec résolution, cette douceur qui est aussi une douleur : « À Auschwitz, on exterminait / des enfants ». Elle écrit pour « l’enfant / près de moi », sans pathos, avec une sorte d’étonnement renouvelé : comment cela fut-il possible ? Et avec une horreur, une terreur qui agrandissent les trous du cœur.
Elle écrit simplement, son regard, sa pensée et ses mots vont de l’enfant qui est proche d’elle à celui dont il ne reste plus qu’un « biberon cassé / dans une vitrine ». Dans sa belle langue sensible, elle ploie sous le malheur des autres tant elle s’identifie à eux.
Il y a « des petits garçons à hauteur des nuages », à qui on apprend qu’il faut se nourrir, même si c’est avec « les bœufs pendus / aux crochets des marchés » ; à qui on tient la main, comme les mères déportées tenaient celle de leurs « enfants / sur les photos de Birkenau ».
Il y a des enfants proches de soi, pour qui on allume le four en tremblant, et « sans [leur] raconter / Auschwitz ni Birkenau ».
Une telle pitié lui étreint le cœur ! « Les mères ne savent pas / quelle violence / achèvera leur enfant ». Mais elle connaît l’obstination avec laquelle elle reconstruit chaque jour sa joie, « telle une gymnastique ». L’enfant contre les camps. C’était une gageure. Tant de douceur et tant de larmes rendaient la tâche périlleuse. Le résultat pourtant – le livre – est une sorte de miracle, ce nuage, justement, que caresse l’enfant, un équilibre réussi, une vérité de ton dont on ne peut être que jaloux.
Christiane Veschambre se tient exactement à l’endroit où passé et présent se confondent – un carrefour où les temps se confondent. Jadis enfant chérie et désormais adulte, écrivain qui veut faire à nouveau « germer les graines congelées » d’une histoire très ancienne.
Expliquons-nous. De livre en livre – ils sont pour la plupart très minces mais très nourris, très « pleins » –, elle cherche à faire revivre sa mère. Et ne prend elle-même la parole qu’à la troisième personne, personnage parmi d’autres.
Une gare. Lieu des départs, des arrivées. C’est là qu’un certain Robert V. et une certaine Joséphine T. se sont rencontrés. C’est là, ou dans les environs, qu’elle part à leur rencontre, en acceptant une résidence à la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce qu’elle espère ainsi : cautériser sa plaie. « Les Folies d’Espagne, dans l’interprétation de Jordi Savall, sont des variations sauvages et rauques creusées par l’archet de la viole qui lui semblent suivre les scarifications de sa douleur. » Elle souffre de la souffrance de sa mère, elle est
« comme un hall de gare
construit pour ce qui le traverse ».
Et ce qui la traverse, elle, ce sont les autres, les trains que sont les autres, pas seulement sa mère, son père, son frère, mais aussi le meunier de Versailles-Chantiers, le marchand de sandales, les tailleurs de pierre de l’époque de Colbert, l’appelé qui imprime et distribue des tracts contre la guerre d’Algérie.
Christiane Veschambre écrit comme si elle souhaitait mettre à l’horizontal, bien à plat sur la feuille de papier afin de les restituer, les entrelacs si compliqués des histoires personnelles qui font la grande Histoire de tous.
« Le 24 décembre 1938, Joséphine T.
descend du train à la gare
de Versailles Chantiers. Elle vient
de Lamballe. Elle a un chapeau vert,
une valise et, dans un paquet,
vdes chaussures neuves.
À la gare de Versailles Chantiers,
il fait très froid. Le vent empoigne
les quais.
Le train est reparti vers la gare
Montparnasse, son terminus.
Dans le filet à bagages, au-dessus
de la place qu’occupait Joséphine T.,
sont restées les chaussures neuves,
oubliées. »
Si l’on ne peut pas dire de Louise Dupré et de Christiane Veschambre qu’elles sont des écrivains engagés (elles mélangent trop intimement leur destin personnel à celui des autres), il en va de même pour Pier Paolo Pasolini. Il est, lui, plus enragé qu’engagé, c’est par la rage qu’il manifeste sa subjectivité.
« "Pourquoi notre vie est-elle dominée par le mécontentement,
l’angoisse, la peur de la guerre, la guerre ?"
C’est pour répondre à cette question que j’ai écrit ce film, sans
suivre un fil chronologique, ni même logique. Mais plutôt
mes raisons politiques et mon sentiment poétique. »
C’est en 1963 que naît le projet de son film La Rage, avec la découverte des actualités cinématographiques de Gaston Ferranti : quatre-vingt-dix mille mètres de pellicule visionnés dont il a tiré une série d’images qu’il intègre à son projet d’ensemble, lui-même constitué d’autres images tirées d’autres archives, de livres, de magazines. À partir de ce matériau, Pier Paolo Pasolini écrit un texte, en vers et en prose, qui « mélange l’analyse sociale et politique à l’invective, l’élégie à l’épique », écrit Roberto Chiesi dans son introduction. Ce texte, que publient aujourd’hui intégralement les éditions Nous, sera coupé lors du montage du film qui sort en avril 1963 et qui, faute de succès, sera retiré de la distribution.
Dans cette œuvre, Pier Paolo Pasolini s’élève contre la normalité, cet état dans lequel « on ne regarde pas autour de soi… C’est alors qu’il faut créer, artificiellement, l’état d’urgence : ce sont les poètes qui s’en chargent. Les poètes, ces éternels indignés, ces champions de la rage intellectuelle, de la furie philosophique ».
L’écriture scénaristique de Pasolini est captivante. Elle n’est pas que le support ou l’accompagnement d’un film, mais une œuvre à part entière, qui peut exister seule. Au cours des soixante-six séquences dont les titres indiquent le sujet (« Retour de prisonniers », « Churchill en son jardin », « Rencontre des Grands à Genève », « Scènes de vie joyeuse », « Femmes rasées à Venise », « Festival de l’accordéon », « Assassinat de Gandhi et de Lumumba », « Gros plan d’un acteur russe qui interprète Lénine »…), alternent poèmes, extraits en italique de discours, didascalies entre parenthèses : « Toujours à voix basse, respectueuse, comme quelqu’un qui parle de manière un peu effarée pendant une cérémonie funèbre ».
C’est ainsi toute une humanité qui défile, avec gros plans ou vues d’ensemble, catastrophes individuelles (visage du cadavre d’une femme anonyme, Marilyn Monroe sur son lit de mort, sourires des astronautes), réunions de plénipotentiaires à l’ONU, paysages inondés, manifestations, affrontements, patrouilles… Un art documentaire qui tient du cinéma et de la poésie, « qui ne ressemble pas », comme dirait Maïakovski.
Le 17 février dernier est mort le merveilleux conteur et poète, l’ami délicat, Malek Alloula. Souhaitons qu’un éditeur s’empare de l’œuvre trop peu connue en France et trop peu diffusée de cet écrivain rare.
Marie Etienne
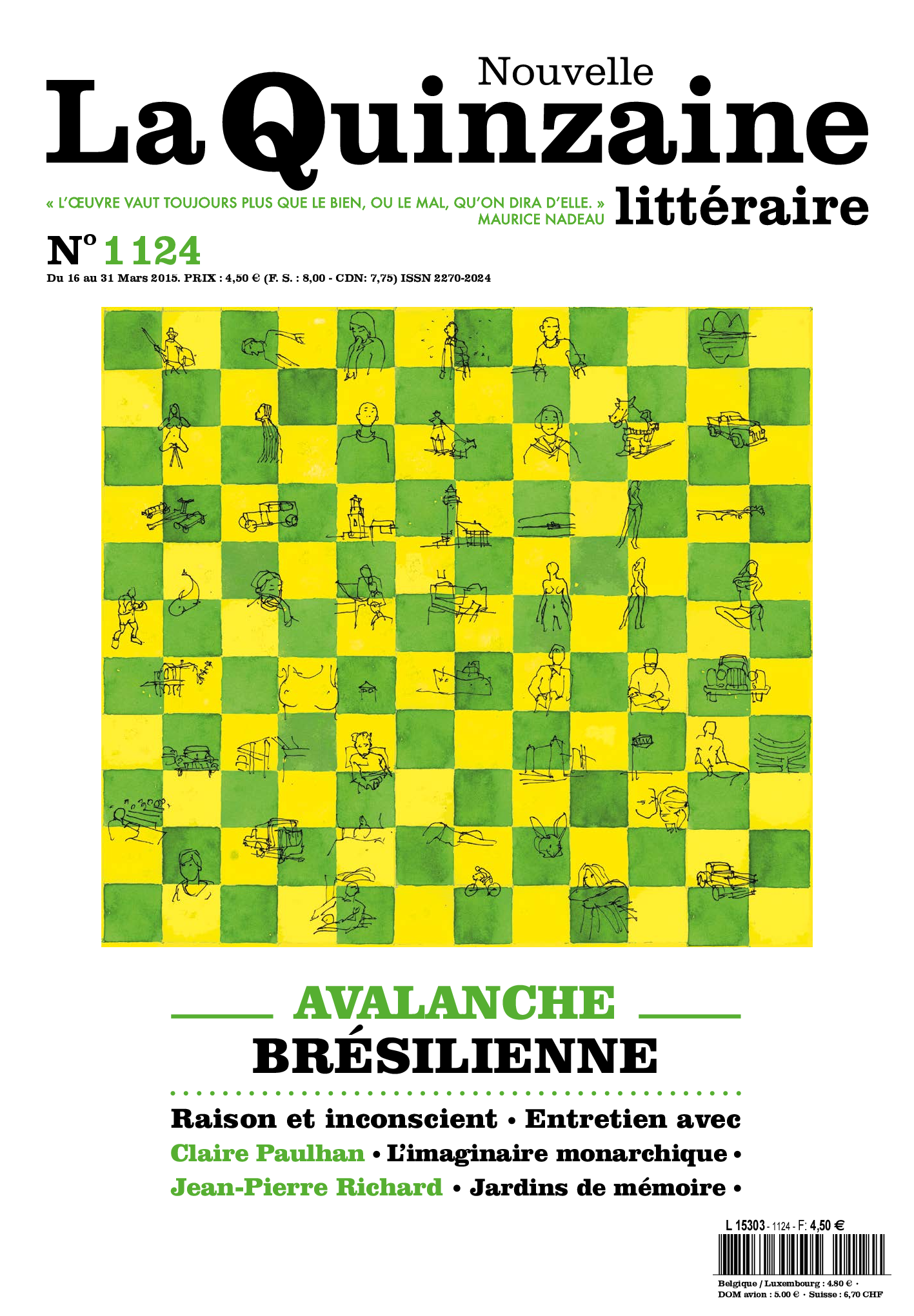

Commentaires (identifiez-vous pour commenter)